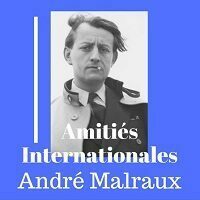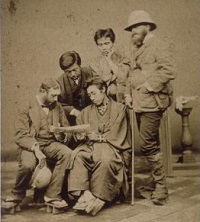François BOULET. Journée d’études André Malraux et les antiquités nationales de la Préhistoire au Moyen Age, 25 novembre 2005, Saint-Germain-en-Laye
LA DAME DE BRASSEMPOUY, L’ETERNEL DE MOISSAC, LES ROIS DE CHARTRES DANS L’OEUVRE D’ANDRE MALRAUX
François BOULET
Journée d’études André Malraux et les antiquités nationales de la Préhistoire au Moyen Age
25 novembre 2005, Saint-Germain-en-Laye
Introduction :
Notre réflexion sur André Malraux et les trois chefs d’oeuvre d’art, la Dame de Brassempouy, l’Eternel de Moissac, les Rois de Chartres a quelques raisons personnelles, plus honnêtes de les énoncer en introduction, et qui explique en partie l’idée de cette après-midi d’études au château-musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, lieu-carrefour et approfondissement de notre existence.
D’abord mon amitié, mon compagnonnage pour la difficile pensée d’André Malraux. La pensée d’André Malraux est difficile, mais elle nous envoûte depuis notre enfance, de l’art à la politique. Natif de Moissac, aimanté par son tympan d’art roman daté de 1100, c’est l’écrivain des « Conquérants » (1928), la « Voie Royale » (1930), la « Condition humaine » (1936), l’ « Espoir » (1936) qui nous a donné quelques clés d’interprétation de l’historiographie de l’abbaye bénédictine, avec le tympan et le cloître de Moissac.
Puis nous avons découvert Saint-Germain-en-Laye avec son musée et sa Dame de Brassempouy ainsi que la Chapelle royale en face de la place André Malraux voulue par Michel Péricard en 1977. Le télescopage et l’approfondissement, prédestinés, intellectuel et moral, de l’histoire du Vieux Moissac à l’histoire de la Sainte Chapelle gothique, notre Chartres local pour les Amis du Vieux Saint-Germain[1].
Je suis devenu ami, en quelque sorte, avec le soutien de la réflexion malrucienne, de l’art magdalénien, de l’art roman et de l’art gothique, grâce au musée des Antiquités nationales, au tympan de Moissac et à la cathédrale de Chartres.
Or, cette réflexion malrucienne sur l’art, enracinée dans sa personnalité peut-être une des plus géniales du siècle, n’a pas été prise au sérieux par les institutions ; seules quelques citations « fulgurantes » ont été retenues. Nous nous sommes lancées dans une longue et sérieuse lecture de ces écrits malruciens, notamment ses « écrits sur l’art », tortueux mais cohérents, souvent repris à travers ses intuitions, approfondis dans tous ses écrits sur l’art à partir de 1922 -douze grands cartons d’archives, dit-on à La Pleiade avec un immense travail de préparation et de documentation, avec lien indissoluble entre le texte et la photographie d’où les couches archéologiques des différents textes proposés au lecteur- et ses différents volumes de 1947 à 1965 :
Psychologie de l’Art, chez Skira : Musée imaginaire en 1947, La Création artistique (1948), La Monnaie de l’absolu (1950) ;
Les Voix du Silence, chez Gallimard, 1951 ;
Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale avec en 1954 le volume le Monde Chrétien ;
la Métamorphoses des Dieux (65 dossiers et 15000 feuillets) et trois volumes Le Surnaturel (sacré égyptien et indien -35 p.-, divin grec -63 p.-, foi chrétienne -267 p.- place privilégiée de cette foi comme réflexion et interrogation), L’Irréel (Rembrandt, Goya, Vermeer), L’Intemporel (Cézanne, Picasso) ;
Le Musée imaginaire en 1965, en format de poche (et projet d’une quatrième version de ce Musée imaginaire jusque dans les années 1970, après Psychologie de l’Art, Voix du silence, Musée imaginaire de la sculpture mondiale).
Sans oublier que c’est Malraux qui crée la collection l’Univers des Formes chez Gallimard en 1960, avec un second volume sur l’art roman. Seul le projet des Antimémoires (1967 jusqu’à sa mort) laisse la réflexion sur l’art en arrière-plan, même si elle affleure constamment dans ce mélange de biographie et de fiction.
D’où la difficulté dans les années 1980 et 1990, de trouver dans la Collection La Pléiade, le dernier état complet et complètement publié par l’auteur des « Ecrits sur l’Art » sur Malraux.
En novembre 2004, les deux volumes de la Pléiade -Oeuvres complètes IV et V-, découverts avec joie dans notre librairie préférée, nous permettent de retrouver tous les ouvrages d’art de Malraux, la plupart indisponibles ou épuisés, dans une forme renouvelée : grand succès de librairie auprès du grand public, 60.000 ventes et trois tirages fin 2005[2].
Pour Malraux, l’art est essentiel aujourd’hui. Il offre un ordre métaphysique et esthétique, une méditation dans une civilisation agnostique, il laisse une vie après la mort, les dernières valeurs sacrées ou empreinte sur notre vie, des mythes qui dépassent nos pauvres vies ; ce n’est pas simplement une copie ou une imitation de l’apparence, ou, selon la célèbre citation de Maurice Denis (V, 787-788, 806), notre peintre saint-germanois, reprise au moins trois fois dans l’oeuvre d’André Malraux « assembler des couleurs en un certain ordre… surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ». L’art peut transfigurer notre vie, lui donner du sel : une véritable création ou conquête qui défie notre néant. « L’artiste n’est pas le transcripteur du monde, il en est le rival » : Brassempouy, Moissac, Chartres sont notre trilogie de sens, de quête, de recherche de l’essentiel de nos vies.
Malraux nous suit, dans une quête de l’essentiel de notre vie, face à tous les malheurs et les méchants, face à la mort. Quant à la Préhistoire et au Moyen Age, en tant qu’historien, je ne suis pas spécialiste de ces périodes mais il m’obsède comme source de toutes nos véritables origines, racines même de Saint-Bernard à Jeanne d’Arc, de Suger à Du Guesclin. Parfois Malraux mêle art, religion et politique comme lors de cette discussion soi-disant imaginaire à La Boisserie avec le général de Gaulle : « Voyez , tout ceci a été peuplé jusqu’au Ve siècle ; et il n’y a plus un village jusqu’à l’horizon. » La cellule de saint Bernard, ouverte sur la neige des siècles et la solitude ». Ou encore le combat du maquis en Dordogne et ses cachettes d’armes jusqu’aux grottes de Lascaux, découvertes par des « gosses » en septembre 1940, transfigurées pour l’occasion, car au-dessus peut-être les patrouilles allemandes (Oeuvres complètes, tome III, Antimémoires, Le miroir des Limbes, V, 3, p. 456, 483).
Cette pensée malrucienne, difficile mais exigeante, passionnante, qui a mis du temps à être appréhendée, voire lisible, lue parfois trop rapidement, doit être expliquée simplement[3]. Elle offre bien moins une réflexion scientifique de l’historien qu’une émotion lyrique de penseur, qui interprète et cherche à aimer passionnément quelques oeuvres, à les rendre vivante, présente. Nous avons besoin du lyrisme de l’écrivain, dans notre monde.
Le grand historien médiéval Georges Duby a lu Malraux ; il a repris quelques analyses de son oeuvre ; et même deux illustrations en vis-en-vis exactement les mêmes que dans le choix malrucien dans son ouvrage Adolescence de la chrétienté occidentale 980-1140 (Skira-Flammarion, 1984, pp. 100-101) : la Vierge Noire de Dorres (Pyrénées-Orientales) et Notre-Dame-de-Bon-Espoir de Dijon, « à la fois le mystère de la maternité divine et le mystère muet de la douleur paysanne. »
Derrière cette réflexion du génie de nos collines sacrés, se cachent les questions fondamentales de notre actualité : la lutte contre le nihilisme et le cynisme, la violence suicidaire, pour une culture occidentale toujours à définir, à prolonger, à parfaire. Comme le dit l’auteur en 1950, la « culture européenne » n’a pas jamais existé ; la culture chrétienne oui ; autrement dit, « est-ce que l’Europe, oui ou non veut exister ? » Nous tenterons de répondre à cette question d’actualité spirituelle du début du XXIe siècle, fin 2006, même avec un agnostique comme André Malraux, ami du christianisme, des religions. De Gaulle lui pose un jour la question à brûle pourpoint : « Pourquoi parlez-vous comme si vous aviez la foi puisque vous ne l’avez pas ? ». Autrement dit, avec la culture préhistorique puis médiévale qui nous porte et nous rend vivant et présent dans la modernité, comment éviter une certaine fascination destructrice ou cynique enfouie en l’homme que le XXe siècle a mis tant en pratique, hélas. Autrement dit, et je n’oublie pas le beau et difficile métier de me trouver devant la jeunesse tous les jours, en me posant toujours la question essentielle : que proposer de solide et de vrai dans ce monde à nos jeunes gens ? La Dame de Brassempouy, l’Eternel de Moissac, les Rois de Chartres, bien sûr.
I. La pensée de l’art d’André Malraux. Essai de définition d’une « théorie personnelle »
André Malraux (1901-1976), écrivain français de tout premier plan, est fasciné par l’art universel. Malraux se confronte à l’oeuvre artistique de la Préhistoire, de la Dame de Brassempouy aux grottes de Lascaux, du Moyen Age d’Occident, comme aux autres oeuvres d’art d’Asie -Angkor au Cambodge ou Baraboudour à Java, Khorsabad en Irak ou Elephanta et Madura en Inde-, d’Afrique primitive -Art nègre- ou d’Amérique précolombienne : le véritable « musée imaginaire » de l’auteur.
Cette confrontation ou communion, dialogue entre deux oeuvres d’art d’époques et de cultures différentes, -un Christ roman et un Bouddha, la tête d’ange de Reims et un Koré d’attique (Voie Royale), et la Dame ou tête de Brassempouy –« fascinante… la figure la plus énigmatique du monde » et la tête du Christ ou la statue de Chartres (IV, p. 972, 1016, 1247-1248, « André Malraux présente la plus vieille tête sculptée du monde ») est au coeur de la difficulté de compréhension de l’oeuvre malrucienne face à l’art.
Sa vie d’autodidacte lui permet de tout retenir, avec le coup d’oeil et une pensée. Cette façon de regarder la Dame de Brassempouy est d’une précision étonnante : « Sa matière, ses dimensions, rendent confus ses plans, que la lumière révèle. Elle a besoin d’éclairage » (IV, p. 1247). La publicité de ce musée rend raison à cette notation.
Il va bien au-delà de l’institution des critiques d’art. Il s’imprègne des oeuvres de façon toute personnelle, sans penser par l’institution, l’université, la science : c’est son regard et sa pensée qui priment ou l’ivresse d’un instinct génial mais raisonné et cohérent à sa façon. L’art permet pour Malraux d’arriver au stade le plus avancé possible de la connaissance de soi et du monde : sortir de l’éphémère, des combats quotidiens, du « misérable petit tas de secret », du terre-à-terre dirait le général de Gaulle à propos du « génial » Malraux pour atteindre la voix de l’éternel et du sacré, tout en étant agnostique. Malraux ne recherche pas une spécialité artistique reconnue, mais les ressources métaphoriques ou combinatoires entre les différentes civilisations artistiques. L’artiste apporte alors sa volonté de communion ou de révolte, une réalité jamais reproduite mais transposée, un monde nouveau, proche du silence -les « Voix du Silence » ou du sacré. L’oeuvre d’art, enfoui dans un sacré perdu, peut par là offrir un combat, une victoire, une conquête personnelle sur les tous les destins broyés, les fatalités, penser la civilisation.
Trois notions malruciennes de l’art sont alors à l’oeuvre, si nous résumons :
– l’art comme comparaison en tout lieu et toutes civilisations : confrontation ou communion dans un vaste champ d’investigation, avec comparaison systématique. Le chef-d’oeuvre se définit par sa famille comme par ses rivaux, dans sa propre civilisation ou dans d’autres : comparons la tête de la Dame, la tête de l’Eternel, la tête du Roi. D’où une liberté de réflexion, anachronique et anatopique, chez Malraux, très tonique, voire une liberté de ton d’esthète, s’intéressant autant à une sculpture indienne, qu’à une reproduction photographique, à un détail qu’à l’ensemble. Pour la Dame de Brassempouy, il signale son « illusoire » parenté avec l’Egypte, due à sa coiffure, mais il ajoute qu’il ne faut pas oublier qu’ « elle est antérieure de trente-cinq mille ans au moins à la première dynastie, séparée d’elle par tout ce que nous connaissons de la sculpture préhistorique… » (IV, p. 1247).
Cette liberté d’analyse a également éreinté les chapelles intellectuelles, d’où quelques citations polies sans reprendre ses analyses. « Le Saint Jean Baptiste du porche de Reims est loin d’atteindre au génie de son visage isolé. Le fragment, mis ne valeur par sa présentation et par un éclairage choisi, permet une reproduction qui n’est pas un des plus humbles habitants du Musée imaginaire… » (IV, I, p. 213). Le détail des miniatures et des albums de photographies donnent, je cite, un “gothique libre de la profusion des cathédrales », comme l’art indien délivré de la luxuriance des temples et des fresques. Malraux va même plus loin dans cette analyse : « l’album isole tantôt pour métamorphoser (par l’agrandissement), tantôt pour découvrir (isoler dans une miniature de Limbourg un paysage pour le comparer à d’autres, et aussi pour en faire une oeuvre nouvelle), tantôt pour démontrer. » (IV, I, p. 217). Ainsi, la miniature, par exemple, relie de façon singulière selon l’écrivain, l’Occident, la Perse, l’Inde, le Tibet, et à un moindre degré, Byzance et l’Extrême-Orient.
– l’art comme conquête ou défi humain, l’invention de son propre style -l’ivoire de la Dame, l’art roman, le vitrail-, face au chaos, à l’informe, à la mort ou l’indignité. Sortir de la copie, comme l’art chrétien occidental se libère des figures antiques, notamment les copies romaines. Le style rivalise alors avec la réalité. Mieux, l’art du Gravettien, entre 29.000 et 22.000, si incertain dans sa chronologie, sort des spécialistes par la reproduction, la photographie, le cinéma : il devient un mythe, une conquête. Tombons amoureux de la Dame à la Capuche, retrouvée dans cette grotte du Pape à Brassembouy en 1894. L’art peut devenir une conquête démocratique, comme l’école l’a été sous Jules Ferry (thème très malrucien du peuple et de l’art). La reproduction massifiée depuis cent ans, surtout depuis Internet -une des oeuvres d’art les plus reproduite de France-, non connu par Malraux, peut évoquer et suggérer pour un plus grand nombre. L’art apporte de rares valeurs qui défient le temps. l’art comme défi de l’homme face au destin -destruction du destin- ou individualisation humaine. L’art réduit les choses à la mesure de l’homme ou de ses rêves. L’art chrétien occidental apporte son étape, son instant à l’individualisme à travers la figure du Christ ou de l’Eternel, byzantin, roman, gothique. L’art de l’Extrême-orient, au contraire, s’inscrit dans l’éternité. Cette méditation du temps humain et de l’art, est central dans les VS. La confrontation de l’Orient et de l’Occident est permanente chez Malraux, dans ses écrits d’Art comme dans ses romans. A travers les civilisations, Malraux défie les différents et grands styles, « dont l’évolution et les métamorphoses semblent les longues cicatrices du passage de la fatalité sur la terre » pour l’individu (P ; 238).
– la métamorphose de l’art, du sacré au profane, du sculpteur croyant au moulages des musées, de l’abandon jusqu’aux Vandales à la redécouverte. «… de même qu’une suite de degrés semblait avoir mené le gothique au classique, c’était une autre série de degrés, en sens inverse, qui avait conduit à la redécouverte du gothique : ce que redécouvraient la fin du XVIIIe siècle et le romantisme n’était d’abord ni Chartres, ni la solennelle âpreté romane, c’était Notre Dame-de-Paris » VS, p. 211. Le peuple des statues romanes ou gothiques est d’abord vécu comme Vérité religieuse même, puis c’est le temps du profane, où, avec Malraux, l’Irréel remplace ou succède à la Foi ou au Surnaturel.
Chartres et Moissac ne sont redécouverts que vers 1829-1832, à la fin du premier tiers du XIXe siècle, dans une autre civilisation ; la Dame de Brassempouy est donc plus récente en quelque sorte. On cesse de voir l’antique pendant un bon moment ; la sculpture romane pendant cinq siècles. Malraux répète que Théophile Gautier de passage à Chartres ne fait pas le détour, « quatre cent mètres ! » alors que les statues-colonnes ne sont pas enfouies (Antimémoires, p. 745). L’auteur précise cette métamorphose de nos goûts, ce temps long de notre prise de conscience. « de même qu’une suite de degrés semblait avoir mené le gothique au classique (on pense de Chartres à Versailles, de la chapelle pour le château au château pour la chapelle à Saint-Germain), c’est une autre série de degrés, en sens inverse, qui avait conduit à la redécouverte du gothique : ce que redécouvraient le fin du XVIIIe siècle et le romantisme n’était d’abord ni Chartres, ni la solennelle âpreté romane, c’était Notre-Dame de Paris.
Dans les trois cas -comparaison, conquête, métamorphose-, la dimension intemporelle et métaphysique de l’art obsède Malraux devant le génie de l’artiste mortel, apportant une oeuvre pérenne, défi à tout esprit de système, un sens ultime face à l’indifférence du monde et à notre mort. Nous ne saurons jamais les noms des artistes de la Dame, de l’Eternel, des Rois ; humilité et grandeur du génie humain.
D’autre part, si l’oeuvre romaine recherche la maîtrise, la sérénité ; l’oeuvre du Moyen Age affronte le mal, le péché face à Dieu, le Jugement Dernier ou l’Apocalypse dans sa version romane, puis face au Christ-Roi dans son étape gothique. La Renaissance redécouvre l’Antiquité ; elle refait l’Antiquité. Par la suite, le XVIIe siècle trouve grossière cette oeuvre jugée gothique ou barbare. La Dame de Brassempouy, elle, est inclassable.
La civilisation du Gravettien-Aurignacien- et ses premières Vénus païennes, puis du Moyen Age chrétien, sous sa triple version byzantine, romane et gothique, tient une place privilégiée dans cette quête des voix universelles et intemporelles de l’éternel et du sacré, notamment à travers une réflexion sur les orientations esthétiques de l’Occident. Il y apporte une interprétation très personnelle, déroutante même, qui engage toute la « condition humaine », notre destin d’homme devant la mort, même en tant qu’écrivain agnostique face à l’oeuvre permanente d’un sculpteur chrétien anonyme, disparu.
Malraux affirme que le symbole de l’art qu’ « entend » le peuple d’une civilisation cohérente (et non totalitaire) c’est la Vierge Noire, une des sculptures les plus sacrées, après la Star de la Préhistoire, avec sa triple dimension, d’humilité, d’amour, de beauté. Le seul art qui parle aux foules, enraciné dans la vie populaire et sans leur mentir, c’est celui, selon Malraux, des grottes aux cathédrales, car il se développe avant même que l’idée d’art ait été conçue, avant les « arts d’assouvissement » jusqu’aux arts totalitaires du cinéma aux slogans de propagande (IV, p. 764).
Sa réflexion esthétique commence dès sa jeunesse, par la visite de nombreux musées, notamment celui des Monuments Français, s’épanouit et s’ordonne dans les années 1930, et à l’approche de la quarantaine, devient proprement une pensée écrite dans les années 1940 et 1950. Il date de 1935 le début de l’élaboration des Voix du Silence, mais c’est au cours du refuge en Corrèze en 1943 qu’il prend le temps de s’y consacrer entièrement. Les premiers volumes sur l’art sont publiés en 1947 et 1951 et cette réflexion le poursuivra tout au long de sa fin de vie jusqu’en 1976.Il lit les historiens d’art comme Henri Focillon, e plus admiré par Malraux, et L’Art religieux du XIIe siècle en France d’Emile Mâle. Mais ses propres lectures ne doivent pas cacher une réflexion toute personnelle, affrontée à l’oeuvre médiévale elle-même. A travers les prophètes et les théologiens eux-mêmes : Malraux lit la Bible, saint Augustin (Dieu irrémédiablement loin et bon), François d’Assise (Dieu est Amour jusque dans la nature) -un Saint sans théologie selon André Malraux, avec l’humanisation universelle de la douleur, qu’il relie à sa réflexion sur l’oeuvre de Giotto ce dernier abolissant la distance entre humain et le Christ-, Nicolas de Cuse (le Christ comme homme parfait), Luther (la foi seule sauve).
Déjà, précisons que le haut Moyen Age est absent, mis à part l’art pré-roman. La seule présence de ce dernier est résumé dans l’expression, souvent reprise, de « nuit mérovingienne », ou « forêt mérovingienne » ; les deux expressions ne sont pas si fausses, même si elles sont un peu écornés par la riche historiographie récente. Quant à la période carolingienne, elle apparaît chez Malraux avec les enluminures, du Rhin à l’Elbe, un premier style. Mais les enluminures ou « miniatures » qui attachent le plus l’auteur sont ceux du coeur du Moyen Age entre les XIIIe, XIV et XVe siècle, comme la scène de Mars des « Très Riches Heures du duc de Berry » des Limbourg (1416). Nous notons, quand même, la représentation du saint Marc de l’évangéliaire d’Ebbon du IXe siècle, du temps de Charlemagne (VS, p.226). Et, devais-je l’oublier avec vous, mes amis, la « Dame à la licorne » qui se trouve au musée de Cluny, commande célébrant les noces d’un jeune couple fortuné et illustrant le thème des cinq sens, est citée deux fois (IV, p. 228 ; V, 263)
Les oeuvres les plus présentes chez Malraux sont les chef-d’oeuvre reconnus. Malraux n’innove pas en les affrontant ; il innove en les confrontant avec d’autres oeuvres, voire des fragments d’oeuvres, ou même des éclairages particuliers de l’oeuvre grâce à la photographie : toujours les détails de la Dame de Brassempouy, la tête du Vieillard de Moissac ou le Christ-Roi de Chartres. « Le Saint Jean Baptiste du porche de Reims est loin d’atteindre au génie de son visage isolé » ou le « gothique libre de la profusion des cathédrale » (pp. 213 et 217). Pour lui, la démarche classique va du détail à l’ensemble ; sa démarche : la nôtre, qui va souvent de l’ensemble au fragment, trouve dans la reproduction un incomparable auxiliaire. » La reproduction de l’oeuvre d’art suggère ou évoque. D’où toute son expérience de marchand d’art qu’il a été dans sa jeunesse pour des artistes de Montmartre, puis Gallimard : c’est lui qui lance, ne l’oublions pas, la collection « l’univers des formes ».
II. La cathédrale de Chartres, oeuvre majeure de la pensée malrucienne, du Roi au vitrail
Si nous nous plongeons dans les « Ecrits d’art » de Malraux, édités récemment, Chartres s’impose dans toute l’oeuvre de l’écrivain. Sans reprendre les citations sur la cathédrale -comme dans la Voie Royale, en face de Tolède ou de la guerre d’Espagne-, la cathédrale de Chartres apparaît comme une véritable obsession.
Sur le plan statistique, il s’interroge :
– cent soixante deux fois sur Chartres, la cathédrale Notre-Dame du XIIe siècle avec notamment les vitraux bleus et les sculptures du Portail Royal.
– cent treize fois sur le sens historique et esthétique du Tympan d’art roman de Moissac (Tarn-et-Garonne).
– cinquante neuf fois avec la cathédrale de style roman, avec un Tympan également d’Autun.
– vingt-neuf fois, Vézelay
– Saint-Sernin et Toulouse 11 fois, comme Byzance
– Beaulieu en Corrèze, St-Jacques de Compostelle, Reims 6
– Amiens et Conques 4
– St-Benoît sur Loire, Saint-Savin, La Lande de Fronsac 3
– Dame de Brassempouy : 3 fois également (volume IV)
C’est donc l’art gothique, avec Chartres, et l’art roman avec Moissac, que Malraux illustrent le plus souvent sa réflexion esthétique, très personnelle, comme le prouvent les premiers avant-textes conservés dans ses archives. Une phrase essentielle peut déjà être dite Il fait commencer l’épopée de l’art sacré occidental avec l’ « Eternel » ou l’ « Apparition » de Moissac : « L’épopée commence à Moissac » affirme t-il : 1063 ou 110. Elle se termine avec Chartres et la mort de saint Louis : 1270[4].
Selon lui, le génie d’une civilisation chrétienne, l’épopée du premier grand style, l’art roman puis gothique, commencent à Moissac et finit à Chartres. Cette sentence chronologique, essentielle, pour Malraux mérite réflexion.
L’évolution est claire entre le XIIe et le XIIIe siècle, siècles religieux : une véritable sortie de l’enfer pour l’homme ou plutôt sortie du Dieu abrahamique roman ; l’art gothique marquant la réconciliation entre l’homme et Dieu, l’Eglise et la société aussi : Dieu souriant. « En face de Byzance, le roman est du Nouveau Testament, et en face du gothique, de l’Ancien ; il va vers Reims comme Dieu vers Jésus, comme le Christ en majesté de Vézelay vers le Christ enseignant d’Amiens, vers le Christ mort des Pieta » (p. 449). Le sculpteur de Chartres est possédé par le Christ-Roi et Homme (p. 840). Les maîtres de Chartres trouvent dans la ferveur religieuse, leur foi, leur prière, le moyen d’atteindre une présence sacrée. Ce qu’ont voulu les artistes chrétiens : saint Augustin l’a dit pour des siècles, louer Dieu à travers les Bibles de pierre.
Le XIIIe siècle apporte une révélation : son ordre intérieur, son modèle, son roi et les progrès de la principale monarchie de l’Occident. Les Rois de Chartres cessent d’être de puissantes expressions barbares pour devenir l’expression du génie chrétien (p. 817). Les cathédrales s’élèvent en même temps que la royauté française, à travers le « portail royal » de Chartres (p. 449). Le Christ royal prend sa place à côté du Crucifié, avec la Vierge dans l’ombre, compatissante. Les cathédrales sont toutes dédiées à cette femme ; le Christ qui la couronne est de moins en moins le Seigneur et de plus en plus le Roi. L’homme chrétien trouve son harmonie : une réconciliation dans l’art de Saint-Louis. Enfin ce n’est pas l’Eglise qui a imposé le génie gothique, mais les maîtres de Chartres (p. 451, 477, 1238).
Malraux reprend et confronte la chronologie des trois styles chrétiens, selon Moncef Khemiri : l’art byzantin, transcendance moins l’homme qui lutte contre l’éphémère, l’art roman comme transcendance avec l’homme et les Vieillards atteints par la Grâce ou l’Etrnel augustinien, enfin l’art gothique comme hommes sans transcendance, avec la Vierge sur ses genoux. En face de Byzance, le roman est du Nouveau Testament, et en face du gothique, de l’Ancien. Seul Le Gréco parvient peut-être à une synthèse des trois. En tous les cas Malraux défend cette valeur suprême de la transcendance, pourtant inaccessible.
La cathédrale gothique apporte l’inexprimable, l’intransportable, comme le vitrail et l’humanisme. Le « musée imaginaire » a donc des limites dans sa confrontation des oeuvres. Malraux précise avec une part d’humour : « nul mécène n’apportera au Metropolitan Museum le Portail royal de Chartres, les fresques d’Arezzo » (IV, I, p. 205). Le musée et la reproduction photographique n’enlèvent pas la signification, la résurrection de nos visites et la culture européenne revendique cet héritage universel, médiatisé mais la production n’est pas la création. La création des figures sculptés ou des vitraux de Chartres, à l’égal de Rembrandt ou de Michel-Ange qui leur succèdent, peuvent symboliser le génie de la culture européenne. Du moins, il n’y a pas d’équivalent dans d’autres continents (p. 1226, 1240).
Notamment le vitrail. Le vitrail gothique occupe une place importante dans nos résurrections même contemporaines. Ce n’est pas seulement un art d’ornement, qui va au-delà d’un dessin et un coloriage ; c’est un art humaniste et un art lyrique, pour l’écrivain. Le vitrail appelle le lyrisme pictural de Van Gogh avec ses Tournesols ou de Chagall avec ses visions bibliques ; cette oeuvre est plus proche du vitrail gothique que Titien ou Vélasquez : « le sommet de la peinture occidentale antérieure à Giotto, ce n’est ni telle fresque, ni telle miniature, c’est la Belle-Verrière de Chartres (illustration, IV, I, p.233). Le génie du vitrail est précisé par Malraux avec son propre génie (IV, I, p. 234) par le choc des métaphores et des citations :
– image du vitrail qui obéit à l’Ange du cadran solaire.
– « Le génie du vitrail finit quand le sourire commence ».
– la suite des civilisations qui amène le vitrail : l’éternel désert, la pluralité romaine, l’abstraction de Byzance
– le vitrail : une mosaïque libérée ; ce n’est plus un décor hiératique mais une expression humaine.
Le vitrail, c’est une mosaïque non pétrifiée de Byzance, le symbole d’une civilisation chrétienne à côté de l’Islam. Malraux énonce : « D’un côté le vitrail, de l’autre le tapis », avec l’abstraction et le fantastique, une figure de l’Orient éternel. Le vitrail ne permet pas d’être un moyen de communion de l’homme et de l’univers comme dans les chinoiseries -peinture Song- et le japonisme. Toujours la comparaison et l’évolution.
D’où l’analyse sur l’évolution du tympan de Moissac au vitrail de Chartres. Nous passions du Père au Fils de l’Homme, de la Création, du Jugement, à la « moissons familière des métiers humains ». Les vignerons, cordonniers, des verrières de Chartres, prennent la place des damnés d’Autun, des vieillards de Moissac. Le grand éclat lyrique commence à s’éteindre ; de Senlis à Amiens, d’Amiens à Reims, de Reims en Ombrie, « l’homme va grandir jusqu’à faire éclater ces verrières qui ne sont pas encore à sa taille, et qui ne sont plus à la taille de Dieu » (p. 234).
Le vitrail fait donc la liaison entre le Dieu seul du roman et l’homme de l’humanisme sous les mains ouvertes du Médiateur de Chartres à Reims, jusqu’à Assise (p. 283). Cette individualisation du destin, cette trace d’un drame sur chaque visage -pensons aux pieta-, permet de s’éloigner de la mosaïque byzantine hiératique ou de la sculpture bouddhique « ivre d’unité » selon lui (p. 428). Malraux a toujours la recherche d’une formule : « L’expression gothique des scènes est aux expressions antérieures ce qu’est le roman moderne au roman en vers ». L’Asie ou l’art romain choisisse le masque avec une partie mobile du visage (yeux et bouche) qui compte peu ; la statuaire chrétienne au contraire s’attache à elle. « Devant notre art médiéval, l’Asiatique a l’impression d’impudeur, et bien plus vives que devant les nus de la Grèce : l’art gothique a « démasqué » l’homme. La Renaissance pas la suite reprendra ce thème grec du nu dépersonnalisé (p. 430).
Le gothique va être méprisé pendant trois cents ans. Il sera redécouvert au XIXe siècle ; les romantiques découvrent le « mythe de l’artisan du Moyen Age » : sculpteurs médiévaux ou artistes populaires de l’instinct ; Théophile Gautier regrette cependant de n’être pas passé par Chartres dans son Voyage en Espagne : ce regret marque un nouveau goût sélectif, de la fin de l’indifférence de Chartres, au coeur de la « métamorphose des dieux ». Malraux rappelle la boutade de Renoir à propos du vitrail de Chartres : « Il y avait là un bonhomme qui se démenait devant une statue avec un ciseau et un marteau : il tapait, il tapait ! Un autre, dans un coin, le regardait et ne faisait rien : j’ai compris que c’était la sculpteur » (526). Mais ce pastiche a des limites pour parvenir à la création, au génie gothique, un nouveau langage.
Le mot gothique suggère donc un mystère de la création de la forme, une révélation ou autre monde, autant les retables en bois que les cathédrales qui « étaient un bloc ». Le maître de Chartres, avec « la création d’Adam », doit son accent à la pureté de son coeur, écrit Malraux : copiste fervant des oeuvres de Dieu (p. 521). Mais cette apogée de culture religieuse, cette époque de foi crée un lien moins artisanal que magique. Malraux découvre des bisons d’Altamira aux cathédrales des sculpteurs inspirés, un domaine encore obscur, modernisé sous le nom d’inconscient – ou d’instinct (523)
Le Dieu de l’art roman affirme aussi cette création sacrée, d’instinct.
III. L’importance de Moissac dans l’oeuvre et la vie de Malraux
Le Tympan de Moissac est une sculpture importante, moins fondamentale que Chartres, mais presque un « phare » de la réflexion esthétique et agnostique d’André Malraux : « le temps où la vie chrétienne s’ordonne en civilisation ». Avec la Dame de Brassempouy et les Rois de Chartres, il symbolise « l’éclat des passages privilégiés de l‘homme ». Mais Moissac représente avant tout le « premier grand style chrétien » : la chronologie s’impose.
Dans ses oeuvres, écrites des années 1920 à sa mort le 23 novembre 1976 – « La Psychologie de l’Art », « La Métamorphose des Dieux », le « Musée Imaginaire », « Les Voix du Silence », « Le Miroir des Limbes »-, sauf erreur, nous avons recensé 113 citations sur Moissac, sans oublier sa recherche des meilleures photographies -dont quatre éditées dans la Pléiade-, choisies par l’écrivain, du tympan en général ou de ses détails -Vieillards, tête du Christ en majesté-.
Malraux cite Moissac de différentes manières : d’abord le Tympan de Moissac (24 fois cités), ensuite Apparition de l’Eternel ou Eternel (19 fois), enfin les Vieillards de Moissac (12 fois) ou le Maître de Moissac (11 fois), ajoutons des citations plus isolées mais significatives : les sculpteurs (6 fois), le Christ de Majesté (5 fois) l’Apocalypse (4 fois), l’épopée (3 fois), le génie, le Juge, la Vision de Saint-Jean, le Pantocrator, la prédication enfin les rues de Moissac.
Les quatre illustrations choisies par l’écrivain et retenues dans l’édition de La Pléiade, parue en 2004, se concentrent sur les seules sculptures du tympan : Vieillards ou Eternel. Nous remarquons l’absence de Jérémie ou des chapiteaux du cloître.
La première référence indirecte à Moissac, repérée dans la vie de Malraux, est une discussion que le jeune homme a en 1923 avec Clara Goldsmith, avant de partir vers Angkor, où il compare le chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle avec son chapelet d’églises, et les temples-montagnes du pays Khmer. De plus, le couple fréquente à Paris le « Musée de Sculpture comparée » (depuis 1937, « Musée national des Monuments français »), où sont présentés, dès la première salle, les moulages de sculptures du tympan, définis de façon erronée « L’apparition du Christ au Jugement Dernier », des bas-reliefs et des chapiteaux du cloître de Moissac.
On peut penser et émettre l’hypothèse vraisemblable que Malraux n’est jamais venu à Moissac et n’a jamais vu le cloître in situ, à part dans des reproduction photographiques : il a rêvé des sculptures de Moissac en écrivain -plutôt que mythomane, mot souvent prononcé de la part des malrucienophobes- épique à travers le Musée de Sculpture comparée et les albums d’art. De même, les illustrations photographiques ne me semblent pas assurément des photographies in situ ; du moins, elles ne sont pas de l’auteur lui-même, mais peut-être du photographe Jean Dieuzaide, aidé par Dom Angelico Surchamp directeur de la collection de la revue Zodiaque qui se consacre à l’art roman de 1956 à 1976[5].
II. Comparaison et pensée
Cependant, l’écrivain ne s’intéresse pas à Moissac ou à Beaulieu en biographe. Il condamne, nous le savons, le « misérable petit tas de secrets » et écrit ses Antimémoires, se méfiant de la mémoire et de son culte. Il est beaucoup plus attentif aux « filiations », aux « ressemblances », au génie de la création -se définissant moins par ce qu’elle copie, que parce qu’elle apporte- d’une oeuvre d’art, qu’à sa mémoire précise ou relative, non à la recherche des causes et des effets, propre à la science des historiens, mais aux intuitions des comparaisons, qui donnent du sens et de la présence au chef-d’oeuvre.
Ce point est essentiel dans la pensée de Malraux : c’est la véritable ouverture au « Musée imaginaire », personnel de l’écrivain. Point de perspective historique, mais une perspective existentielle de l’art comparé[6].
Malraux analyse par exemple l’oeil roman et l’oeil gothique (p. 449). « L’oeil roman est d’abord un globe encastré dans deux paupières, un signe… Mais un oeil gothique n’est plus un signe, c’est l’ombre préméditée d’une paupière, un regard ». Ce dernier exprime un sentiment, une expression, ce qui peut rejoindre le Christ.
Le Tympan de Moissac est comparé avec quelques autres chefs-d’oeuvre universels chers à Malraux. Nous avons repéré dans les énumérations de sa pensée les principales oeuvres d’art cités à côté du Tympan de Moissac, nommé 113 fois et dans 69 pages de l’édition La Pléiade. Autun est cité 24 fois avec Moissac, et nommé dans 59 pages ; sa cathédrale Saint-Lazare de style roman, son Tympan, un Jugement Dernier postérieur à Moissac, avec ses « Innocents » et ses « Ingénues », diffèrent selon Malraux des Vieillards ou de l’Eternel plus sévères à Moissac. Le Portail Royal de Chartres est cité 22 fois avec Moissac, et nommé plus souvent que Moissac dans 162 pages, autrement dit deux fois plus cité : Chartres fascine Malraux, avec ses colonnes-sculptures du XIIème siècle et ses vitraux, d’art gothique, un siècle après le Tympan de Moissac. Vézelay est cité 15 fois, dans 29 pages, avec son abbaye bénédictine du XIème siècle, à l’orée de la route de Saint-Jacques de Compostelle, avec une étape à Moissac ; le Tympan, les statues de Saint-Pierre et Saint-Paul, ainsi que les « Hommes-Chiens » figurent également dans la pensée malrucienne.
Mais la comparaison ne s’arrête pas aux sites d’art roman ou gothique. L’esthétique de Malraux souhaite, par le biais de la confrontation universelle, aller à l’essentiel de l’art : une présence, une vérité au-delà de l’apparence, avec une foi et un sacré qui souvent la portent, ou du moins l’ont portée. L’Eternel de Moissac est souvent comparé avec celui qui le précède, à Byzance (11 fois), le Pantocrator en mosaïque, à la fois plus hiératique et moins humain, plus décor que présence, mais également aussi mystérieux et tragique qu’à Moissac. Notons que Malraux ignore certaines cultures artistiques antérieures : il ne reconnaît pas de « génie » à l’art mérovingien des forêts et des « sculptures primitives », voire à l’art romain, qui ne fait que reproduire, sans grâce, l’art grec.
Moissac apparaît en premier, comme une rupture fondamentale, en France, après Byzance et Sainte-Sophie en quelque sorte -ses formes hiératiques ne sont pas une origine de l’art roman-, selon un raccourci esthétique et chronologique. C’est le début irréductible de l’art authentique français, la « continuité du génie » qui va, selon Malraux, de la prise de Jérusalem (1099) à la mort de Saint-Louis (1270). Moins de deux cents ans, pour affirmer l’art chrétien occidental, une épopée, avec Moissac, oeuvre initiale et primordiale jusqu’à Chartres, oeuvre finale, ou de Moissac à Reims, voire de Compostelle à Novgorod, selon ses raccourcis géographiques[7].
D’autres chefs-d’oeuvre extra-européens ou extra-médiévaux sont également comparés aux sculptures de Moissac, mis en confrontation dans une sorte d’imaginaire mondialisé, à travers les photographies. Des chefs-d’oeuvre « tiennent » devant Moissac, selon l’expression de Malraux : et pourquoi pas la Dame de Brassempouy avec son « vieux mystère du regard », qui « nous parle », selon l’autre expression de l’écrivain.
Oui, l’art confronté, comparé, tient devant Brassempouy, Moissac, Chartres. Qu’est ce l’art, alors ? si ce n’est cette confrontation.
Djoser, cité quatre fois avec Moissac, sculpture du pharaon égyptien de la IIIe Dynastie, vers 2800-2700 avant J-C, qui a élevé la première pyramide à Saqqara et qui se trouve au musée du Caire ; de même les statues d’Elephanta, île de la baie de Bombay en Inde (voir illustration), avec sa Cosmogonie du VIIIème siècle, ou les statues d’Ellora avec la Déesse du Gange dans l’Andra Pradesh à la fois brahmanique, jaïnique et bouddhique du VIème-VIIIème siècles, voire la sculpture bouddhique des grottes de Chine intérieure de Yun-Kang ou Long-Men (voir illustration). De même, les peintures chères à Malraux de Le Tintoret, Le Gréco, Rembrandt et Picasso, donnent à penser sur Moissac : « Moissac approfondit Saint-Savin comme Rembrandt approfondit le Caravage » ; « (…) aucun Picasso ne peut sculpter le tympan de Moissac » [8].
Ajoutons les Goudéa sumériens du Louvre (2000 ans avant JC) ou les statues khmers d’Angkor du IXème au XIIème siècle qui ont joué donc, comme, répétons-le, le Tympan de Moissac, un rôle capital dans la formation artistique de Malraux, le « premier chef-d’oeuvre français », « en gros »[9].
Donc, osons le dire, dans la confrontation Byzance, Chartres et Moissac, Malraux ne cache pas son point de vue : le style roman est à tous points de vue supérieur aux styles byzantin et gothique.
III. Moins une copie, que le début historique du génie occidental, chrétien et français
Malraux lit les historiens d’art, sans vraiment les citer ; il est vrai que la réciproque est également vraie. Il connaît sur Moissac la thèse des rapports du Livre et de la sculpture avec les « miniatures copiées » par les sculpteurs de Moissac, ainsi la figure de l’Apocalypse de Saint-Sever ou le commentaire sur l’Apocalypse composé en Espagne par Beatus, abbé de Liebana. Cette thèse de l’historien d’art, très laïcisante, d’Emile Mâle, L’Art religieux au XIIe siècle en France, lue par Malraux, jugée éminente par l’écrivain, ne le satisfait pas. Emile Mâle, dans L’Art religieux du XIIe siècle en France, écrit notamment : « D’où vient donc ce tympan de Moissac, qui semble se présenter à nous sans ancêtres ? Est-ce une création des sculpteurs du XIIe siècle ? On ne saurait être tenté de croire quand on connaît l’Apocalypse de Beatus. (…) Voilà le modèle du sculpteur de Moissac ». Marcel Aubert, dans La Sculpture française au Moyen Âge, écrira encore : « (…) autrefois rehaussée d’or et de peintures, elle (l’Apocalypse du tympan de Moissac) apparaissait comme une immense fresque inspirée du Commentaire de Beatus, ainsi que l’a montré E. Mâle. » Henri Focillon, en 1938, dans Art d’Occident. Le Moyen Âge roman et gothique notait à propos du tympan de Moissac : « (…) à travers le commentaire illustré de Beatus qui lui servit de guide dans les détours de cette Divine Comédie de pierre, l’Apocalypse romane tressaille encore de terreurs du millénarisme. » Mais il affirme aussi, semblant annoncer Malraux : « (…) quelle distance, et pour la forme et pour l’inspiration, sépare les figurines des manuscrits, tracées à la pointe du calame, vivement enluminées et toujours graphiques, et les acteurs du drame surhumain taillés dans la pierre ! » [10].
Pour Malraux, l’art roman apporte un génie : c’est le plus parmi les autres arts, une majoration exceptionnelle ; il ne copie pas. Dans Le Surnaturel, Malraux écrit : « (…) il n’est pas question de reprendre les travaux, d’ailleurs éminents, qui ont relié les tympans aux enluminures : leur valeur est exclusivement historique. Pas un seul chef-d’oeuvre roman ne doit son art à une enluminure (…). L’idée que l’art du tympan de Moissac puisse venir d’une enluminure, fût-elle géniale, est inconcevable pour un sculpteur »[11].
Malraux, devant le tympan de Moissac, n’est pas historien. Une preuve supplémentaire parmi d’autres. La date pour les illustrations des statues du tympan est tantôt 1115, tantôt 1135, alors que le porche est réalisé selon une datation classique vers 1120-1125. L’essentiel de Moissac se trouve ailleurs, pour l’écrivain, que dans une étude chronologique précise. Néanmoins, dans le Musée imaginaire de la sculpture mondiale, il montre de façon précise la transformation des années 1100 à 1130 : le passage d’une sculpture chrétienne secondaire à la transformation d’un des plus grands arts du monde ; dans ce XIe-XIIe s., la chrétienté a peut-être changé de Christ (p. 1129). C’est donc une date capitale de l’histoire que le développement de cet art proprement historique : du tympan de Moissac à 1100 au premières statues sculptées de Chartres en 1145.
L’écrivain s’intéresse davantage au mythe de l’« instinct » et de la recherche de la « dissemblance », qui ressuscite le passé méprisé à Moissac vers 1833, et peut préoccuper davantage Malraux : il découvre mieux, il « éclaire » le « génie ». Pour « l’histoire du génie », l’art roman possède « l’Eternel de Moissac » et le « maître génial de Moissac ». La définition malrucienne de l’art roman inscrit Moissac dans le commencement d’une civilisation, une « mutation brusque », une « rupture », à peine moins profonde que le schisme de 1054, qui « prend l’éclat des passages privilégiés de l’homme ». « Lorsqu’ils (les tympans) surgissent, jamais la mémoire chrétienne n’a connu une oeuvre de cette nature, ni un relief de cette ampleur…un art sans précédent…(qui) proclame l’apogée de la chrétienté occidentale ». La continuité du génie fait apparaître « le premier chef-d’oeuvre roman », un « art majeur » : « …l’épopée qui commence avec Moissac et la prise de Jérusalem, et dont la mort de saint Louis annonce la fin. Non pas le pittoresque d’un bestiaire oriental, mais le premier grand style chrétien. ». Il s’agit d’une véritable « offensive occidentale » où la vie chrétienne s’ordonne en civilisation : Raoul Glaber parle de ces « blanches églises » comme un Américain de ses premiers gratte-ciel, un Russe, de ses premières centrales électriques. Nous l’avons compris : nous touchons alors les phrases essentielles de la pensée malrucienne sur l’importance des sculptures de Moissac.
Notons que Malraux, à travers cette réflexion sur les débuts d’une épopée à Moissac avec la prise de Jérusalem par les Croisés en 1099, rejoint la chronologie moissagaise : il est clair que la troisième date de la grandiose histoire moissagaise du XIe siècle -après 1047-1048, l’entrée dans l’ordre de Cluny et le 6 novembre 1063 et l’imposante cérémonie de consécration de l’église en présence d’un archevêque, sept évêque et l’abbé Durand de Bredon- est la visite à Moissac du pape Urbain II, pape de la première Croisade, le 13 mai 1096.
IV. Le sacré enfoui ou une oeuvre qui nous permet de lutter contre la mort
Indéniablement la Star de ce Musée nous pose une question « de façon plus obsédante que tout oeuvre » : la question de son langage. Elle nous parle, mais de quoi, d’art.
Nous devons aussi comprendre pourquoi ces sculptures moissagaises romanes des « maîtres de l’irréel » , des « créateurs d’apparitions », nous surprennent ou nous éblouissent, nous parlent aussi. Le sculpteur de Moissac n’est pas un vulgaire artisan ou « fabricant de poupées » : il crée un lien avec des formes moins artisanales que magiques. Les sculptures cachent le sacré que nous ne comprenons plus. Ils nous suggèrent obscurément un « microcosme », un « surmonde », l’« expression » du monde de Dieu ou de l’Eternel, « monde de vénération », et non de délectation. Des scènes et du sacré prennent place, avec cette « Bible des illettrés », la prédication et la musique sacrée grégorienne, qui unit les Vieillards de Moissac à l’Eternel, Moissac à Chartres, la Dame de Brassempouy au sourire de la statue gothique.
Nous avons une création d’un lieu, de formes, victorieux de l’apparence, « qui accordent les formes de la vie à la Vérité suprême qui les gouverne ». Ce surnaturel nous inquiète, avec sa poésie remplaçant la vénération. A Moissac, le Christ est l’Eternel, Dieu d’Abraham, face aux Vieillards : « ..l’Apocalypse, c’était Moissac ». Mais ce sacré s’humanise à partir de Moissac, avec ses Vieillards, « héraldiques et populaires » que Malraux prend pour des leudes, « barbets épiques »; avant d’introduire plus tard, à Chartres, des hommes dans le monde de Dieu. A Byzance, l’Eternel est sévère ; à Moissac, il commence à être un Pantocrator secourable : cette évolution par la suite continue vers l’humanité, l’humanisme, puis la mort de Dieu aux XIXème et XXème siècles[12].
La signification des formes de pierre à Moissac doivent nous faire saisir l’insaisissable, un ordre spirituel caché et énigmatique : « le commencement de ce qui ne se voit pas » selon saint Paul, ou le « sentiment du sacré, pour manifester l’inexprimable… ». En d’autres termes, les sculpteurs de Moissac nous proposent une « oeuvre de Vérité » ou création sacrée, qui « a pour raison d’être de transformer des signes en symboles, de leur donner vie par la manifestation de la vérité spirituelle que l’univers recèle et ignore, et qu’il appartient à l’homme de mettre au jour. Ainsi l’oeuvre accède-t-elle au sacré, devient-elle prémonition du monde de Dieu. »
Pour Malraux, l‘Apparition de l’Eternel de Moissac, comme le Roi de Chartres, ou la Dame de Brassempouy, nous permettent d’échapper à notre condition d’homme ; leur part d’intemporalité arrache quelque chose à la mort. Quoi qu’il arrive, Jérémie nous parle en 2007. C’est un absolu, une part divine qui dépasse notre histoire, proposée à notre destin : « …le Dieu du Musée Imaginaire, c’est l’Inconnaissable; et d’abord la lutte contre la mort. »
Face à cette spiritualité, le Bonze bouddhiste répond à la question de Malraux
« Chartres ne vous a pas ému ?
– Beaucoup. Par la hauteur de la salle : nous n’avons rien de semblable. L’honorable vide. » (Antimémoires, Le Miroir des Limbes, p. 432).
V. La Préhistoire, le Moyen Age et la Seconde Guerre mondiale
La vie de l’écrivain est obsédée par sa propre Grande Guerre, comme son père a été marqué par la tranchée et le gaz : de la Guerre d’Espagne à la Libération de l’Alsace 1936-1945. Des éléments biographiques se fondent entre le décor des grottes ou du Moyen Age, l’art, et les événements dramatiques du XXe siècle : la déclaration de guerre du 3 septembre 1940, les prisonniers de guerre de juin 1940, le maquis corrézien début 1944, les combats d’Alsace dans sa brigade Alsace-Lorraine fin 1944, enfin la libération des camps du printemps 1945 de Ravensbruck à Mauthausen. Pendant l’Occupation, Malraux trouve dans la réflexion sur l’art, un refuge et une pause, à travers même son action fulgurante d’écrivain-combattant : un des plus grands intellectuels-combattants de notre histoire de France.
Tout le monde connaît la citation et les citations à propos des grottes de Lascaux retrouvés par des gosses en septembre 1940, qui deviennent par la suite le refuge des maquisards ; au-dessus les Allemands passent. La « nuit préhistorique » rejoint les années noires, ou plutôt lumineuses de l’amitié, du combat, de l’héroïsme jusqu’à la mort. Lascaux est alors supérieur à la Dame de Brassempouy pour évoquer l’inhumanité et l’humanité du combat pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, son combat de maquisard en Corrèze peut de transposer symboliquement dans la Dordogne préhistorique de toute éternité.
Un tympan roman, celui de l’abbaye Saint-Pierre de Beaulieu-sur-Dordogne, en Corrèze, que l’on confond parfois avec l’abbaye cistercienne du Tarn-et-Garonne -erreur répétée dans l’édition de la Pléiade-, nourrit une relation personnelle forte, mais imaginaire avec l’auteur. Dans Les Noyers de l’Altenburg, Vincent Berger, alter ego de l’auteur raconte avoir appris à Beaulieu sur Dordogne, dans le Quercy, dit-il, en vérité en Corrèze, la déclaration de guerre en 1939, expérience que Malraux reprend à son compte dans les Noyers de l’Altenburg, d’une part, écrit pendant la guerre, et les Antimémoires, d’autre part (1967-1976) :
« Il y a neuf mois, j’étais dans un hôtel du Quercy. Les servantes ne quittaient plus la radio. C’étaient de vieilles femmes. Un matin, j’en croisai deux dans l’escalier : elles montaient dans leur chambre en courant, à petits pas, et les larmes ruisselaient sur leurs faces patientes. Ainsi ai-je appris que l’armée allemande était entrée en Pologne ».
« L’après-midi, j’avais vu, à Beaulieu, les affiches de la mobilisation. L’église de Beaulieu porte l’un des plus beaux tympans romans, le seul où le sculpteur ait figuré, derrière les bras du Christ ouverts sur le monde, ceux du crucifix comme une ombre prophétique. Une averse tropicale avait nettoyé le village. Devant l’église est une statue de la Vierge ; comme chaque année depuis cinq cents ans, pour fêter les vendanges, les vignerons avaient attaché à la main de l’Enfant une des plus belles grappes. Sur la place déserte, les affiches décollées commençaient à pendre ; les gouttes d’eau sur la grappe avaient glissé de raisin en raisin et étaient tombées à petit bruit au milieu d’une flaque l’une après l’autre, dans le silence »[13].
Ce texte est troublant. Malraux apprend la déclaration de guerre le 1er septembre 1939, non à Beaulieu mais à Nîmes. Mais quelques jours avant, il semble effectivement s’arrêter à Beaulieu selon le témoignage de Josette Clotis, dans une atmosphère de danger de guerre, après la signature le 23 août, du pacte germano-soviétique : semaine une des plus fortes du XXème siècle, voire de l’histoire de France (23 août-3 septembre 1939).
En 1943, dans son refuge corrézien de Saint-Chamant près de Brive, il se trouve à portée de ce chef-d’oeuvre comme des grottes, au moment où Malraux prend le temps d’écrire une des oeuvres principales intitulée « Psychologie de l’art » qui le hante depuis le début des années 1930.
Ce n’est pas tout ; la défaite de l’action arrive ou le « chaos de la défaite ordonné ». Dans un chapitre, l’effroi des prisonniers de guerre de juin 1940, comme un troupeau amorphe de vaincus, se retrouve avec pour horizon une première cathédrale : celle de Sens, « suspendue dans la nuit », dans un spectacle de tanks allemands et d’incendie des réserves d’essence de l’armée française, allumées au dernier instant de la retraite (p. 784). Puis c’est « Chartres 21 juin 1940 » : sur les routes de l’exode, les Allemands conduisent des milliers de prisonniers dans des camps improvisés, par exemple celui de Chartres, jusqu’au « vaisseau » . Cette description dans les Noyers de l’Altenburg nous fait rentrer dans le monde concentrationnaire du XXème siècle -même si la détention du prisonnier de guerre n’est pas l’apocalypse du « camp de concentration » nazi-, et cela, au pied des statues-colonnes du portail. Le Portail Royal est enfoui dans les sacs de sable, mais les portes sont ouvertes. Le vaisseau de Chartres, que le narrateur ne reconnaît pas est en construction : il a perdu ses vitraux, évacués. Un Allemand, parmi les tanks, parle de Bamberg, la Chartres allemande ; l’écrivain ajoute « Misère de retrouver notre part fraternelle entre les appels de nos blessés vers l’infirmier et le bruit de ces bottes qui s’éloignent ! ». Surtout, les prisonniers, hagards et tenaillés par la faim, attendent d’écrire ; ils sont alors des « visages gothiques » (1948), comme les « supplications des mendiants de naguère près du porche » sur ces « dalles de Saint-Louis » (pp.624-630). Après avoir évoqué le rôle de l’intellectuel – pas seulement celui à qui les livres sont nécessaires, mais tout homme dont une idée, si élémentaire soit-elle, engage et ordonne la vie-, le camp de Chartres lui donne l’occasion d’une présence du Moyen Age, une Cour des Miracles moderne : « Dès les premiers temps de la guerre, dès que l’uniforme eut effacé le métier, j’ai commencé d’entrevoir ces faces gothiques. Et ce qui sourd aujourd’hui de la foule hagarde qui ne peut plus se raser n’est pas le bagne, c’est le Moyen Age. (…) peut-être parce que le Moyen Age s’est chargé de représenter les hommes et que nous ne sommes pas dans un endroit d’où sortent les dieux. Mais le Moyen Age n’est pas le masque de leur passé, si long qu’il fait rêver d’éternité. » (p. 629)
Mais la transfiguration va plus loin. Malraux se rappelle du visage de Bernanos quand a parlé des camps d’extermination : « Satan a reparu sur le monde » (p. 593, Antimémoires). La Préhistoire n’est jamais loin, mais aussi la cathédrale.
C’est de Chartres, sur le parvis devant le Portail Royal que Malraux a décidé de prononcer un de ses fameux oraisons funèbres, celui du trentième anniversaire de la Libération des camps de déportation, le 10 mai 1975, à propos des femmes déportées et combattantes de la Résistance féminine face à la Gestapo, puis le crématoire pour les femmes et les enfants. Ce jour, le portail royal est réinventé, face à Satan du XXe siècle : « la plus terrible entreprise d’avilissement ». Celui du Moyen-Age est luminosité et force : « Dante, banalités ! Là, pour la première fois, l’homme a donné des leçons à l’enfer ». Mieux le patriotisme du Moyen Age se fond dans celui des femmes, les plus inconnus, les plus humbles et les plus fidèles de France à travers la Résistance : « Portail royal en qui depuis huit cents ans bat l’âme de notre pays, je viens de t’apporter le plus humble témoignage de la France » « Symbole mystérieux, les huit mille personnages de la cathédrale voient, sur sa face accablée, les huit mille prisonnières qui ne sont pas revenues. Dans cette cathédrale où furent sacrés tant de rois oubliés, qu’elles reçoivent avec toi le sacre du courage. » (pp. 968-969).
Conclusion :
La prise de conscience et la mise en question de l’art préhistorique et moyenageux chez Malraux nous aident à mieux comprendre la culture, la présence même de cette culture dans notre vie, en prendre davantage conscience : un véritable existentialisme par l’art.
La Dame de Brassempouy, l’Eternel de Moissac, les Rois de Chartres « tiennent » lorsque nous les confrontons dans notre intelligence humaine et spirituelle. Ces trois oeuvres nous parlent
Le fin mot de sa réflexion est de révéler la « métamorphose », de toute oeuvre sacrée en oeuvre d’art, d’un âge préhistorique ou moyen à un âge contemporain, qui ouvre une voie à notre propre destin face à la mort. Que deviennent finalement pour nous la chevelure, suggérée par un « carrelage » de « la plus vieille tête sculptée du monde » les couleurs du vitrail ou les sculptures du tympan? Arrache-t-on une part humaine de noblesse, de liberté, de dignité, de vie même face à la mort, face à cette création géniale de Brassempouy, Moissac à Chartres ? Les « significations du monde » peuvent y être recherchées : le sens de la vie et de notre vie.
Pourquoi cette vie imprévisible de l’oeuvre du sculpteur anonyme, il y a 30.000 ans ou artiste des XIème-XIIIème siècle en trois temps -apparition sacrée du XIème au XVème, disparition dans la grossièreté ou la « maladresse » du XVème jusqu’au début du XIXème qui redécouvre la statuette ou la statue -1833 exactement pour Moissac, 1894 pour Brassempouy-, et réapparition sans mourir depuis, et jusqu’à nos jours- (p. 261)?
La métamorphose des dieux d’André Malraux nous proposent un cheminement en trois temps : le « Surnaturel » ou « moyen de création d’un univers sacré », monde de la foi ; l’ « Irréel » où la poésie succède à la foi, et parfois l’idéologie ; enfin, l’ « Intemporel », art qui n’a d’autre fin actuelle que lui-même, à travers musées, reproductions, médias (p. 1424, note de la page 250). Malraux reprend alors l’analyse de Maurice Denis de Cézanne : « Devant Cézanne, nous songeons seulement à la peinture ; ni l’objet représenté ni la subjectivité de l’artiste ne retiennent notre attention » (M. Denis, Théories in Conversations avec Cézanne, p. 168 – V, note p. 1479.
Attention, un art qui ne nous aide pas à vivre aujourd’hui -ex le XVIIIe siècle classique ou baroque trouvant l’art médiéval grossier ou barbare-, aidera peut-être à vivre d’autres hommes. Malraux insiste « et avons appris à respecter dans les musées la présence endormie de ces passions futures » (p. 1195).
Moissac, pour quatre fortes raisons -importance du nombre des 113 citations sur Moissac dans l’oeuvre d’André Malraux, chef-d’oeuvre du Tympan roman d’échelle universelle qui pousse à toutes les comparaisons esthétiques, oeuvre « géniale » et première de l’art chrétien occidental, sacré enfoui qui nous permet d’arracher un sens à notre vie face à la mort- nous permet de relier l’aventure « spirituelle » que nous propose le « génie ».
La Préhistoire commence avec la Dame de Brassempouy et se termine dans la Chapelle Sixtine de Lascaux : Dame qui a dix mille ans d’avance sur les bisons de Lascaux : Malraux ajoute toujours cette remarque chronologique. Le Moyen Age ou surmonde chrétien commence à Moissac, finit à Chartres, commence avec la première Verge Noire pour s’achever à la fin du grand gothique ; l’art gothique est dépassé à Assise par Giotto. Mais l’art roman a sa préférence peut-être sur l’art préhistorique et sûrement sur l’art gothique ou byzantin : l’Eternel pantocrator a sa faveur face au « vieux mystère du regard » de la Dame ou au sourire de l’Ange de Reims : l’expression la plus pure et la plus profonde de la civilisation occidentale.
Ensuite, ce sera la technique comprise, architecture comprise, âme comprise, poursuite une incarnation (p. 1157, Musée imaginaire de la sculpture mondiale). Le sourire grec est inhumain ; le sourire de l’ange de Reims libère et Giotto reprend cette libération humaine dans le Trecento de la souffrance (et des tragiques événts de la fin du Moyen Age), reprise par la suite à la Renaissance (pp. 463-465).
On s’en aperçoit : l’art préhistorique et médiéval est un véritable langage ; il faut parvenir à comprendre ses sentiments des premiers spectateurs, non le laisser un peu se métamorphoser au Louvre ou au Musée d’Archéologie nationale : ne pas passer d’une contemplation de l’objet unique à l’abandon distrait ou violent devant un spectacle reproduit à l’infini, lui donner du caractère, lui donner un surplus d’âme, autrement dit, réaffirmer cette banalité que l’art médiéval fut, au XI-XIIIe siècle, à la fois moderne et une foi, une présence exceptionnelle de notre civilisation, un je ne sais quoi de plus qu’une oeuvre d’art, et ce supplément d’âme, Malraux a voulu s’y confronter avec tout son caractère et sa personnalité de premier plan, d’aujourdhui et de demain (p. 260, 1194).
Enfin, dernier point, si la dame de Brassempouy, le tympan de Moissac, la cathédrale de Chartres s’unissent dans notre admiration, notre plénitude, notre étude affirme aussi avec Malraux que la part éternel de l’homme est à la fois plus humble, plus solitaire, et plus profonde que ces éclatantes conquêtes. L’art nous aide à bien vivre, seul ou avec les autres, avec notre foi ou nos silences. Il n’y a pas de style éternel ou neutre, mais le passage fulgurant ou génial de l’humanité, anonyme aussi avec ce sculpteur médiéval : échapper à notre condition d’homme par l’art, non par l’évasion, mais par la possession d’un destin. L’art préhistorique et médiéval, son héritage répond à quelques unes de nos questions fondamentales, et déjà sa différence et sa totalité, un véritable présent s’offre à nous dans l’espérance et à la volonté face à toutes les formes de fatalité (640, 1192 « l’héritage culturel » texte fondamental de 1936, que l’on retrouve vingt ans plus tard dans les Voix du Silence) : l’art et préhistorique médiéval occidental, génial et imprévisible, de Brassempouy à Moissac jusqu’à Chartres ou Reims, en passant par Saint-Germain-en-Laye : donner consciences aux êtres d’une dignité et une grandeur à l’humanité qu’ils ignorent eux-mêmes.
Autrement dit, les jeunes gens des banlieues, déracinés, qui se détruisent et détruisent aujourd’hui de façon suicidaire et intolérable les lieux de culte et de culture dans nos cités, doivent redécouvrir cet art, cet amour, cette paix, cette conquête humaine et divine du centre-ville préhistorique et médiéval, qu’ils ont la chance d’avoir à portée de RER ou de métro : la transmission de notre héritage culturel est en jeu au XXIe siècle en France, siècle qui doit être religieux ou culturel, ou qui ne sera point ; cet héritage culturel ne se transmet pas pour beaucoup, il se conquiert, selon la fameuse expression de Malraux si actuelle pour l’éducation de notre jeunesse.
L’art nous permet de transformer notre destin en conscience, sortir de nos fatalités biologiques, économiques, sociales, psychologiques, fatalités de toutes sortes, les concevoir d’abord, pour les posséder ensuite, étendre jusqu’aux limites des connaissances humaines la matière artistique ou autre, dans laquelle l’homme puise devenir davantage un homme, « la possibilité infinie des réponses à ses questions vitales » ou recréer un plus grand destin, nous intellectuels, chrétiens, libéraux, nationalistes, socialistes, juifs ou musulmans -en 2007, comme demain-, malgré les idéologies qui nous divisent, cherchons les « volontés » qui nous unissent, et cela avec la foule, sa recherche de communion et de grandeur -et non de folie ou de bassesse- : le monde séculaire médiéval de la haute pensée et de toute oeuvre d’art, avec sa possibilité infinie de réincarnation, ne prend son sens que dans la volonté présente des hommes, de tous les hommes (p. 1196-1199). Tout est dit dans cette fameuse phrase pour nous :
« La question que posent la tête de Brassempouy (et la Dame d’Elche) ne contredit celles que posent les statues de Chartres, mais elle lui donne son sens plein » (p. 1016)
C’est-à-dire une tentative de perception du mystère face à l’éternité du ciel nocturne ou de la nuit préhistorique ou même mérovingienne : la noblesse que les hommes ignorent en eux, la part victorieuse du seul animal qui sache qu’il doit mourir (p. 745, Les Noyers d’Altenburg, camp de Chartres). En ce sens, cette réponse de l’art à notre question initiale face au néant, à la violence, au cynisme, doit être expliqué à notre jeunesse et à l’humanité. L’Europe essaie d’inventer un « Moyen Age universel » ou langage universel par l’art (Antimémoires, p. 882), un très vieux dialogue à approfondir dans notre Kaléidoscope personnel de mystérieuses présences et visions : de Lascaux à Chartres pour Malraux, entre autres (892), et en ce qui nous concerne plutôt et plus particulièrement, du vieillard sur le tympan de Moissac à la tête de Saint-Louis dans la chapelle royale de Saint-Germain-en-Laye.
François BOULET,
Saint-Germain-en-Laye, le 17 septembre 2005, 13 -28 novembre 2005, 4 novembre 2006
ANNEXE :
les 113 citations d’André Malraux sur Moissac
Ecrits sur l’art, tome I, Oeuvres complètes, tome IV, La Pleiade, 2004
Les Voix du silence
p. 234, VS, Le Musée imaginaire, « Comme le sont les tympans où le Christ est encore tout engagé dans son Père, où Création et Jugement précèdent l’Evangile ; comme à Moissac où la foule mortelle s’établit sous un Christ de Majesté en prenant la forme des Vieillards de l’Apocalypse. Bientôt le Christ sera le Fils de l’Homme, et le sang de ses mains trouées fera lever de l’ardente abstraction des Genèses une moisson familière de métiers humains ; les vignerons et les cordonniers des verrières de Chartres prendront la place des damnés d’Autun, des vieillards de Moissac (…). »
p. 417, VS, Les Métamorphoses d’Apollon, « L’opposition fondamentale qui devait séparer Moissac de Byzance, comme elle sépare la pensée pontificale de celle du Cérulaire, naquit de ce que pour l’Occident, le style byzantin ne fut pas l’expression d’une valeur suprême, mais un décor. »
p. 438-440, VS, idem, « Les deux figures féminines de Toulouse, dites les Signes du Zodiaque sont assurément une oeuvre d’art, mais sans descendance ; la fécondité n’est pas à Saint-Sernin, elle est à Moissac. La réussite des figures de Saint-Paul-lès-Dax qui viennent de l’orfèvrerie ne suscite rien : la fécondité est à Hildescheim. La création romane, comme toute autre, se définit par ce qu’elle apporte et non par ce qu’elle copie ; et ce qu’elle apportait nous est devenu clair par son ensemble d’abord, par le gothique qu’elle apportait, ensuite. Elle ne tendait ni à sculpter des gargouilles en forme de dragons scandinaves, ni à maintenir le style des fibules wisigothes, et les « influences » qu’elle subit ne nous rendent nul compte du génie de Gislebert d’Autun, des anonymes rhénans, des maîtres du Portail royal de Chartres ; elle tendait à donner aux Vieillards byzantins l’accent de ceux de Moissac, au Baiser de Judas, l’accent qu’il trouve à Saint-Nectaire. Des formes qui concourent à la naissance de l’art roman, aucune ne s’efforce de rétablir son passé : barbares, orientales, surgies du vieux fond paysan – et même, autour de la Méditerranée, du fond antique- elles sont alliées contre un ennemi commun : Byzance. »
Illustrations, p. 440, Moissac (vers 1115)- Vieillards de l’Apocalypse
p. 445, VS, idem, « Tels Vieillards de Moissac semblent de ces figures, -converties… »
p. 448, VS, idem, « A Moissac, à Autun, à Vézelay, le Christ domine encore le tympan par sa dimension, par son lieu, par la fascination qu’il semble exercer sur chaque ligne ; mais avant tout parce qu’il est devenu le sens visible des prophètes, des morts et des vivants qui l’entourent ou le contemplent, des signes du zodiaque[14] qui ne seraient sans lui que des astres absurdes. »
p. 451, VS, idem, « … la victoire de cette figure du nouveau christianisme est d’autant plus assurée que pour maints sculpteurs elle va bientôt s’incarner, que pour ceux de Reims elle est déjà incarnée : le roi le plus puissant de l’Europe, c’est Saint Louis. Il ne s’agit plus du Christ de Moissac, Pantocrator roman. L’homme chrétien trouve son harmonie. Ce visage couronné que les sculpteurs imposent maintenant au portail des cathédrales, ce visage où pour la première fois se confondent pouvoir, compassion et justice, c’est celui que leurs rêves pourraient prêter au roi de France. »
p. 453, VS, idem, « Figurer sans sacrilège les personnages divins n’en était pas devenu plus facile. Le Christ de Vézelay, d’Autun, de Moissac, immense au centre d’un microcosme, était Christ par définition ; mais le Christ gothique, engagé dans des scènes biographiques, pressé de personnages qui d’année en année se particularisaient, comment rendre sensible sa nature divine ? »
p. 523, VS, La Création artistique, « Le grand artisan mythique est lié à l’apogée des cultures religieuses ; mais une époque de foi – un monde où les dieux sont présents- crée entre l’artiste et ce qu’il figure un lien moins artisanal que magique. L’humilité des sculpteurs de Moissac ou de Yun-Kang n’est pas la modestie d’un fabricant de poupées (…). »
p. 529, « (…) peintres et sculpteurs, chaque fois qu’ils étaient grands, transformaient les oeuvres qu’ils avaient héritées -modifiaient les formes, et pas n’importe lesquelles, et pas la nature- et l’invention du Christ de Moissac, des Rois de Chartres ou d’Uta est irréductible à la satisfaction de l’ébéniste qui vient d’achever un bahut parfait. »
p. 642, VS, idem, « Le maître de Moissac est-il si proche parent de celui de Vézelay ? Mais ils ne sont pas de la même école, de la même province ; le maître de Vézelay est-il si proche de Gislebert d’Autun ? N’y a-t-il pas entre les sculpteurs de Toulouse, de Moissac, de Beaulieu, et l’énigmatique personnage qui commence à surgir sous le nom de maître de Cabestany, autant de différence qu’en Matisse, Rouault et Picasso, compte tenu de l’individualisme moderne ? »
p. 683, VS, idem, « D’où la modification insensible, mais profonde, subie par la notion de chef-d’oeuvre. Si confuse qu’elle soit devenue, nous n’admirons pas de la même façon les Vieillards de Moissac et une statue romane quelconque. »
p. 817, VS, La Monnaie de l’absolu (présence impérieuse) « C’est évidemment celle de l’artiste, même dans les plus hautes créations, car le sens cosmique le plus profond ne suffit pas à inventer le style de la Nouvelle-Irlande, ni la foi la plus profonde, à sculpter les Vieillards de Moissac ; mais cette présence est aussi celle d’une prise de conscience de l’univers. Toute différente de la nôtre, étrangère à l’histoire, mais lien avec le cosmos et non abandon au chaos ; conquête et non soumission ».
p. 822, VS, idem, « Nous croyons parfois imaginer un chef d’oeuvre symbolique de l’art roman, dans un brouillard semblable à celui qui entoura au XVIIe siècle les chefs-d’oeuvre de l’ « antique ».Ces derniers ne ressemblaient pas à ceux de Phidias ; le premier unit dans son éclat supposé l’artisanat roman, la convention romane, tout ce que nous suggère le mot roman par son abstraction : mais il n’est ni le tympan d’Autun, ni celui de Moissac, ni celui de Vézelay, ni même celui de Cabestany. Il est le chef-d’oeuvre qui n’existe pas. »
p. 868, VS, idem, « Existe-t-il des formes qui n’expriment rien…. Et les formes que transmettait le Musée imaginaire n’étaient pas des formes de la vie : les Vieillards de Moissac, les figures précolombiennes, les mosaïques de Ravenne n’étaient pas des documentaires. Or, si les arts plastiques ne peuvent pas plus être seulement représentation qu’ils ne peuvent être seulement signes ; si le génie n’est ni réussite ni accident, mais exercice d’un pouvoir d’autonomie, comment ce pouvoir, nécessairement conquis, n’eût-il pas été orienté ? »
Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale,
I. La Statuaire
M.I.S. p. 996
« Equivoque inévitable si l’on désigne par le même mot la production gracieuse ou parée de Falconet, et la création des maîtres d’Autun et de Moissac. C’est elle qui fit voir dans l’art la production « en mieux » – et dans un chef-d’oeuvre, un navet réussi. »
p. 1117, illustration Apocalypse de Saint-Sever.
M.I.S. p. 1117-1118, III. Le Monde chrétien
« A la question : « Pourquoi le maître de Moissac et Gislebert d’Autun ont-ils sculpté ainsi l’Apparition de l’Eternel et le Jugement dernier ? » on a d’abord répondu : Parce qu’ils étaient incapables de représenter les formes humaines. » Puis : « Parce qu’ils voyaient ainsi les formes humaines. » Puis : « Parce que leurs formes étaient l’expression instinctive de leur foi. » Enfin : « Parce que l’enluminure les leur suggérait, et que l’architecture les leur imposait. »
L’étude de l’enluminure a libéré la sculpture médiévale du mythe romantique. Elle a substitué les filiations à l’instinct. Mais ces filiations s’appliquent avec moins de rigueur à la composition qu’aux thèmes et à l’iconographie, et ne s’appliquent pas du tout aux formes : la célèbre figure de l’Apocalypse de Saint-Sever, sans doute à l’origine du tympan de Moissac, n’en éclaire en rien le génie[15].L’historien s’attache à la ressemblance entre les deux oeuvres ; l’artiste, à leur dissemblance. A ses yeux, le tympan n’est nullement cette enluminure, sculptée : mais bien sa métamorphose en sculpture (et en chef-d’oeuvre). Pour lui, la Vision de saint Jean est moins que les cartes postales d’Utrillo, Le Magasin pittoresque du Douanier Rousseau, les maquettes de Poussin. (p.1118) Si l’enluminure a suggéré la mise en scène de l’Apocalypse de Moissac, elle n’a suggéré ni son style, ni même sa composition ; et ce qui retient l’artiste, c’est précisément que, de la Chanson de Roland fixé au tympan de Moissac, rien ne figurait dans les images de Saint-Sever.
Mais la reproduction, les expositions surtout (les manuscrits à peintures antérieurs au XIIIe siècle, écartés de l’exposition de la Bibliothèque nationale en 1904, figuraient encore en petit nombre à celle de 1926), la connaissance des fresques romanes et de quelques fresques carolingiennes, commencent à faire de l’enluminure beaucoup plus qu’un objet d’étude. L’artiste, qui ne trouvait pas dans l’Apocalypse le génie de Moissac, ne le trouve pas davantage dans l’Evangéliaire de Blois, le Pontifical de Winchester, le Psautier anglo-saxon ou celui d’Utrecht. Mais ceux-ci ne sont plus des documents historiques, traces ou origine d’une filiation : ils apportent la peinture d’un temps proclamé sans peinture, l’art d’un temps proclamé sans art. Et la cohérence de leur style, la puissance de leur création, mettent en accusation le sentiment général – plus profond que toute théorie- qui voit dans le linteau de Saint-Genis, grosse orfèvrerie de pierre, l’enfance de l’Apparition de l’Eternel, et dans les chapiteaux de Saint-Benoît-sur-Loire, celle du Jugement Dernier d’Autun.
Nous appelons époque romane le temps où la vie chrétienne s’ordonne en civilisation, et où l’union de l’architecture avec la sculpture, la peinture, et les arts qui vont devenir mineurs, prend l’éclat des passages privilégiés de l’homme. Alors paraît en sculpture la continuité du génie que retrouveront la Renaissance italienne, la musique allemande, la peinture française ; non pas une école, à laquelle l’archéologie a attribué le Portail royal de Chartres et ne l’attribue plus, mais l’épopée qui commence avec Moissac et la prise de Jérusalem, et dont la mort de saint Louis annonce la fin. Non pas le pittoresque d’un bestiaire oriental, mais le premier grand style chrétien. Et peut-être les sources de ce bestiaire, et même de son accent, ne sont-elles pas celles du génie roman. »
MIS p. 1120
Ces pièces rapportables (et, à Compostelle, rapportées), maladroites comme les apôtres du déambulatoire de Saint-Sernin, ou fort adroites comme le chapiteau de Fromista, ignorent encore la grande prédication romane. Pour qu’elles semblent la préparer, il faut voir en elles un chaînon entre la « sculpture primitive » et Moissac ».
(…) ou à l’Apparition de l’Eternel.
MIS p. 1125, 1129
(Au temps mérovingiens, …stuc de Spiez, chapiteau de Poitiers) Cette sculpture (qui ne devient jamais un style) ne porte en elle ni Moissac, ni Vézelay, ni Autun ; on la retrouvera jusqu’à Zamora, jusqu’au diable / de Siones- et beaucoup plus tard… Elle ne porte en elle-même que sa propre fin. L’art roman n’en est ni l’enrichissement ni la maturité (…). »
MIS, p. 1130, « L’art roman va dresser au tympan des églises ce Dieu qui ne quittait le sanctuaire que pour des sorties d’idole. Rupture à peine moins profonde que le schisme. (…) L’appel qui commence aux tympans va couvrir les façades entières de Poitiers et d’Angoulême, bientôt tout le portail de Saint-Denis (…) Le génie chrétien devient celui de l’offensive occidentale. Raoul Glaber parle de ses blanches églises comme un Américain de ses premiers gratte-ciel, un Russe, de ses premières centrales électriques. Jérusalem prise bénit les premiers tympans, les moines guerriers protègent le Sépulcre, et la sculpture romane semble celle de l’Eglise militante… (…) l’Apparition de l’Eternel (…)
MIS, p. 1131, « Mais que le cortège de chimères qui accompagne la gloire du Christ ne nous égare pas : si pour l’archéologie, l’art roman est légitimement ce bestiaire, pour l’histoire du génie, il est l’Eternel de Moissac. L’Eternel qui arrachera les chimères au rêve, pour les prendre entre ses mains secourables (…). »
MIS p. 1141
« Le répertoire des formes peintes sur les murs et dans les manuscrits -qui connaissait l’union du pathétique et de l’expression sacrée- n’est ni moins étendu, ni moins complexe, au temps où l’on ébauche à Moissac l’Apparition de l’Eternel, que ne va le devenir celui de la sculpture romane elle-même. »
MIS, p. 1142
« Nul n’égale les maîtres de Saint-Savin à ceux de l’Apparition de l’Eternel, à ceux du Portail royal. »
MIS p. 1146
« Si l’on tient pour assuré qu’une peinture dont les traces ne sont pas toutes effacées fut familière aux maîtres de la sculpture romane ; si l’on sait que sa relation avec l’enluminure s’étendait, pour les oeuvres clunisiennes, jusqu’aux procédés, comment écarter de la création romane la présence de l’étrange musée formé par les bibliothèques des couvents et les Trésors des églises ? Le sujet de Moissac reprend celui de la mosaïque d’Aix-la-Chapelle (…)
MIS p. 1154-1155
« Que l’on pense à Sainte-Sophie ou aux minuscules églises byzantines de Grèce : la façade (le mot architecture ne suggère qu’une façade aux Occidentaux …) et la sculpture paraissent se dégager ensemble de l’édifice, sortir ensemble du sanctuaire. La sculpture médiévale deviendra très tard décoration : elle connaît l’ornement dès son origine, mais le génie chrétien naît quand les tympans cessent d’être décoratifs. Ceux de Moissac, de Conques, de Vézelay, d’Autun, en décorent si peu la façade, qu’ils sont invisibles de loin. Lorsqu’ils surgissent, jamais la mémoire chrétienne n’a connu une oeuvre de cette nature, ni un relief de cette ampleur. Il ne s’agit pas d’un changement dans la décoration de l’église : un art sans précédent (le vitrail, lui aussi, est un art sans précédent) proclame l’épopée de la chrétienté occidentale.
Que sont ces tympans ? Des sculptures ? Que pouvait/
1155
signifier ce mot, de la prise de Jérusalem à la seconde croisade, du déambulatoire de Saint-Sernin aux premières figures du Portail royal ? La chrétienté ne connaissait pas de « sculpture » ; elle connaissait des ivoires, des orfèvreries, des chapiteaux, et quelques statues – si le mot statues convient aux majestés et aux crucifix. (En marge, les figures païennes…) Les tympans représentaient des scènes ; un fond les limitait. Ils étaient des tableaux – les premiers d’Occident. Ils en inventaient jusqu’au cadre ; ce qui eût suffi à séparer leur art de celui des chapiteaux. Et ils ne continuaient pas les récits qui couvraient les parois et les voûtes, ils succédaient aux fresques des absides, aux symboles fondamentaux qu’ils plaquaient sur la muraille comme les blasons de Dieu. Mais ils faisaient à ces fresques recluses un don royal : les ombres.
Ne le confondons pas avec le don de l’illusion. Le temps de l’apparence n’était pas encore né ; le style, les dimensions différentes des personnages, écartaient l’imitation comme l’avait fait la mosaïque. A leur naissance, Autun et Moissac, peints comme Saint-Savin ou bariolés comme Tahull, ne paraissaient pas plus réalistes qu’aujourd’hui. L’intensité que leur donnèrent les ombres ne fut pas celle de l’illusion, mais la transcendance que le vitrail allait donner aux couleurs ; elles apportaient à la prose de la fresque l’accent du poème. Toutes la peinture chrétienne était à deux dimensions, partout. On ne découvrait pas la profondeur de l’espace, dont l’art roman ne se souciait pas ; mais la profondeur de l’accent. Car le haut-relief (avec lequel le génie roman coïncide presque…) projetait une ombre très différente des cernes du bas-relief, une ombre qui estompait le contour au lieu de le souligner : Moissac approfondit Saint-Savin comme Rembrandt approfondit le Caravage. Les volumes orchestraient soudain la mélodie élémentaire de la couleur, la mélodie linéaire du dessin. Ils accordaient les figures de l’abside et du livre à la lumière changeante des heures, comme le fond d’or avait accordé le Pantocrator à l’éternité des ténèbres étoilées de cierges. Après huit cents ans, l’invention des grands tympans polychromes à registre et à sujet central, la haute ambition de leur art, répondaient à l’invention des grandes mosaïques, dont ils retrouvaient la grandeur et le prestige. L’homme entré dans l’histoire avec les croisés condamnés de Pierre l’Ermite venait (a p. 1534 : avec les Croisés en haillons de Pierre l’Ermite et les chevaliers libérateurs du Saint-Sépulcre, venait, dactyl. 1) de découvrir son art majeur.
MIS p. 1157
Illustrations p. 1157, 1110-1120 – Vieillards de l’Apocalypse – Tympan de Moissac
Il n’était pas inéluctable que la peinture en haut relief fût au service de la lumière. En Asie, elle a souvent joué le rôle que joue à Byzance la mosaïque. Mais la chrétienté change de surmonde. Depuis la première Vierge Noire jusqu’à la fin du grand gothique, le génie occidental, technique comprise, architecture comprise, âme comprise, poursuit une incarnation. Il passe de l’Apparition de l’Eternel au Portail royal (puis au Triomphe et à la Mort de la Vierge), par un chemin qui devient discernable lorsqu’on le voit partir des figures chrétiennes inventées à Byzance et non de la forêt mérovingienne ou de la Rome antique – lorsque, écartant les personnages idéalisés, nous rapprochons les anges d’Autun et les Vieillards de Moissac, des anges et des seigneurs byzantins.
Les leudes de Moissac, barbets épiques, suivent les Vierges Noires comme une meute fidèle (a. Dans dactyl. 1, p. 1534, le passage qui précède, depuis grand gothique, (11 lignes plus haut), formé d’un ajout manuscrit, se présente comme suit : le génie chrétien poursuit une Incarnation – technique comprise. L’émerveillement franciscain des élus et des anges d’Autun, l’accent des Vieillards de Moissac, rendus naguère invisibles par l’esthétique de l’illusion, retrouvent leur sens dès qu’on ne les compare plus à des personnages imaginaires mais à des anges ou à des seigneurs byzantins./ Le petit peuple des tympans avec ses vieux guerriers francs, ses personnages qui dorment à l’ombre de leur pied unique, et ses innocents du dernier jugement, investit l’Eternel de Moissac jusqu’au jour où son fils devienne (sic) le Christ de Chartres, où l’art roman voit le Portail royal rejeter son bestiaire et accomplir son génie … / Accomplissement indivisible : les leudes de Moissac, vassaux des Vierges Noires, sont déjà les ennemis des patriciens d’Orient. ». « Leur inutile armure en retrouve la carapace qui plonge dans le temps, celle qui transformait en fauves cuirassés les bêtes des plaques sarmates ; leur tête populaire s’émerveillera de découvrir au ciel le visage de Marie sous les traits maternels des Majestés auvergnates… Dès leur naissance, ils sont les ennemis des empereurs d’ivoire, des Saints Georges de/
MIS p. 1158
marbre semblables aux patriciens d’Orient. En figurant les Vieillards de l’Apocalypse par des vieux guerriers francs à peine plus réalistes que les Majestés elles-mêmes, les sculpteurs de Moissac entreprenaient l’incarnation du Christ dans la chrétienté. Ce que Byzance eût sans doute jugé sacrilège, et ne conçut jamais.
On a trop dit qu’elle était incapable d’humaniser les personnages divins. Si le monde de la mosaïque, et celui des icônes qu’il commande, sont le plus souvent surhumains, les ivoires ont maintes fois humanisé le Christ et la Vierge ; mais aucun art byzantin n’a humanisé les hommes. Notre art et celui de l’Extrême-Orient nous ont fait oublier que ce n’est pas si facile ; et que la recherche du réalisme n’y suffit pas. Car l’art n’humanise pas les hommes en fixant des spectacles, mais en exprimant une communion. (…).
MIS p. 1160
(…) C’est dans l’ombre de la crucifixion, non dans la majesté du Pantocrator, que la
MIS p. 1161
Rome chrétienne découvre les yeux d’enfant qui obsèderont Dostoïevsky, le regard franciscain du boeuf et de l’âne. Chaînon dans l’art « primitif » et le génie roman ? Quels populaires, dans quelques civilisation que ce soit, ont jamais ordonné jusqu’au génie une sensibilité de cette nature ? Vers l’art de majesté d’Autun converge un art de Fioretti, découvert avec lui, et auquel les petits élus appartiennent autant que les personnages des médaillons ; les anges, un peu moins ; les saints, moins encore ; le Christ, plus du tout. Mais ce menu peuple, le peuple chrétien tout court, investit Dieu comme le peuple fantastique de Vézelay ; comme les vieux guerriers francs ont investi l’Eternel de Moissac, pour que son Fils devient le Christ de Chartres, pour que l’art roman voie le Portail royal rejeter son bestiaire et accomplir son génie. Une même transfiguration va de tous les innocents jusqu’aux Christs triomphants. L’homme prend conscience de lui-même et invente ses héros : le fantôme de Charlemagne surgit des chansons de geste pour dessiner, avec la carte de l’art roman, celle de son empire dispersé. Et lorsqu’on chantera la vie de saint Louis devant les églises, les vieux de Moissac, les ingénus d’Autun et les hommes-chiens de Vézelay reconnaîtront leur roi.
Mais avec lui s’éteindra la passion des cathédrales, la prédication qui couvrit la chrétienté depuis la construction de Moissac jusqu’à l’abandon des chantiers de Reims, depuis Compostelle jusqu’aux portes de Novgorod. L’homme aura tiré de la pierre la seule humanité où pût se reconnaître le Dieu qu’il arrachait à la nuit. Les petites mains jointes de la candeur bourguignonne auront relevé la chrétienté prosternée ; le peuple des huit mille figures de Chartres aura crié la gloire du Christ à tous les moineaux des champs beaucerons ; la nef de la cathédrale en sera devenue le miroir. Ici finit le temps où l’invincible éternité ensevelit la face implacable de Rome : pour les siècles, le Dieu du roi de l’Occident mort à la dernière croisade, effacera celui que le mur chargé d’icônes protégeait de l’impure communion des hommes. »
– Exposition gothico-bouddhique. – exposition gréco-bouddhique (1931)
p. 1180, « Ce passage même, en Europe, est-il si simple ? Des seigneurs hirsutes sur lesquels s’élève le Christ de Moissac, au « Beau Dieu » d’Amiens, une volonté d’expression têtue s’exprime, en passant par Chartres ; mais d’Amiens à Reims ? »
Ecrits sur l’art, II, Oeuvres complètes, tome V,
La métamorphose des Dieux
Le Surnaturel
p. 7, I. Le Divin, « Le sentiment que nous éprouvons devant la Pietà d’Avignon et les derniers Titiens ; Velasquez et Rembrandt ; Moissac, Ellora et Long-Men; les archaïques grecs, telles statues mexicaines, néo-sumériennes ou égyptiennes, s’exprimait par des termes liés à l’idée de plaisir -fût-ce le plaisir de l’oeil- ou à l’idée traditionnelle de beauté. »
p. 9, « Pour les sculpteurs de Moissac comme pour ceux d’Ellora, pour les fresques d’Ajanta comme pour les mosaïstes de Byzance, apparence et réalité ont la même signification : toute réalité humaine est apparence au regard du monde de Vérité que leur art a pour objet de manifester ou de suggérer. »
p. 23-24, La statue sacrée est une figure délivrée de l’apparence comme le temple est un lieu délivré du monde qui l’entoure. Le « double » funéraire égyptien ressemble au mort dont il habite le tombeau, Gudéa et le Pantocrator ressemble à des hommes, mais ils deviennent un « double », Gudéa et le Pantocrator, par ce qui les en sépare. » (…) « Ce qui unit les temples thébains à ceux d’Ellora, au Baraboudour, à Sainte-Sophie, à la Mosquée impériale d’Ispahan, c’est la création des lieux victorieux de l’apparence ; ce qui unit Djoser aux Gudéa, aux Pantocrators,/ aux cosmogonies d’Elephanta, à l’Apparition de l’Eternel de Moissac, c’est la création de figures qui accordent les formes de la vie à la Vérité suprême qui les gouverne.
Les seuls arts, chrétiens ou non, que l’on tînt pour grands il y a un siècle -ceux de l’Europe à partir de la Renaissance, ceux de la Grèce à partir de Périclès, puis des royaumes hellénistiques et de Rome- étaient les seuls qui n’aient pas tendu à la manifestation d’une telle Vérité ; nous ressuscitons tous les autres »
p. 172-173, II. La Foi, « Au Xe siècle, la sculpture avait disparu. L’histoire de l’art conçue au XIXe a donc supposé que les artistes réapprirent à sculpter pendant le XIe ; et, parce qu’elle postulait que le développement de tout art se confond avec une conquête de l’illusion, elle a établi une évolution depuis les chapiteaux « primitifs » jusqu’au Tympan de Moissac. »
p.176 « L’art ne passe manifestement pas des Séraphins au Tympan de Moissac; la Visitation demeure sans postérité. La sculpture subit une mutation brusque.
On connaît depuis longtemps le lien qui unit aux ivoires la sculpture de Toulouse et de Compostelle ; mais ce ne sont pas les seuls ivoires, c’est l’art du livre tout entier, que la sculpture découvre au début du XIIe siècle. Précisons bien qu’il n’est pas question de reprendre les travaux, d’ailleurs éminents, qui ont relié les tympans aux enluminures[16] : leur valeur est exclusivement historique. Pas un seul chef-d’oeuvre roman ne doit son art à une enluminure : nous retrouvons ici les tableaux d’Utrillo et ses cartes postales. L’idée que l’art du Tympan de Moissac puisse venir d’une enluminure, fût-elle géniale, est inconcevable pour un sculpteur[17].
p.176-177 « Le sculpteur des Séraphins, artistiquement, est illettré ; pas celui de Moissac. La sculpture sur pierre devient un art historique. Le petit maître de Saint-Sernin et le maître génial de Moissac, que l’on a peine à croire voisins, peine à croire contemporains, écartent du même geste les chapiteaux de Saint-Benoît. Que l’on pense à Moissac, à Vézelay ou à Autun entre ces chapiteaux et les enluminures majeures[18] : celle du Pontifical de Robert par exemple, ou les dessins de psautiers anglo-saxons. »
p.178, « Il n’y a aucun progrès de la représentation, depuis la porte Miégeville de Saint-Sernin ou le Tympan de Moissac, jusqu’au Portail royal de Chartres. »
p.182, « Les mosaïques de Daphni, de Kiev, précèdent Moissac de quelques années ; la Vierge de Jean II, à Sainte-Sophie, en est contemporaine ; les cycles siciliens le sont du Portail royal de Chartres. »
p. 183, « La Vierge, absente de Moissac, absente de Beaulieu, est épisodique à Autun, écartée de Vézelay, où elle devrait figurer parmi les apôtres.(…) Le premier chef-d’oeuvre roman figure son apparition aux Vieillards de l’apocalypse; les suivants, la fondation de l’Eglise et le Jugement dernier[19].
D’où le trouble lien de cet art avec celui de Byzance, qu’il continue et détruit à la fois. Il lui est lié par le mystère. Son christianisme n’est pas byzantin ; mais il est augustinien comme celui de Byzance. Aucun docteur n’a régné dans les cloîtres d’Occident plus que saint Augustin ; jusqu’à saint Bernard, il anime toute prédication du mystère divin. (…)
(…)Ce mystère n’avait trouvé ses expressions majeures qu’à Byzance. Nul ne peut désigner aujourd’hui celles que connurent les maîtres romans, mais le Tympan de Moissac reprend le sujet de la grande mosaïque de la Chapelle Palatine, exécutée par les Grecs[20]. Lorsque, dans les prophètes des cathédrales, le XIXe siècle retrouve les préfigures du Christ et des apôtres, il explique leur présence en partant de la vie de Jésus ; où figure Jésus dans le génie roman ? /p. 184 Ce n’est pas lui qui domine le Tympan de Moissac ; ce n’est pas lui qui domine Conques, Carennac, Beaulieu, Cahors, Vézelay, Autun, Ely, Ripoll, Parme, c’est le Christ en tant qu’Eternel. En art comme dans la foi, le Christ se dégagera du Dieu d’Abraham, de tympan en tympan, depuis Moissac jusqu’aux dernières cathédrales en passant par Chartres, semblable aux apôtres qui semblent se dégager des prophètes sur les épaules desquels les juchent les sculpteurs. Les préfigures relient moins l’Ancien Testament au Nouveau, que le Nouveau à l’Ancien : elles proclament une fois de plus Fils de Dieu, Jésus qu’oubliaient la duchesse Dhuoda et ses directeurs carolingiens. Si l’amour de Jésus allait de soi, pourquoi saint Bernard le prêcherait-il avec cet accent de révélation ? Lorsqu’il exalte contre Abélard le primat du mystère, parle-t-il au nom des anges que Gislebert achève à Autun, ou du Pantocrator qui règne sur eux ?
Le génie roman est lié au génie augustinien par le plus puissant des sentiments créateurs d’images : la vénération destructrice. On la voit à l’oeuvre dans tout tympan que l’on rapproche d’une mosaïque byzantine de même sujet ; mais rien ne met autant en lumière le sens et les moyens de la proclamation romane que le rapprochement de l’Apparition de l’Eternel de Moissac avec celle de La Lande-de-Fronsac. L’esprit roman sépare l’Apocalypse de La Lande
Illustrations, p. 185, 186-187,188
p. 189
de tout l’art byzantin[21] ; le génie roman va en séparer celle de Moissac.
Il semble que le sculpteur de La Lande révèle les termes de l’appel auquel celui de Moissac répond en inventant sa puissante architecture, en exprimant le surnaturel par son grand style de cuirasse barbare, l’Eternel par la majesté ; mais aussi en reliant celui-ci aux hommes par cette cour de Vieillards à la fois héraldiques et populaires qui est la négation même de l’art byzantin, et à laquelle Gislebert ajoutera bientôt ses anges et ses visages innocents. La grande création romane rompt avec les images augustiniennes comme tout grand artiste rompt avec ses maîtres directs ou lointains lorsqu’il met en cause le sens fondamental de leur oeuvre; elle s’élabore en elles et contre elles – comme la création carolingienne.
Comme une création carolingienne que s’adresserait au peuple fidèle…
(…)L’histoire de la sculpture médiévale est celle d’une Incarnation. Bien que la classification actuelle, fondée sur l’architecture, annexe légitimement aux gothiques le Portail royal, une même lignée fait de la dernière statue-colonne, la descendante de Moissac…
p. 190 (A propos de Vézelay) Son Christ de ciseleur grandiose possède la majesté des Christs de ce temps, et une admirable ampleur que n’appartient qu’à lui; mais plus les personnages qui l’entourent s’éloignent de lui, plus la poésie remplace la vénération /p.195/ d’Autun et de Moissac.
(…) Cette évangélisation des chimères ne prend pas place entre Moissac et Autun, mais au-dessus du bestiaire des cloîtres – dont elle est le chef-d’oeuvre.
Le génie de la sculpture romane se confond avec celui de ce Christ, non avec celui de son peuple fabuleux ; avec l’accent qui paraît dès les Apôtres de Toulouse, antérieurs à Moissac, antérieurs de trente ans au Portail royal où nous retrouverions leurs jambes croisées, et auprès desquels l’Apôtre dansant du trumeau de Vézelay fait si mince figure. »
p.191, La Foi, (…) » ce qui distingue Moissac -et, plus manifestement encore, Beaulieu ou Autun, bientôt Chartres- du monologue décoratif de la porte Miégeville comme de la Belle-Verrière et de son monologue inspiré, comme de l’inépuisable monologue byzantin, c’est que les maîtres des grands tympans introduisent les hommes dans le monde de Dieu. »
p.194 « A Moissac, l’Eglise veut que les illettrés voient l’Eternel apparaître aux Vieillards, non qu’ils le voient semblable à un homme devant d’autres hommes. Sinon, pourquoi louerait-elle les sculpteurs, pourquoi eût-elle protégé les mosaïstes ? A Moissac comme à Ravenne, elle attend des artistes ce qu’ils attendent d’eux-mêmes: la création d’images qui manifestent ce que l’apparence ne manifeste pas, qui coïncident avec l’apparence sans lui appartenir. Leur art est proprement cette indissociable création de l’âme et de l’argile. Les élus des Jugements derniers ne représentent pas les mains du sculpteur, ni les damnés, ses ennemis. Si la Bible des illettrés est une suite de scènes sacrées, il convient que les artistes apportent aux illettrés les scènes, ils convient aussi qu’ils leur apportent le sacré. Pour l’Eglise autant que pour la chrétienté; et les peuples d’occident, comme celui de Byzance, comme tous les peuples religieux de toutes les religions vivantes, n’accueillent la scène sacrée que dans un monde sacré. »
p.200 « Jamais la naïveté émerveillée qu’avait autrefois connue l’enluminure n’avait été orchestrée par le chant grégorien qui unit les Vieillards de Moissac à l’Eternel, les bergers de Chartres aux rois qu’ils surmontent. »
(…) L’Apocalypse, c’était Moissac ; les Mois et les Vendanges, c’était toute la Bourgogne.
p. 202 (…) L’architecture d’alors a pour mission de créer les formes de pierre qui saisissent l’insaisissable, « le commencement de ce qui ne se voit pas » selon saint Paul. Son action est d’ordre spirituel beaucoup plus que technique ; tous les siècles qui ont poursuivi l’accord « harmonieux » entre architecture et sculpture ont nié que l’art roman l’ait connu. Celui qu’il connaît est celui qu’appelle la nef de Tournus sans que lui répondent les figures de ces piliers, le choeur de Saint-Benoît sans que lui répondent les figures de ses chapiteaux, mais auquel répondent les figures de ses chapiteaux, mais aussi répondent le Tympan de Moissac et le Portail royal de Chartres. »
p. 205-206, « En ce sens, la grande oeuvre romane est créée pour déclencher le sentiment du sacré, pour manifester l’inexprimable à la façon dont la carte postale manifeste le sublime. Et, de même que celle-ci n’est plus celle que nous avons reçue, L’Eternel de Moissac n’est pas un grand vieillard. Pas davantage l’Eternel présent qu’entendirent Moïse et Job, sans doute; mais il n’en est pas que le signe.
Le rêve ne choisit vraisemblablement pas n’importe quelle carte, mais à coup sûr la scène de l’Apocalypse n’est pas n’importe quelle scène.
(…) les sculpteurs n’inventent ni l’apparition de l’Eternel ni le tétramorphe. Mais c’est leur art qui fait, de ces cartes postales élues par le rêve du peuple fidèle, l’oeuvre de Vérité qu’y connaît le dormeur réveillé. sans l’art, l’image du plus haut symbole n’est qu’un signe, l’interchangeable enluminure du Beatus où le maître de Moissac a trouvé (semble-t-il…) son iconographie[22]. La création romane, comme toute création sacrée, a pour raison d’être de transformer les signes en symboles, de leur donner vie par la manifestation de la vérité spirituelle que l’univers recèle et ignore, et qu’il appartient à l’homme de mettre au jour. Ainsi l’oeuvre accède-t-elle au sacré, devient-elle prémonition du monde de Dieu. Les symboles qu’elle anime, devenus « signes sensibles » comme le veut Scot Erigène, ne symbolisent rien du monde créé, au sens où nous disons que le bleu symbolise la pureté; ils sont symbole de l’inexprimable.
Mais de quoi l’artiste tirerait-il les formes convaincantes de tels symboles, sinon de ce qu’il les accorde à la chrétienté? Il ne les invente pas, il les découvre. Le peuple, qui ne les connaît pas, les reconnaît – et l’Eglise les suscite, les artistes les créent, pour qu’il les reconnaisse. /p. 207/ Mais il ne reconnaît le Christ que dans la communion. C’est pourquoi aucun art, dans aucune civilisation, n’a fait assumer autant d’humain par le sacré, n’a exprimé si pleinement le sacré par l’humain. On étudie cet art par écoles, et il est vrai que la sculpture de Toulouse, celle de Moissac, s’élaborent dans un milieu bien différent du milieu bourguignon ; il n’est pas moins vrai que de Toulouse à Moissac, de Moissac à Conques, de Conques à Beaulieu et au Christ de Ripoll, la communion s’étend et s’approfondit de la même façon que de Cluny à Vézelay, de Vézelay à Autun et aux crucifix bourguignons. Pendant le temps si court: quarante ans, qui apporte à l’histoire l’une de ses plus grandes sculptures, la même humanisation du sacré se poursuit dans toute la chrétienté. L’art du maître de Beaulieu et celui de Gislebert d’Autun, qui achèvent leurs tympans vers 1140, se rejoignent en 1145 au Portail royal de Chartres. et ce n’est pas l’humain qui va s’effacer avec leurs successeurs gothiques, c’est le sacré.
p. 212, « Que le Christ de Chartres semble mineur en face de Moissac, et même de Vézelay, ne tient pas au talent de son auteur (…)
p. 213, « L’évolution du Jugement dernier, de Moissac à Amiens, montre clairement le reflux du sacré. L’Apparition de l’Eternel annonçait le Jugement ; mais elle était, d’abord une révélation du monde de Dieu. »
p. 217, « Sans doute l’Incarnation accompagnait-elle l’épopée chrétienne depuis le début de l’art roman ; pourtant l’âme romane conservait, de l’augustinisme, le tragique qui resurgira sans équivoque chez Luther : le sentiment de la majesté divine dans son altérité fondamentale, du monde de Dieu qui se révélait au Jugement, et que manifestait le Tympan de Moissac. Pour saint Augustin, le péché originel, donc la condition humaine, avait séparé les hommes du « mystère incommunicable » de l’Eternel, qui les atteignait par la Grâce. Ce mystère avait gouverné la foi carolingienne, gouvernait encore la foi romane. »
p. 229, « Le monde de l’Eternel s’efface devant l’Incarnation suzeraine qui lui succède comme le Seigneur de Notre-Dame de Paris succède au Juge de Moissac, au Sauveur de Vézelay. »
p. 231, « Quand avait commencé cette métamorphose – au premier Couronnement de la Vierge, celui de Senlis, et portail illustre de Compostelle qui reprend le sujet de Moissac, mais où la joie fait irruption dans la sculpture chrétienne – les sculpteurs… »
p. 234, « Quant à la grande sculpture romane, l’irréfutable vie qu’elle donnait aux symboles atteignait le chrétien dans un domaine plus profond que l’imaginaire ; le Tympan de Moissac ne suggérait pas un spectacle, il figurait ce qui ne pouvait apparaître aux yeux humains que par lui – comme le figurent les divinités d’Elephanta, les sculptures africaines, les stèles du Mexique ou les fresques de Nara. »
p. 235, « Le sculpteur (gothique) (…) Il n’envisage pas plus de sculpter son épouse, que ne l’envisageait celui de Moissac ; que Van Gogh n’envisagea de peindre des portraits mondains ou des décors pour l’Opéra-Comique. »
p. 249, « Lorsque la sculpture cesse de transfigurer le peuple militant des Apôtres et des Saints en Eglise triomphante, et la terre en Création rachetée, la prédication commencée à Moissac s’arrête. Un nouvel art va découvrir une Eglise souffrante, mais on priera la Mère des p. 253 Douleurs dans les chapelles, et aucun tympan ne proclamera la Pietà. »
p. 265, « Le maître de Moissac avait conçu son tympan comme un fragment de l’abbatiale, reconnu son maître d’oeuvre dans l’Eglise en tant que née du Christ, vivante jusqu’au Jugement, tisseuse de la robe d’églises qu’elle tissait comme elle bâtissait la chrétienté – et dont l’abbatiale n’était qu’un morceau comme le tympan n’était qu’un morceau de l’abbatiale. »
p. 274 (à propos des crucifix rhénans). « Du génie roman, auquel il ne pourrait appartenir bien qu’il en semble le dernier héritier, il conserve l’accent surnaturel des grands symboles, celui de l’Eternel de Moissac et des Majestés. »
p. 284, « De Moissac à Compostelle, et de Compostelle à Reims -et, de façon plus concrète, jusqu’aux grands crucifix rhénans – l’histoire de l’art était celle d’une épopée spirituelle qui semblait engendrer sujets et styles. Cette histoire continue par la pathétisation des sujets, dans la joie comme dans la douleur. »
p. 292, « Le terme d’artisan, appliqué aux sculpteurs romans et à ceux des cathédrales, n’a évidemment aucun sens hors de son sens social : ni le maître de Moissac, ni celui du Beau Dieu ne se sont tenus pour d’habiles menuisiers. »
p. 319, « Le reflux de la transcendance a porté la représentation religieuse de Moissac aux portails d’Amiens, puis aux bas-reliefs des jubés, comme il a porté le sentiment religieux, de l’Apparition de l’Eternel à la biographie romancée de Jésus. »
p. 334, « L’enluminure flamand qui fait de l’Apocalypse la Vision du trône de Dieu proclame, sans le savoir, que l’épopée commencée à Moissac lui est devenue aussi inintelligible que l’art byzantin l’était à Boccace. Oeuvre mineure, sans doute ; mais le retable de l’Agneau mystique est lui aussi une réincarnation de l’Apparition de l’Eternel, où les anges chanteurs ont la place des Vieillards musiciens – le Paradis, celle du monde de Dieu. »
La métamorphose des Dieux, L’Irréel
p. 450, L’Irréel, Donatello,
« (…) au Capitole, comme en Grèce, en Egypte, à Sumer, aux Indes, à Moissac, à Chartres, l’art n’avait délivré de la condition humaine les figues des hommes, qu’en les accordant aux figures de la foi. »
p. 496-497, idem, Florence, « Bien que l’art égyptien donnât forme à l’éternité, les Egyptiens savaient qu’elle eût existé sans lui, comme le monde d’Allah existe pour les musulmans sans images. Le Maître de Moissac ne voyait dans son oeuvre qu’un témoignage de piété, lorsqu’il pensait au jour où apparaîtrait l’Eternel. Le monde de Dieu est réalité suprême ; l’irréel, de même que les dieux grecs, prend forme par l’art comme la lumière par ce qu’elle éclaire. »
p. 528, idem, Rome, « Sans doute la transcendance du Père, celle de l’Eternel de Moissac, s’est-elle effacée de la chrétienté entière, hors des couvents (…) »
p. 536 (Raphaël et Jules II) « grand style »… « la plus haute aspiration des hommes » – aussi étroitement lié à cette démiurgie, que l’avait été l’art du Maître de Moissac à la manifestation du sacré. »
p. 623, idem, Rembrandt,“Ni pour les sculpteurs de l’Orient, ni pour Phidias, ni pour le Maître de Moissac, ni pour Van Eyck, ni pour Titien, ni pour Rubens, la postérité n’avait été une Cour de cassation. »
p. 624, idem, Rembrandt, „ L’art du surmonde chrétien, en Orient, tend au Pantocrator ; en Occident, à l’Eternel de Moissac, au Beau Dieu d’Amiens, au Dévot Christ de Perpignan, à la Piétà d’Avignon. Mais le Pantocrator et les Pietàs n’étaient pas des poèmes, ni des « oeuvres d’art » ; la Pièce aux cents florins, les Trois Croix, sont d’abord des eaux-fortes ; les Saintes Familles, d’abord des tableaux. »
L’Intemporel
p. 790, « Et Venise n’avait pas trouvé Vénus dans une collection d’antiques ou sur le quai des Esclavons, que le maître roman n’avait trouvé le visage de l’Eternel dans les catacombes, les enluminures carolingiennes ou les rues de Moissac. La création artistique, pendant l’ère de l’Irréel comme pendant celle de la Foi, n’avait pas fixé une apparence choisie, elle avait créé les formes rivales de celles de l’apparence. »
p. 857, « Ses formes expriment notre dualisme, fondamental comme l’alternance et la conciliation du yin et du yang – de la même façon que Djoser, le Tympan de Moissac ou la Majesté d’Elephanta expriment le sacré.
Et que tous les Bouddhas illustres expriment l’unité. »
p. 861, (toutes les facultés selon Valéry, pour le « Grand Art »). Et nous savons, même sans Léonard, que toutes ces facultés sont simplement celles de l’intellect : la formule se soucie peu de la faculté d’adoration, et même de la grandeur, que Michel-Ange tenait pour la faculté maîtresse de l’art. Et toutes les facultés d’un hommes sont-elles intéressées à comprendre l’art du Tympan de Moissac ? »
p. 880, « L’art est encore volonté d’imitation, d’illusion ou d’expression. Les décennies qui viennent de remettre en honneur les primitifs chrétiens, et vont découvrir la sculpture gothique, ne se soucient pas encore de la spiritualisation. Et leur puissant individualisme leur permet d’ignorer que leurs idées ordonnatrices ne rendent pas plus compte des porches de Reims que du tympan de Moissac, pas plus de celui-ci que des grottes d’Asie, du Bayon, des statues sumériennes. Mais les problèmes différés cessent de l’être lorsque l’art nègre entre en jeu. »
p. 918, « Le Musée imaginaire découvre un art de toutes les statues qu’on prie, depuis les dieux de Sumer jusqu’aux fétiches, en passant par les tympans romans – art moins étranger à celui de la Réalité intérieure qu’au nôtre. Parce que les fétiches, les idoles, la Majesté d’Elephanta, le Tympan de Moissac, le Shigemori raffiné appartiennent à des arts d’accession, non à ceux que nous appelons arts d’expression. »
p. 947, « Le Musée imaginaire, loin de maintenir leur anonymat, leur a donné la vie singulière où leurs styles se montrent semblables à de grands artistes, où le maître du Tympan de Moissac, les sculpteurs des Gudéa, l’art amarnien, jouent le rôle de Donatello ou de Michel-Ange. »
p. 948, « Les arts de la beauté ont cru se concevoir, Poussin a cru continuer Praxitèle. Le romantisme savait qu’il ignorait la voie créatrice des sculpteurs de Chartres ; et dès que l’on comprit que leur succession, de Moissac à Reims, n’était pas dirigé par la recherche de l’habileté, l’objet de l’art devint indéfinissable. »
Préfaces, articles, allocutions (1955-1976)
– Préface au catalogue de l’exposition « Les manuscrits à peintures en France du XIIIe au XVIe siècle »
p. 1120, « A Byzance comme à Moissac, à Chartres comme à Bamberg et à Reims, une épée d’archange avait écarté la Création : les fonds d’or des tableaux et des mosaïques, les fonds abstraits des bas-reliefs, avaient imposé le monde qui n’appartenait qu’à Dieu. »
– Présentation de « L’Univers des formes »
p. 1141, « Mais les intentions des artistes qui se réclamaient, ou croyaient se réclamer, de l’apparence nous sont mieux connues que celle des artistes qui ne s’en réclamaient pas ; la pensée de Michel-Ange, moins mal que celle des maîtres de Moissac et d’Ellora. »
– Préface à « Sumer » d’André Parrot (Juillet 1960)
p. 1142, « Elles ne se réfèrent pas à la « beauté » ; mais à quoi se réfèrent-elles, par quoi la création de leurs auteurs est-elle orientée ? Par le sacré, assurément ; encore l’humanité a-t-elle connu beaucoup d’arts sacrés depuis l’Egypte jusqu’à Moissac… »
p. 1145, « Notre sculpture sacrée est morte avec la chrétienté romane, et il existe une trouble relation entre le Dieu Abu[23] et l’Eternel de Moissac, alors qu’il n’en existe aucune entre lui et et un Christ de l’Angelico… »
p. 1159-1160, « Nous n’ignorons pas le rôle que joue ici la métamorphose : cet immense éventail de liberté est fait d’anciennes tyrannies. Brancusi sculpte, Picasso peint, selon sa volonté ; certainement pas l’artiste de Sumer, ni celui d’Ellora, ni de Long-Men, ni de Moissac. Si ces derniers étaient libres des apparences, c’est qu’ils sculptaient pour exprimer ce qui était plus vrai pour eu que l’Apparence. Leurs oeuvres ont perdu cette Vérité, et c’est pourquoi j’ai dit naguère que les styles de haute époque nous apparaissaient comme autant de Zarathoustras inventés par autant de Nietzsche, mais / p. 1160/aucun Nietzsche ne peut écrire d’Avesta, aucun Picasso ne peut sculpter le tympan de Moissac. »
– Préface à « Sumer » (Version inédite)
p. 1165, « A maints égards, nous appelons chef-d’oeuvre sumérien une statue qui « tient » devant le Pharaon Djoser et l’Eternel de Moissac. »
p. 1167 (figures archaïques sortent de terre) « Il ne surgissent plus en face des galeries d’antiques, mais en face du Musée imaginaire : de Moissac et d’Ellora, de Long-Men et de Palenque, des sculptures de l’Afrique et de l’Océanie. »
– Discours d’inauguration de l’exposition « L’Europe Gothique »
p. 1191, « Mais ce menu peuple, le peuple chrétien tout court, investit Dieu comme le peuple fantastique de Vézelay : comme les vieux guerriers francs ont investi l’Eternel de Moissac, pour que son Fils devienne le Christ de Chartres. Une même transfiguration va de tous les innocents jusqu’aux Christs triomphants. Et lorsqu’on chantera la vie de saint Louis devant les églises, les vieillards de Moissac, les ingénus d’Autun et les hommes-chiens de Vézelay reconnaîtront leur roi. »[24]
p. 1192, « L’innocence d’Autun devient l’émerveillement gothique. Avec lui s’éteindra la prédication qui couvrit la chrétienté depuis la construction de Moissac jusqu’à l’abandon des chantiers de Reims depuis Compostelle jusqu’aux portes de Novgorod. »
Oeuvres complètes, III, 1967-1976
Le Miroir des limbes, I, Antimémoires, III, I
p.212 « Ensuite, il y a Civa, la caverne, le sacré. Comme celle de Moissac, cette figure appartient au domaine des grands symboles, et ce que le symbole exprime ne peut être exprimé par lui. »
Le Miroir des limbes, II, La Corde et les Souris, V.
p.767 « Valéry, pour ramener la peinture de son temps à la modestie, lui oppose la « hiérarchie de l’esprit ». Manet lui répond ici faiblement, même dans l’admirable Berthe Morisot; mais le Roi de Beauvais, Moissac, toute la sculpture romane ? Sans doute pensait-il qu’elle n’engageait pas l’esprit. »
p.781 « Le petit bonhomme qui croit se perdre dans le divin en imitant avec fidélité quelque prototype, sculpte la Majesté d’Elephanta, le masque-antilope des Dogon ; le sculpteur anonyme de Moissac révèle à la foule chrétienne le divin qu’elle salue comme le peuple fidèle portera en triomphe la Madone toscane. »
Discours prononcé à la Fondation Maeght
p.884 « …pour le musée, tout grand style est promis à la métamorphose. Il rassemble les oeuvres des civilisations successives ou différentes, à une époque qui ne regarde plus les styles comme les interprétations de la « nature », mais comme les significations du monde.
D’où l’interrogation décisive à la fois sur lui-même et sur l’art. les formes qu’assemblèrent les civilisations, le Goudéa néo-sumérien ou le tympan de Moissac, /p.885/ n’y trouvons-nous qu’un équilibre de volumes?
(…)Le Dieu du Musée Imaginaire, c’est l’Inconnaissable; et d’abord la lutte contre la mort. »
L’homme précaire et la littérature, Gallimard, 1977, 336p.
p.18 « Il serait facile de suivre, en sens inverse, Gislebert d’Autun ou le tympan de Moissac. Et Homère, Virgile, Villon, même Shakespeare ou Racine. Comment l’un de nos grands styles échapperait-il à la métamorphose, puisque la Renaissance a dû ressusciter un passé enseveli, et le romantisme, un passé méprisé ?
p.81 (…) Grande ou petite, l’église n’est pas initialement une maison, c’est un lieu du surnaturel. Les Chrétiens s’y réunissent pour louer Dieu ensemble, selon la piété liturgique; où pourraient-ils le faire mieux que dans son autre monde, celui de l’édifice élevé pour accueillir les reliques et régner sur les morts? L’imaginaire chrétien ne commence pas à Moissac, et il est aventureux de prendre appui sur quelques textes pour voir dans l’art roman la Bible d’un peuple illettré, car depuis longtemps ce peuple possédait un moyen de communication plus profond que les images: la musique sacrée. »
ARCHIVES :
* Archives municipales, Moissac, Centre d’Art roman.
* Archives départementales de Tarn-et-Garonne, Montauban.
* Musée national des Monuments français, Palais de Chaillot, Paris.
* Direction du Patrimoine, Procès-verbaux de la Commission des Monuments historiques, Paris.
* Sous-direction de l’Inventaire général, Base de données Mérimée.
* Ministère de la culture, 3 rue de Valois, Paris (Ier arrondissement).
BIBLIOGRAPHIE :
Histoire de Moissac :
* BEAUNE Colette, Naissance de la nation France, NRF, Ed. Gallimard, 1985, p. 67-69, p.363.
* BORZEIX Daniel, PAUTAL René, SERBAT Jacques, Histoire de Moissac, Ed. les Monédières, 1992, 192 p.
* BOULET François, Le cloître et le drapeau. Histoire de la commune de Moissac dans la seconde moitié du XIXe siècle. Société, Mentalités, Politique 1948-1902, mémoire de maîtrise, université de Toulouse, 1987, 391 p. ; « La Révolution française à travers deux notables moissagais du XIXe siècle : A. Lagrèze-Fossat (1814-1874) et C. Delthil (1834-1902) et la bibliothèque publique de Moissac (1889-1989) », in (dir. Daniel LIGOU), Révolution et contre-Révolution dans la France du Sud-Ouest, 1990, p. 95-100 ; « Histoire du monument historique à Moissac des origines à nos jours », Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, 1990, t. CXV, p.145-168 ; « Histoire du monument historique à Moissac aux XIXe et XXe siècle », B.S.A.T.G., 1993, t. CXVIII, p.79-115 ; « Le tympan et le cloître de Moissac de la légende du roi Clovis à l’oeuvre d’André Malraux », Journées de l’Association des professeurs d’histoire-géographie, 17 mai 1997, inédit, 17 p.
* DUFOUR Jean, La bibliothèque et le scriptorium de Moissac, Genève-Paris, Librairie Droz, 1972, 184 p.
* DURLIAT Marcel, L’abbaye de Moissac, Ouest-France, 1985, 32 p.
* Ici et là spécial, Moissac, 1997, 82 p.
* Images du patrimoine, La Ville de Moissac, Tarn-et-Garonne, Ministère de la Culture, Inventaire général,1986, 72 p.
* Indicateur du patrimoine (Architecture). Département du Tarn-et-garonne, Bas-Quercy, tome I, Inventaire général, 1987, p.48-58.
* FOULON Charles-Louis, André Malraux et le rayonnement culturel de la France, Paris, Editions complexe, 2004, II, « L’aventure des arts », p. 97-185 (articles d’Evelyne Lantonnet, Julien Dieudonné, Edson Rosa Da Silva, Joël Loehr, Marie-Sophie Doudet, Moncef Khémiri, Marcelo Jacques de Moraes)
* FRAISSE Chantal, L’enluminure à Moissac aux XIe et XIIe siècles, Auch, 1992, 31 p.
* LA HAYE Régis de, Apogée de Moissac. L’abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac à l’époque de la construction de son cloître et de son grand portail, Maastricht, Moissac, R. de la Haye, 1995, 651 p.
* PAUTAL René, Adrien Lagrèze-Fossat. Un bourgeois « érudit », Les Monédières, 2001.
* PEYRAC Aymeric de, Chronique des Abbés de Moissac, (Editée, et annotée par Régis de La Haye), Maastricht, Moissac, 1994, 368 p.
* SCELLES Maurice, Visiter l’abbaye de Moissac, Sud-Ouest,1996,31 p.
* SIRGANT Pierre, Moissac, Bible ouverte, Montauban, 1996, 392p.
* SIRE Marie-Anne, VOINCHET Bernard, « Pour une approche globale de restauration et mise en valeur des sculptures du portail de l’abbatiale Saint-Pierre de Moissac », in Entretien du Patrimoine. L’ornementation architecturale en pierre dans les Monuments historiques, Fontainebleau, octobre 1988, p.47-50.
* VIDAL Marguerite, « Moissac », in Quercy roman, Zodiaque, 1969, p.46-135.
Oeuvres d’André MALRAUX :
* La Psychologie de l’Art, I, Le Musée Imaginaire, Genève, Slira, 1947, 163 p. (P.A., I).
* La Psychologie de l’Art, II, La Création Artistique, Genève, Skira,1948, 231 p. (P.A., II).
* Le Musée Imaginaire de la sculpture mondiale, tome 3, Le monde chrétien, Paris, La galerie de la Pléiade, 1954, 475 p. (M.I.S.)
* Le Musée Imaginaire, Gallimard, 1965, rééd. 1996, 289 p. (M.I.)
*La Métamorphose des Dieux, tome 1, Le Surnaturel, Gallimard, 1977; 1ère éd. sous le titre La Métamorphose des Dieux, I, Gallimard, 1957, 405 p. (M.D.S.)
* Oeuvres complètes, t.III, Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F., Gallimard, 1996, 1428 p., index, p.1404, (M.L.).
* Oeuvres compètes, t.IV-V, Ecrits sur l’art, I-II, Bibliothèque de la Pléiade, N.R.F., Gallimard, 2004, 1588 p., 1774 p.
Autres ouvrages utilisés :
* Les affaires culturelles au temps d’André Malraux 1959-1969, Paris, La Documentation française, 1996, 509 p.
* (Direction de Daniel J. GRANGE et Dominique POULOT), L’esprit des lieux. Le patrimoine et la cité, Grenoble, P.U.G., La pierre et l’écrit, 1997, 476 p.
* SAINT-CHERON François de, L’esthétique de Malraux, Sedes, 1996, 212p.
* (Direction de Pierre NORA), Science et conscience du patrimoine, Paris, Fayard, éd. du Patrimoine, 1997, 413 p.
François BOULET,
Saint-Germain-en-Laye, le 17 septembre 2005
[1]. Lire notre étude « Moissac et Malraux. Pour un lieu de souvenir « André Malraux » à Moissac » , in Bulletin de la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne, Tome CXXIX, 2004, pp. 139 -145.
[2] Voir dossier « Les Ecrits sur l’Art », in Présence d’André Malraux, Amitié internationales André Malraux, numéro 4 – automne 2005, 92 p.
[3]. François de SAINT-CHERON, L’esthétique de Malraux, Sedes, 1996, 212 p.
[4]. André MALRAUX, Ecrits sur l’art I, II, in Oeuvres complètes, IV, V, N.R.F., Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2004, t. I, p. 425 et p. 1447, note 1.
[5]. Renseignements de Madame Gouzi, 13 janvier 2005.
[6]. Jean-Yves TADIE, « Introduction », in Oeuvres complètes, T. IV, Les écrits d’art, op. cit., pp. IX-X.
[7]. T. IV, p. 1118, p. 1161.
[8]. T. IV, p. 1155, p. 1160.
[9]. Ibid., t. V, lettre d’André Malraux à son successeur au ministère de la Culture, Jacques Duhamel :
« Le 13 décembre 1971 / Cher ami, / Je suis harcelé (légitimement) par les travaux relatifs à l’église de La Lande-de-Fronsac. L’un secondaire : faire entrer le moulage du tympan au musée des Monuments Historiques. Ce tympan (l’Apocalypse) permet de comprendre la création de celui de Moissac – donc, en gros, du premier chef d’oeuvre français. / Seconde question : la restauration. Je demande aux archéologues la limite de leur misère, et ne vous en parle aujourd’hui que pour vous dire que j’y reviendrai – et que vous ne me teniez pas pour un maniaque…/ Bien amicalement./ André Malraux ». Fonds documentaire du centre André-Malraux de l’université Paris-III, note 1, p. 189, Notes et variantes p. 1370.
[10]. Ibid, t. V, p. 176, Notice p. 1510-1511.
[11]. Ibid, t. IV, discussion des conclusions d’Emile Mâle dans Le Monde imaginaire de la sculpture mondiale, t. IV, p. 1117-1118, note 2, p. 1367-1368 ; t. V, p. 176-177.
[12]. T. V, notes et variantes, n°2 (page 183), p. 1369.
[13] . T. II, Les Noyers de l’Altenburg, Camp de Chartres, p. 746 ; T. III, Le Miroir des Limbes, I. Antimémoires, III, 2, pp. 219 (et note 1)-220, p. 1193.
[14]. Note p. 449, 1448-1449. Pour l’interprétation de ces tympans, Malraux a lu les études d’iconographie médiévale d’Emile Mâle. Ce dernier voit dans les signes du zodiaque du tympan de Vézelay un symbole de la durée de la mission de l’Eglise.
[15]. P. 1529-30. On retrouve ici la trace des lectures de Malraux mentionnées dans la Notice (voir p. 1510-1511). Emile Mâle, dans L’Art religieux du XIIe siècle en France (p. 7-8), écrivait : « D’où vient donc ce tympan de Moissac, qui semble se présenter à nous sans ancêtres ? Est-ce une création des sculpteurs du XIIe siècle ? On ne saurait être tenté de croire quand on connaît l’Apocalypse de Beatus. (…) Voilà le modèle du sculpteur de Moissac ». Marcel Aubert, dans La Sculpture française au Moyen Âge (p. 63), écrira encore : « (…) autrefois rehaussée d’or et de peintures, elle (l’Apocalypse du tympan de Moissac) apparaissait comme une immense fresque inspirée du Commentaire de Beatus, ainsi que l’a montré E. Mâle. » Henri Focillon, en 1938, dans Art d’Occident. Le Moyen Âge roman et gothique (rééd. 1947, p. 96) notait à propos du tympan de Moissac : « (…) à travers le commentaire illustré de Beatus qui lui servit de guide dans les détours de cette Divine Comédie de pierre, l’Apocalypse romane tressaille encore de terreurs du millénarisme. » Mais il affirme aussi, semblant annoncer Malraux : « (…) quelle distance, et pour la forme et pour l’inspiration, sépare les figurines des manuscrits, tracées à la pointe du calame, vivement enluminées et toujours graphiques, et les acteurs du drame surhumain taillés dans la pierre ! » (ibid., p. 177). Enfin, dans Le Surnaturel, Malraux écrira : « (…) il n’est pas question de reprendre les travaux, d’ailleurs éminents, qui ont relié les tympans aux enluminures : leur valeur est exclusivement historique. Pas un seul chef-d’oeuvre roman ne doit son art à une enluminure (…). L’idée que l’art du tympan de Moissac puisse venir d’une enluminure, fût-elle géniale, est inconcevable pour un sculpteur » (t. V de la présente édition, p. 176).
[16] Allusion aux travaux d’Emile Mâle, et notamment son ouvrage L’Art religieux du XIIe siècle en France où il s’attache à démontrer « qu’à Moissac, aussi bien qu’en Auvergne, en Bourgogne ou en Provence, le bas-relief n’a guère été à l’origine qu’une transposition de la miniature » (p. 4). (note 1, p. 1367)
[17]. Cf. « Les bas-reliefs offrent avec les miniatures de certains manuscrits méridionaux des ressemblances frappantes. / Le plus célèbre de tous les manuscrits du Midi est l’Apocalypse de Saint-Sever conservé à la Bibliothèque nationale. (B.N.F., ms. Latin 8878). Ce n’est pas l’Apocalypse elle-même, c’est un commentaire sur l’Apocalypse composé en Espagne par Beatus, abbé de Liebana » (ibid.) Emile Mâle estime que le tympan de Moissac dérive d’un « manuscrit apparenté à l’Apocalypse de Saint-Sever » (Ibid., p. 9). Voir la discussion sur les conclusions d’Emile Mâle dans Le Monde chrétien (Le Monde imaginaire de la sculpture mondiale, t. IV, de la présente édition, p. 1117-1118). (note 2, p. 1367-1368)
[18]. Il semble qu’au lieu de « entre » il faille lire quelque chose comme « au rapport ». La formulation (et la ponctuation) du manuscrit était plus claire : « Que l’on pense à Moissac, à Vezelay, à Autun, en face du monde des formes des chapiteaux et en face de celui du livre ! » (note 1, p. 1368)
[19]. Allusion, successivement, au tympan de Moissac (XIe siècle) représentant l’apparition du Christ en majesté aux vingt-quatre vieillards de l’ Apocalypse, à celui de Vézelay et à celui d’Autun. (note 4, p. 1369)
[20]. Les plus anciennes mosaïques de la chapelle palatine du palais des Normands de Palerme sont datées de 1143 grâce à une inscription en grec à la base de la coupole qui confirme l’attribution de l’ensemble à un atelier de mosaïstes byzantins.
[21]. Ce tympan de l’église de La Lande-de-Fronsac, que Malraux avait reproduit dans La Métamorphose des dieux de 1957, lui valut en 1970 l’envoi par son auteur, M. P. Bourseau, un érudit local, d’une brochure dans laquelle figurait une description du fronton qui confirmait son interprétation : « On y voit figurée la première vision de l’ Apocalypse de saint Jean. Mais, absorbée par l’Evangile de l’office des défunts – selon le même saint Jean-, au lieu de traduire un jugement sévère, dur, elle exprime au contraire l’indulgence, le pardon et la miséricorde : l’Amour et la Vie. Les tiges exubérantes et les fleurs dans la main droite du Fils d’homme, le démontrent à l’évidence. » L’année suivante, le 30 novembre 1971, M. Bourseau écrivait de nouveau à Malraux pour le prier d’appuyer la demande qu’il avait déposée auprès du ministère de la Culture en vue, d’une part, de la restauration de l’église et, d’autre part, de l’entrée du portail roman de cette église au pavillon des Monuments français. Suite à cette lettre, Malraux écrit à son successeur au ministère de la Culture, Jacques Duhamel :
« Le 13 décembre 1971 / Cher ami, / Je suis harcelé (légitimement) par les travaux relatifs à l’église de La Lande-de-Fronsac. L’un secondaire : faire entrer le moulage du tympan au musée des Monuments Historiques. Ce tympan (l’Apocalypse) permet de comprendre la création de celui de Moissac – donc, en gros, du premier chef d’oeuvre français. / Seconde question : la restauration. Je demande aux archéologues la limite de leur misère, et ne vous en parle aujourd’hui que pour vous dire que j’y reviendrai – et que vous ne me teniez pas pour un maniaque…/ Bien amicalement./ André Malraux » (fonds documentaire du centre André-Malraux de l’université Paris-III) (note 1, p. 189), Notes et variantes p. 1370.
[22]. C’est la thèse soutenue par Emile Mâle dans L’Art religieux du XIIe siècle en France. Après avoir comparé la composition, les thèmes et les personnages du tympan de Moissac au manuscrit de l’Apocalypse de Beatus, et notamment à l’Apocalypse de Saint-Sever qui en est inspirée, il écrit : « Est-ce une création des sculpteurs du XIIe siècle ? On ne saurait être tenté de le croire quand on connaît l’Apocalypse du Beatus. / Le tympan de Moissac dérive donc d’un manuscrit apparenté à l’Apocalypse de Saint-Sever » (p. 7-9). Malraux, ici modéré, s’est opposé plus nettement à cette thèse p. 176 (voir aussi n.2).
[23]. Abu est le dieu sumérien de la Végétation. Sa statue a été découverte en 1933-1934. Malraux en reproduira un détail dans L’Intemporel ( voir p. 775).
[24]. Ce paragraphe vient lui aussi du Monde chrétien (cf. Ibid, p. 1160-1161).