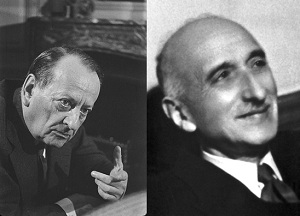Il peut sembler bizarre que l’on s’intéresse principalement, et à titre égal, à deux écrivains apparemment si disparates que Mauriac et Malraux, le croyant invétéré et l’agnostique absolu, le provincial enraciné dans son Bordelais même quand il vit à Paris et le petit banlieusard plutôt déraciné qui se cherche en Indochine, en Espagne, en Inde et ailleurs. Nous verrons qu’ils se rejoignent sur plus d’un plan.
Mauriac est sans conteste l’un des plus grands polémistes du siècle. Il s’est prononcé sur toutes les grandes questions de son temps, à ses risques et périls. Malraux, de son côté, est le type même de l’écrivain engagé, bien avant que ce ne soit à la mode. L’un et l’autre ont été, à divers moments, traités de traîtres, y compris pour leur adhésion à de Gaulle. « En politique, note Mauriac, s’engager sur une certaine route, c’est d’avance consentir à être jugé bassement » (1.1.58).[1] Mais qu’en est-il au juste? Ont-ils trahi leurs engagements précédents, ou sont-ils restés fidèles à eux-mêmes? C’est ce que nous allons essayer de déterminer.
Tout d’abord, ni l’un ni l’autre ne semblaient destinés à s’intéresser à la politique. Le jeune Malraux tel que nous le rencontrons dans les mémoires de sa première femme, Clara, par exemple, tient plutôt du dandy qui fréquente des dîners littéraires, chine des livres rares chez les bouquinistes, tâte de l’édition de luxe et un peu porno sur les bords, et se fait la main en écrivant ses premiers textes farfelus ou des articles de critique littéraire ou artistique.[2] Le jeune Mauriac, monté à Paris pour étudier à l’Ecole des Chartes, passe son temps à écrire de la poésie et à fréquenter des salons littéraires. A 40 ans encore, il dira que l’homme de lettres n’a que faire de la politique et que lui-même se sent aussi étranger à ceux qui s’en mêlent « qu’à la corporation des hommes-sandwichs ou à celle des croque-morts ».[3] Pour le grand polémiste des Bloc-Notes, la politique est impure par essence (9.6.63), elle est « ce qu’il y a de plus impur au monde »[4], ou, selon le mot de Goethe que Mauriac choisit d’appliquer non à l’histoire mais à la politique, « ce brouillamini d’erreurs et de violences » (1.4.54).
Comment se fait-il que ces deux hommes ne soient pas restés sagement assis au salon ou au restaurant, qu’ils se soient l’un et l’autre engagés dans les luttes de leur temps, qu’ils aient provoqué de telles réactions de haine ou de déception, qu’ils aient été attaqués, menacés de mort et traités de traîtres?
Pour Malraux, il semble que le déclic ait eu lieu pendant son aventure indochinoise. Partant à la recherche de bas-reliefs à vendre à des collectionneurs américains pour renflouer les caisses familiales après ses déboires boursières, Malraux est aussi à la recherche de lui-même, du sens de l’aventure humaine à l’aide du repoussoir d’une autre culture, d’une autre façon de se situer dans l’univers. Inculpé et jugé pour vol d’objets d’art, Malraux rencontre la justice—ou plutôt l’injustice—coloniale: là où lui bénéficie d’un sursis, un indigène se serait fait couper les mains. Peu après sa libération il retourne à Saïgon, fonde un journal anticolonialiste, L’Indochine—suivi, après fermeture, par L’indochine enchaînée—et participe au mouvement Jeune Annam.
Le pli est pris: au-delà des multiples légendes entourant ses prétendues activités révolutionnaires en Chine—légendes cultivées ou encouragées par l’intéressé lui-même—[5], Malraux se démène dans la lutte antifasciste en Europe, intervient en faveur de condamnés en Allemagne hitlérienne, s’engage immédiatement et de façon efficace pendant la guerre civile en Espagne où— »Coronel Malraux »—il équipe et commande l’escadrille España, collecte des fonds aux Etats-Unis et réalise son remarquable film, Sierra de Teruel (rebaptisé Espoir ), pour soutenir la République jusqu’au bout. Fait prisonnier pendant la 2ème Guerre Mondiale, Malraux s’évade et, après avoir passé deux ans sur la Côte d’Azur, finit par s’engager dans la Résistance et, sous le nom du Colonel Berger (personnage fictif des Noyers de l’Altenburg écrits entre-temps) , commande la Brigade Alsace-Lorraine qui se bat à Dannemarie et participe à la libération de l’Alsace. Sur le plan de l’action, ses engagements multiples d’homme de gauche, sinon de communiste (il ne s’est jamais inscrit au parti que je sache), lui valent l’admiration des uns, la haine des autres.
Qu’en est-il de ses romans, qui mettent en scène plusieurs des grandes luttes politiques du siècle? Dans La Voie royale Perken, en homme politique un peu original, cherche à créer un royaume à lui, à « laisser une cicatrice sur la carte », mais meurt d’une gangrène, concrétisation du cancer du temps qui ronge toute entreprise humaine et de « la vanité d’être homme »[6]. Les Conquérants ne finissent pas mieux: Garine se jette dans l’action révolutionnaire en Chine sans toutefois aimer les pauvres pour qui il combat. C’est plutôt une fuite devant l’absurde, mais qui n’aboutit qu’à sa mort imminente. L’action révolutionnaire peut permettre, un certain temps, d’échapper aux questions essentielles, m’a dit Malraux, mais elle n’y donne pas de réponse adéquate.[7] Trotsky critiquera vivement ce roman, trouvant que l’auteur aurait besoin d’une bonne innoculation de marxisme.[8] Malraux est (et restera) un compagnon de route peu orthodoxe[9] ; dans sa « Réponse à Trotsky »[10] il souligne le fait que Les Conquérants sont un roman et non un traité politique. La politique sert ici plutôt de toile de fond pour les questions essentielles que Malraux se pose et nous pose.[11]
La Condition humaine—titre qui pourrait s’appliquer à toute l’œuvre de Malraux—apporte des bribes de réponse: le don de soi à l’action révolutionnaire ou à ceux que l’on aime, la solidarité, les « qualités du cœur » auxquelles on est obligé de croire, selon Katow, « surtout parce qu’on ne croit à rien »[12]. De nouveau, ce n’est pas la politique de Moscou qui prime—loin s’en faut, puisque Moscou lâche les insurgés de Shanghaï pour des raisons de Realpolitik—, mais le sens de la vie, « l’humaine condition » de Pascal dont la scène du préau reprend l’image brutale.
Le Temps du mépris s’inscrit clairement dans la lutte antifasciste que mène Malraux dans les années 30. Fait prisonnier par les Nazis, le communiste Kassner est soutenu dans sa lutte contre l’isolement et la torture par des camarades dont l’un se livre à la mort pour le faire libérer. Dans sa préface, Malraux souligne l’importance de cette communion humaine: « Il est difficile d’être homme. Mais pas plus de le devenir en approfondissant sa communion qu’en cultivant sa différence—et la première nourrit avec autant de force que la seconde ce par quoi l’homme est homme, ce par quoi il se dépasse, crée, invente ou se conçoit »[13]. C’est cette communion que Malraux recherche.
C’est pendant la guerre d’Espagne qu’il en fait l’expérience vécue. Mais Nicholas Hewitt a montré à quel point L’Espoir, où pour la première fois le peuple ordinaire a un rôle réel dans un roman de Malraux, n’est pas sans ambiguïté, et garde une perspective encore élitiste et autoritaire[14]. Pour Robert Sayre aussi, ce roman occulte tout l’aspect politique de la lutte révolutionnaire en Espagne et réduit la guerre à la simple question d’une opposition efficace et disciplinée sur le plan militaire à la révolte fasciste— »l’organisation de l’Apocalypse »—, adoptant ainsi la politique stalinienne en Espagne, politique qui a provoqué la suppression des anarchistes et de toute opposition non communiste à Franco. D’après Sayre, Malraux aurait des affinités cachées et effectivement réprimées avec le fascisme qu’il a toujours combattu.[15]
Au-delà de ces considérations politiques, L’Espoir commence à développer la notion d’une communion à travers le temps et l’espace dans le domaine de l’art, d’une permanence humaine en face d’un cosmos indifférent, permanence qui permettrait de fonder à nouveau la notion de l’homme—une quête qui va continuer dans le roman-méditation des Noyers de l’Altenburg—où de nouveau le peuple joue un rôle primordial, ainsi que dans les divers textes qui finiront par former Le Miroir des limbes.
La fin de la guerre voit la rencontre Malraux/de Gaulle—rencontre qui reste mystérieuse mais qui va déterminer l’engagement et l’action politiques de Malraux pendant 25 ans. Ici une parenthèse: d’après Claude Mauriac, Malraux avait une ambition politique forcenée et aurait aimé être ministre de l’Intérieur.[16] Malraux entre dans le premier gouvernement de De Gaulle comme conseiller technique, puis Ministre de l’Information, et devient délégué à la propagande du RPF dès sa création en 1946. Rappelé à diverses fonctions au gouvernement par de Gaulle en 1958, il est nommé en juillet 1959 ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles, poste où il s’illustre jusqu’à la démission de De Gaulle en 1969.[17] Malraux soutient sans faille la politique du Président, ce qui lui vaut des critiques, des dénonciations, des accusations de trahison de la part de ses anciens compagnons de route—communistes ou non—de la lutte antifasciste des années 30, et même un attentat au plastic en 1962.
Ce cheminement peut en effet paraître étrange mais, d’après l’analyse convaincante de Janine Mossuz-Lavau, « il répond à une logique et constitue un aboutissement plus qu’une dérive ou une rupture ».[18] Si Malraux entreprend une campagne contre les communistes, ses anciens compagnons, ce n’est pas lui qui les aurait trahis, mais plutôt eux qui ont changé, comme le souligne avec véhémence Claude Mauriac: « Ce n’est pas une trahison, c’est un courage! »—un courage rare à l’époque parmi les intellectuels dont la majorité sont restés staliniens.[19] Le rêve de justice sociale et de liberté du communisme primitif auquel il croyait s’était transformé en totalitarisme,[20] comme Malraux le déclare en 1948: « Il n’était pas entendu que les lendemains qui chantent seraient ce long hululement qui monte de la Caspienne à la Mer blanche, et que leur chant serait le chant des bagnards »[21]. De plus, il condamne la volonté de puissance, l’impérialisme du stalinisme russe comme une trahison de la Révolution, sans pour autant condamner en bloc et de façon simpliste le communisme ou les communistes.[22]
Pour Malraux le gaullisme, dès 1948, est appelé à être « un mouvement de santé publique », le RPF doit rassembler des gens de tous les bords—« ni la gauche, ni la droite », mais, dit-il, « le pays »[23]—autour de celui qui avait maintenu l’honneur du pays « comme un invincible songe ».[24] Quand de Gaulle revient au pouvoir, Malraux l’appuie entre autres contre les attaques de la gauche non communiste qu’il accuse de vouloir revenir au régime détestable des partis. Il apporte au gaullisme une vision élargie de l’union nationale, l’inscrivant dans une filiation Révolution française/Résistance/ Gaullisme, présentant une image correspondant à trois exigences qui rythment depuis toujours, ou presque, ses propres engagements: la liberté, la fraternité et l’autorité.[25] Lui qui avait, dans la Résistance, « épousé la France », a trouvé en de Gaulle celui qui correspondait à ses exigences, à ses rêves.
Pour Malraux lui-même, il y a continuité et non rupture entre ses engagements précédents et son choix de la France sous de Gaulle, comme pour beaucoup d’autres gaullistes de gauche: « Nous avons eu, dit-il, un lien avec une collectivité déterminée qui était le prolétariat, nous avons eu ensuite le même mariage avec une autre collectivité qui s’appelle la France et, pour moi, il n’y a aucune espèce de différence ni de rupture […] il n’y a surtout pas de différence de comportement. Le lien profond est le même ».[26]
Il reste jusqu’au bout fidèle à de Gaulle qui, pour lui, incarne la France dans ce qu’elle a d’universel quand elle parle au nom de tous les hommes, et, ce faisant, il reste fidèle à lui-même. Comme le note Shinichi Ogasawara: « S’il ne s’est pas détaché de la politique, s’il est resté fidèle à de Gaulle à l’époque sans doute la plus amère de sa vie, c’est que son engagement tenait précisément à cette décision qu’il avait prise de vivre jusqu’au bout le tragique de la politique. Ce tragique, il ne se révèle ni chez le politicien, ni chez l’homme d’action inné, ni chez l’intellectuel qui flirte avec le monde politique—il s’incarne chez l’homme qui s’est engagé jusqu’à trahir, pour la réaliser, l’idée qu’il a prônée en tant qu’homme de vérité ».[27]
François Mauriac, lui, s’il ne participe jamais directement au gouvernement comme Malraux, s’il se sent étranger à la faune politicienne, n’en est pas moins présent sur la scène politique de son temps, et ceci pendant plusieurs décennies. Pourquoi? C’est la politique qui aura éveillé la conscience religieuse de Mauriac dès son adolescence, à partir du jour, sans doute, où son oncle Louis quitta la table après une discussion orgageuse sur l’affaire Dreyfus en lançant: « Et pourtant, mes enfants, il est innocent! » Claude Mauriac affirme que cet incident a fortement marqué le jeune François[28], qui combattra des années durant ce que Lacouture appelle « les pesanteurs sociologiques et les adhérences du milieu »[29] pour parler et écrire enfin selon sa conscience (20.2.65).[30] Il reconnaît qu’il ne s’est jamais soucié de ce qui se passait au-dehors « que dans la mesure où au-dedans la grâce l’emportait sur la nature » (18.12.58). Il lui faudra en effet un effort permanent pour venir à bout de sa pente naturelle. D’après Jean Guitton, qui connaît Mauriac depuis 1917, celui-ci aurait dit: « Mon cœur est à gauche, mais j’aime le confort. Or, le confort n’est qu’à droite ».[31]
Mauriac travaillera toute sa vie pour combattre, non seulement ses penchants naturelles mais aussi une certaine association entre la religion et une politique de droite, que ce soit un nationalisme raciste (18.12.58) ou une « solidarité mortelle » entre l’Eglise de France et les partis de droite (15.11.54). Ses engagements successifs au moment de l’Abyssinie, de l’Espagne, du Maroc, de l’Algérie visent à contrecarrer les abominations du christianisme politique qui bafoue l’enseignement du Christ (6.7.56). Son effort politique porte essentiellement sur la défense des droits de l’homme, qu’il soit noir ou blanc, chrétien ou juif, musulman ou athée; il vise le repect et la compréhension entre classes, races, peuples et idéologies; il s’efforce de comprendre l’autre tel qu’il est.
Sa vision et son engagement politiques découlent directement de sa foi de chrétien: « Ma vocation est politique dans la stricte mesure où elle est religieuse » (19.9.53). Mais il refuse de mettre sa croyance au service de la classe possédante, car l’autre monde pénètre ce monde-ci: « Nous devons les confondre dans notre amour, mais en nous gardant de compromettre cette espérance que nous incarnons avec des opinions, avec des passions politiques, si légitimes qu’elles soient » (13.5.65).
L’itinéraire politique de Mauriac, formé entre autres par ses contacts avec le Sillon et par sa réflexion sur sa foi et ses exigences de justice dès ici-bas, amènera ce Bordelais de milieu bourgeois, janséniste et conservateur à se mettre au service d’idées et de causes qui sont ou devraient être celles de la gauche (29.11.64 et 27.4.67): « trahison » de son milieu, de sa classe, de la majorité des fidèles et de la hiérarchie de son église—et tous le lui feront savoir—mais fidélité aux exigences de sa foi. Georges Hourdin, qui a suivi un chemin semblable, insiste sur ce point. Pour lui, Mauriac était « un homme de droite qui s’est embarqué dans des tendances, dans des bagarres qui n’étaient pas les siennes, parce qu’il était chrétien. C’est uniquement parce qu’il était chrétien ».[32] Et Mauriac de tomber d’accord: « Que la passion politique m’entraîne ou m’égare, il n’en reste pas moins vrai que je suis engagé dans ces problèmes d’en bas pour des raisons d’en haut » (1.5.54).
Quelles sont les grandes lignes de l’action et de la pensée politiques de Mauriac? Contrairement à Malraux, il ne participe pas directement au gouvernement, mais comme lui, il répugne au régime des partis politiciens, « destructeur de tout gouvernement » (1.2.55). Lui-même reste libre, même pendant ses années de fidélité gaulliste, de critiquer ce que bon lui semble, de dire ce qui lui semble vrai au moment où il écrit, « sans tenir compte d’aucun mot d’ordre ni d’aucune opportunité ». Cela fait de lui, comme il le note, « à droite comme à gauche, un compagnon peu sûr » (19.7.59). Nourri de sa foi, il cherche le Royaume de Dieu et sa justice dès ici-bas: il défend les petits contre les grands, les pauvres contre les nantis, que ce soit des individus ou des peuples; il défend des accusés, qu’ils s’appellent Mendès France, Henri Alleg ou même Brasillach; il soutient fidèlement de Gaulle, en qui il voit, comme Malraux, l’incarnation d’une certaine vision de la France, d’une France à vocation universelle—vision où il entre en plus, pour Mauriac, un brin de mysticisme (4.7.59). « Il s’agit pour nous, dans ce déclin où nous nous débattons, il s’agit de demeurer fidèles aux valeurs que la France incarne et de tout faire pour que la France elle-même y demeure fidèle. Dans ce combat, étroitement lié pour le chrétien à sa vocation spirituelle, nous nous rejoignons tous » (5.1.57).
En même temps, en politique, Mauriac reste, comme Malraux, un réaliste, comprenant que la politique n’est pas un absolu, mais une série de décisions à prendre entre telle possibilité réelle et telle autre: « Le sens politique, croyez-moi, c’est le sens du réel, c’est le sens du possible […] La vraie politique ne se ramène pas à la recherche de l’absolu » (24.7.59), elle est « de ce monde » (6.4.54). Mauriac n’investit donc aucun système, aucune action politique, de valeur absolue; il n’a de certitudes qu’en la foi. En politique il se contente d’opinions et de préférences,[33] il reste pragmatiste (30.11.58) et ne se sent vraiment à l’aise que lors que les exigences de la morale absolue se confondent avec l’intérêt évident de la nation (8.5.60).
D’où la liberté, la souplesse de la pensée, de l’engagement politiques de Mauriac, qui font qu’il est si difficile à classer sous une catégorie toute faite, qu’il faut effectivement le chercher tantôt à gauche, tantôt à droite, selon la situation précise où il prend position. Il rejette le « manichéisme naïf » qui situe le bien à droite et le mal à gauche, ou vice versa (13.3.56). Il ne se laisse pas enfermer dans une optique, une approche politique toute faite. S’il s’attaque à la droite, « cette mule butée » (9.3.58) qui a été « dopée » et détruite par l’Action française, et qui est au service d’intérêts avides qui « calomnient la France et la défigurent » (22.7.55), il fulmine tout autant contre la gauche « qui a atteint à ce degré d’humiliation dont [il] doute que l’histoire de la République offre un autre exemplen » (1.2.57). Car pour lui, ce qu’il y a de pire, dans une démocratie, c’est de « faire accomplir par un gouvernement dit de gauche la politique la plus aveugle et la plus meurtrière de la droite » (16.9.57).
La profonde unité sous cette diversité, c’est l’effort permanent de Mauriac de mettre sa foi en pratique dans le monde réel. Mauriac a-t-il trahi ou est-il resté fidèle à lui-même et à ses engagements essentiels? Je serais tenté d’y répondre en appliquant au polémiste chrétien le jugement que lui, dans sa générosité de cœur et ouverture d’esprit, portait sur Sartre, l’athée qui l’avait si vertement attaqué à l’époque. Je n’y change que deux mots:
« On peut penser ce qu’on voudra du [polémiste], de l’essayiste, du romancier, du dramaturge; mais enfin ce grand écrivain est un homme vrai, et c’est là sa gloire[…] Un homme vrai, cela ne court pas les rues, ni les salles de rédaction, ni les antichambres des éditeurs. C’est parce qu’il est un homme vrai que [Mauriac] atteint ceux qui sont le plus étrangers à sa pensée et le plus hostiles au parti qu’il a pris. Un homme vrai, tout ce qu’il dit, tout ce qu’il écrit l’engage. Cela, qui va de soi pour lui, étonne dans un monde où les gestes ni les paroles n’engagent plus personne » (23.10.64).
Brian Thompson, University of Massachusetts/Boston
[1] Les dates entre parenthèses dans le texte renvoient aux cinq volumes des Bloc-Notes disponibles chez Flammarion (1959-70) ou dans la magistrale édition annotée de Jean Touzot dans la collection Points (Seuil, 1993).
[2] Clara Malraux, Le Bruit de nos pas, surtout tome I: Apprendre à vivre , Grasset, 1963. Voir aussi l’étude minitieuse d’André Vandegans, La Jeunesse littéraire d’André Malraux, Jean-Jacques Pauvert, 1964.
[3] Cité par Jean Lacouture, François Mauriac, Seuil, 1980, p. 290
[4] Le Baillon dénoué dans le tome XI des Œuvres complètes, Fayard, 1952, p. 435.
[5] Voir entre autres la postface à la traduction allemande des Conquérants où Malraux est présenté comme directeur suppléant de la propagande de la révolution chinoise.
[6] La Voie royale, Skira, p. 178.
[7] Entretien d’André Malraux avec l’auteur, édité sous le titre « L’Art et le roman: L’Imagination visuelle du romancier » dans tome IV de la série Malraux chez Lettres Modernes, Malraux et l’art (1978).
[8] Léon Trotsky, « La Révolution étranglée, » Nouvelle Revue Française, avril 1931, 488-500. Repris dans André Malraux, Cahier de l’Herne, 1982, pp. 38-44.
[9] Dans un Bloc-notes Mauriac note: « Le jeune Malraux était communiste. Fut-il jamais orthodoxe? J’en doute beaucoup. Quel solitaire il était, qu’il me paraissait autonome, le garçon éblouissant qui venait me voir quelquefois, dans les années 20! […] Si Malraux avait été tué en Espagne, il eût été le martyr d’une autre cause que la foi marxiste » (5.1.57).
[10] André Malraux, « Réponse à Trotsky, » Nouvelle Revue Française, avril 1931, pp. 501-507. Repris dans le Cahier de l’Herne pp. 45-48.
[11] Voir le jugement de Mauriac en 1958: « Et aujourd’hui, parmi les vivants, l’une des œuvres les plus hautes, celle de Malraux, est née, il me semble, de l’engagement d’un jeune être dans ce combat spirituel et sanglant, qui oppose à la fois les corps et les esprits. Certes une œuvre comme la sienne transcende la politique; il n’empêche que la politique pénètre la condition humaine au point que c’est se condamner au néant, et singulièrement pour un romancier, que de prétendre
l’ignorer » (27.9.58).
[12] La Conditon humaine, dans Romans , Pléiade, 1947, p. 406. C’est moi qui souligne.
[13] Le Temps du mépris, Skira, p. 13.
[14] Nicholas Hewitt, « Authoritarianism and Esthetics, » in Witnessing André Malraux: Visions and Re-visions, éd. Brian Thompson et Carl Viggiani, Middletown CT, Wesleyan University Press, 1984, (Wesleyan Paperback, 1988), pp. 113-124.
[15] Robert Sayre, « L’Espoir and Stalinism, » in Witnessing André Malraux , pp. 125-139.
[16] Entretien de Claude Mauriac avec l’auteur, le 8 janvier 1994. Malraux aurait même dit: « Il y a deux hommes politiques en France, de Gaulle et moi ».
[17] Sur l’évolution des fonctions de Malraux et de son ministère, voir Geneviève Poujol, « La Création du Ministère des Affaires Culturelles, 1959-1969: Eléments pour la recherche », document du Ministère de la Culture et de la Francophonie, 1993. Je remercie Mme Henriette Colin du Comité National André Malraux de m’avoir signalé ce document.
[18] Janine Mossuz-Lavau, « André Malraux et le gaullisme, » Cahier de l’Herne, p. 313. Je suis de près ici l’analyse développée dans cet article dont je recommande la lecture.
[19] Entretien de Claude Mauriac avec l’auteur, le 8 janvier 1994. Claude Mauriac déplore que l’espoir que le communisme représentait pour Malraux et d’autres n’existe plus dans notre monde où le capitalisme domine.
[20] Malraux a pu en voir certains aspects dès son séjour à Moscou en 1934. Ses carnets de voyage, une fois publiés, jetteront une lumière intéressante sur sa perception du régime soviétique.
[21] « Appel aux intellectuels », 5 mars 1948. Repris en postface aux Conquérants, Gallimard, édition de 1953, p. 198. François Mauriac parle des « lendemains qui chantent » comme la « phrase la plus bête qu’aucune oreille humaine ait jamais entendue ». « Quel autre lendemain pour vous que la pourriture, que la dissolution et que le néant? » (samedi 9 janvier 1965).
[22] Janine Mossuz-Lavau, p. 315.
[23] Le Rassemblement , no. 78, samedi 16 octobre 1948.
[24] Le Rassemblement , no. 53, samedi 24 avril 1948.
[25] Janine Mossuz-Lavau, p. 321.
[26] « Consolation ou apaisement, je ne crois pas… », entretien du 5 mai 1969 avec Kommen Becirovic pour la Radio-Télévision yougoslave et l’hebdomadaire belgradois Nin , repris dans le Cahier de l’Herne, p. 16.
[27] Shinichi Ogasawara, « Les deux engagements de Malraux, » Cahier de l’Herne, p. 225.
[28] Entretien de Claude Mauriac avec l’auteur, le 24 juillet 1980.
[29] Jean Lacouture, François Mauriac, Seuil, 1980, p. 304.
[30] Sur les rapports entre la foi et l’engagement politique chez Mauriac, voir mon article « Mauriac polémiste quoique ou parce que chrétien?”, Cahiers François Mauriac no. 8 (1981), pp. 174-186 sur lequel s’appuie en partie le présent travail.
[31] Entretien de Jean Guitton avec l’auteur, le 7 juillet 1980.
[32] Entretien de Georges Hourdin avec l’auteur le 24 juillet 1980
[33] Journal I, Œuvres complètes XI, p. 47.