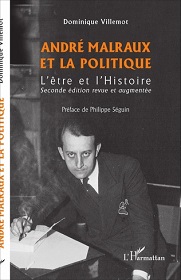RUPTURE OU FIDELITE ? LES INTELLECTUELS FACE AU PARCOURS POLITIQUE D’ANDRE MALRAUX
Par Dominique VILLEMOT
Diplômé de l’IEP Paris, ancien élève ENA
Ancien haut fonctionnaire, avocat,
Président du think tank Démocratie Vivante,
Membre fondateur des Amitiés internationales André Malraux,
Auteur de « André Malraux et la politique » L’Harmattan
24 novembre 2023
André Malraux s’est engagé politiquement à gauche de 1925 à 1939, puis, à compter de 1945, il s’est attaché à la personne du général de Gaulle et au gaullisme.
Ses deux engagements furent-ils de même nature ? Comment expliquer le passage de l’un à l’autre ?
Y a-t-il eu rupture ou continuité ?
Ces questions ont suscité de nombreux commentaires de la part des contemporains de Malraux, particulièrement durant l’immédiat après-guerre. Les intellectuels de gauche, et notamment les proches du parti communiste, ont ainsi considéré qu’il s’agissait d’un renoncement, d’un changement radical et même d’une trahison. Le vrai Malraux, le romancier et intellectuel de gauche, serait mort en rejoignant le gaullisme.
Les intellectuels de gauche et le PCF se mobilisent en effet à partir de 1947 contre le général de Gaulle et son parti le RPF et donc contre André Malraux qui en est devenu un des principaux dirigeants.
Il faut dire que 1947 marque le début de la guerre froide et la sortie des communistes du gouvernement. Quant à André Malraux, il est devenu le responsable de la propagande du RPF et tient des discours virulents contre les communistes, accusés d’être des séparatistes et d’appartenir à un parti de l’étranger.
Ainsi en 1948, Emmanuel Mounier publie dans la revue Esprit un long article intitulé « André Malraux ou l’impossible déchéance » dans lequel il s’inquiète de l’évolution politique de ce dernier, évolution qu’il regrette et qu’il attribue à une vision pessimiste de l’Histoire. Il essaie de se convaincre que Malraux n’a pas abandonné ses valeurs.
Mais, dans ce même numéro d’Esprit[1], consacré entièrement à l’auteur de la Condition humaine, d’autre auteurs n’y vont pas par quatre chemins. Albert Béguin va jusqu’à dire de Malraux : « Il est, en un sens, le seul authentique fasciste français. Car, dans ce pays, où on appelle fascistes les réactionnaires, les conservateurs, les esprits immobiles, il est à peu près seul à avoir suivi la voie classique qui mène au fascisme : la voie du révolutionnaire, demeuré révolutionnaire, mais qui par expérience de l’échec ou par propension innée, en vient à désespérer des hommes. »
Jean Lacouture[2] cite aussi Pierre Hervé du PCF qui écrit dans la revue Action : « On se demande en vérité pourquoi Mounier cherche midi à quatorze heures avec une telle obstination. Qui n’a jamais dit ou pensé que Malraux est littéralement parlant conservateur ou réactionnaire ? Il est fasciste. Entendez-vous Mounier ? Fasciste ! »
C’est aussi l’époque ou Jean-Paul Sartre ne voyait pas de différence entre le général de Gaulle et le maréchal Pétain.
On a du mal à comprendre aujourd’hui comment certains ont pu traiter Malraux de fasciste du simple fait qu’il ait adhéré au gaullisme.
Il est vrai que devenu délégué à la propagande du RPF il a tenu des discours très anticommunistes. Il est vrai aussi qu’il était persuadé que les communistes préparaient un coup d’Etat et qu’il a laissé entendre que pour lui une démocratie véritable n’était pas possible en face d’un parti stalinien. Il est vrai que le programme du RPF était antiparlementariste et anticommuniste et que ses meetings ressemblaient à ceux des Croix de feu de l’entre-deux-guerres. Mais de là à traiter Malraux de fasciste !
Les choses s’arrangèrent ensuite progressivement entre Malraux et les intellectuels de gauche.
En effet à partir de 1949 Malraux prend du recul par rapport au RPF pour se consacrer à ses écrits sur l’art.
Puis la guerre d’Algérie allait les rapprocher. En 1958 il signe avec François Mauriac, Roger Martin du Gard et Jean-Paul Sartre une adresse solennelle au président de la République René Coty, protestant contre la saisine du livre d’Henri Alleg la Question qui dénonçait l’usage de la torture en Algérie. Ce texte demandait aussi au président de la République de condamner l’usage de la torture.
La gauche soutint aussi le général de Gaulle contre le putsch des généraux d’Alger d’avril 1961. Le 7 février 1962 l’OAS perpétra un attentat contre le domicile de Malraux et blessa gravement la petite fille des gardiens de sa maison.
Et puis, comme ministre des Affaires culturelles, Malraux mena une politique de démocratisation de la culture qui s’inscrivait dans les pas de celle de Léo Lagrange, chargé des sports et des loisirs dans le gouvernement de front populaire et que Malraux avait bien connu : « Autant qu’à l’école, les masses ont droit au théâtre, au musée. Il faut faire pour la culture ce que Jules Ferry faisait pour l’instruction »[3]. Il nomma des personnes de gauche à la tête des maisons de la culture qu’il créa. Il défendit en 1966 devant l’Assemblée nationale la représentation au théâtre de l’Odéon des Paravents de Genet dénoncée par l’extrême-droite.
Il dut cependant muter plusieurs responsables des maisons de la culture en mai 68 et révoqua en août 1968 Jean-Louis Barrault de la présidence du théâtre de l’Odéon pour avoir publiquement dénoncé durant les évènements de mai ce qu’il appelait l’inanité de la politique culturelle du régime gaulliste.
Cet apaisement des relations entre les intellectuels de gauche et André Malraux s’explique aussi par le remplacement de la guerre froide par la détente. Plus personne ne croit plus à un coup d’état communiste et Malraux a cessé de tenir des discours anticommunistes. Le général de Gaulle a sorti la France du commandement militaire intégré de l’OTAN, a engagé une politique d’ouverture vers l’URSS et a condamné l’intervention américaine au Viêt-Nam lors de son discours de Phnom-Penh de 1966. La consigne de Moscou au PCF est claire : il ne faut pas gêner la politique étrangère du général de Gaulle.
Pour les communistes, le gaullisme n’est plus un fascisme, mais seulement le représentant du capitalisme monopoliste d’Etat, concept marxisant et trop intellectuel pour mobiliser les masses. Et puis les communistes ont perdu le monopole de l’opposition de gauche au gaullisme, avec l’arrivée de François Mitterrand sur leur flanc droit et surtout avec l’apparition des mouvements gauchistes qui les débordent sur leur gauche en Mai 68.
Mais, pour autant, si les intellectuels de gauche n’envisagent plus de le traiter de fasciste, ils continuent à considérer que sa conversion du communisme au gaullisme a constitué une véritable rupture dans l’engagement politiquer d’André Malraux.
Comment André Malraux de communiste a-t-il pu devenir anti-communiste ?
Le communisme de Malraux (1933-1939)
« Le communisme redonne à l’homme sa fertilité en le mettant en rapport avec ce qui l’entoure » (préface du Temps du Mépris)[4]. Dans cette belle phrase André Malraux exprime ce qui dans le communisme l’a attiré :
- la fertilité. Malraux est un intellectuel et un psychologue de l’art. Pour lui le communisme fut un enrichissement intellectuel. En cela Malraux s’inscrit dans la lignée des intellectuels de gauche, qui rapprochent progressisme politique et progrès intellectuel.
- le rapport avec ce qui entoure l’homme. Dans le communisme Malraux a vu un romantisme révolutionnaire fondé sur la fraternité des hommes qui permet à l’individu de dépasser son isolement et de communier avec les autres.
Le communisme d’André Malraux n’a donc pas eu grand-chose à voir avec une adhésion à la philosophie marxiste. La lutte des classes est absente des romans et des discours de Malraux. Trotski disait d’ailleurs qu’une bonne inoculation de marxisme aurait permis de résoudre les contradictions de l’auteur des Conquérants.
Malraux a-t-il jamais été marxiste ? Parlant du concept de la lutte des classes comme explication de l’histoire, Malraux écrit en 1953 : « Je ne l’avais jamais accepté comme telle »[5] (note dans le Malraux de G. Picon).
La période strictement communiste de Malraux va du début 1933, lorsqu’il s’affilie à l’association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR), organisation prosoviétique, à août 1939, époque de la signature du pacte germano-soviétique, soit environ six ans et demi, ce qui en fait n’est pas très long.
A la limite, l’engagement communiste de Malraux constitue une parenthèse dans sa carrière politique, mais une parenthèse passionnée et dense. Cette période a cependant été précédée de huit années d’engagement pendant lesquelles Malraux était déjà indiscutablement un homme de gauche. Sa campagne en Indochine en 1925 et 1926 pour défendre les Indochinois contre les injustices du système colonial lui avait permis d’aiguiser sa plume dans L’Indochine Enchaînée et de rencontrer de nombreux hommes de gauche. Il y a découvert le mythe de la Révolution ainsi que l’Asie, thèmes qui seront à l’origine de ses premiers romans.
La parution des Conquérants en 1928, qui décrit la situation révolutionnaire de Canton en 1925, donna à son auteur un label de spécialiste de la révolution chinoise. Cette croyance fut renforcée par l’attitude de Trotski qui se mit à dialoguer, par écrit, avec Malraux, s’adressant à lui comme s’il parlait à un révolutionnaire expérimenté et ne doutant pas un instant que les Conquérants relataient une histoire vécue.
Ayant pris goût à ce jeu Malraux déclara, en présentant La Condition humaine en 1933, que ce livre était un plaidoyer pour le rôle historique joué en Asie par les communistes. Couronné par le prix Goncourt, Malraux devint une célébrité internationale qui incarna l’idéal révolutionnaire et fut un modèle pour toute une génération d’intellectuels et d’étudiants de gauche.
Le goût pour la célébrité ne suffit cependant pas à expliquer l’attirance progressive de Malraux pour le communisme.
Tout d’abord il était profondément un homme de gauche, attaché à la liberté et à la défense de la dignité humaine. « En combattant avec les Républicains et les Communistes espagnols, nous défendions des valeurs que nous tenions (que je tiens) pour universelles »[6]. « Il y a des guerres justes, la nôtre en ce moment »[7] (L’Espoir) et cette autre phrase tirée elle aussi de L’Espoir : « On ne fait pas de la politique avec de la morale mais on ne la fait pas non plus sans »[8].
Malraux a des convictions bien ancrées et il se bat pour elles. Mais pourquoi aux côtés des communistes ? Parce que ce sont les seuls à pouvoir s’opposer de manière efficace au fascisme. « Le fascisme allemand nous montre que nous sommes face à la guerre »[9] annonça-t-il en mars 1933. Pour Malraux l’arrivée d’Hitler au pouvoir débouchera obligatoirement à terme sur la guerre entre le fascisme et les démocraties, mais seuls les communistes et l’Union soviétique peuvent endiguer le fascisme.
Le ralliement de Malraux au communisme coïncida donc avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir et avec l’adoption par l’URSS de la stratégie dite des fronts populaires. Malraux fut frappé à l’époque par l’incapacité des démocraties européennes à défendre la liberté et la démocratie ; par contraste, il était sensible à la vitalité du mouvement révolutionnaire et à l’efficacité de l’organisation communiste.
Mais, la primauté de cette efficacité, de cette capacité d’action des communistes inquiète quand même l’auteur de L’Espoir. « Les communistes ont toutes les vertus de l’action, et celles-là seules »[10] dit Guernico. Mais « En ce moment c’est d’action qu’il s’agit »[11] lui rétorque Garcia.
Le communisme de Malraux présenta toujours de nombreuses caractéristiques originales :
- Malraux n’adhéra jamais officiellement au parti communiste français. Il en fut seulement un compagnon de route ;
- Malgré son engagement prosoviétique il conserva une grande estime pour Trotski allant semble-t-il jusqu’à participer financièrement à l’entretien de ses gardes du corps pour le protéger des assassins à la solde de Staline. Cela dit, durant la guerre d’Espagne il soutint officiellement la ligne défendue par l’Union soviétique et fut âprement critiqué par les trotskistes ; il sous-estima le rôle des trotskistes durant la guerre d’Espagne et polémiqua avec Trotski à ce propos. Il ne dénonça pas non plus la répression des trotskistes par les staliniens durant la guerre d’Espagne ;
- il critiqua la position de l’URSS face à la liberté d’expression déclarant à Moscou, en s’adressant aux Soviétiques en 1934 : « La confiance que vous faites à tous, vous ne la faites pas toujours assez aux écrivains… L’art n’est pas une soumission c’est une conquête »[12] Mais, non seulement, il ne suivit pas André Gide dans sa critique du régime stalinien dans son Retour d’URSS, mais en plus de 1935 à 1939 il donna l’impression de s’aligner sans nuance sur la ligne stalinienne ;
- il resta largement incontrôlable par le parti, notamment lorsqu’il partit se battre en Espagne. Le parti communiste aimait les intellectuels qui écrivent et signent des pétitions mais guère ceux qui vont sur le terrain et qui échappent à la discipline révolutionnaire. Le rôle de Malraux en Espagne prit fin en février 1937 lors de l’arrivée des brigades internationales encadrées par les Soviétiques ;
Si de 1933 à 1939 Malraux a bien été proche du parti communiste, on peut toutefois se demander s’il est juste de le qualifier réellement de communiste. Il fut à cette époque avant tout un antifasciste qui fut un compagnon de route du parti communiste. Ce dernier incarnait pour lui le mythe de la Révolution et surtout représentait l’efficacité face à la montée du péril fasciste.
Ce choix de l’efficacité fit cependant que, de 1935 à 1939, les positions qu’il défendit officiellement permettront de le cataloguer comme un stalinien. Pendant ces quatre années la lutte contre le fascisme et la défense de la République espagnole primèrent sur tout le reste.
L’inquiétude de Malraux face à l’organisation communiste (« Vous êtes bouffés par le parti. Bouffés par la discipline », déclare le Négus aux communistes dans L’Espoir[13]), son indignation devant les méthodes des brigades internationales en Espagne face aux anarcho-syndicalistes et aux trotskistes, qu’il n’exprima pas publiquement mais qui transparaît dans L’Espoir, puis surtout la signaturedu pacte germano-soviétique vont détacher progressivement Malraux du communisme. En 1944, lorsqu’il commence à prendre contact avec les réseaux de la Résistance, c’est vers les gaullistes qu’il se tourne et non vers les communistes.
Comme dit plus haut, de procommuniste Malraux devint anticommuniste pendant la période où il dirigea la propagande du RPF en 1947-49. Les communistes furent alors accusés par lui d’être des séparatistes et de représenter le parti de l’étranger. Ils sont l’instrument de la domination soviétique.
Malraux ne renia pas pour autant ses engagements antérieurs. « Nous sommes à cette tribune et nous n’y renions pas l’Espagne. Qu’y monte un jour un stalinien pour défendre Trotski » (postface des Conquérants)[14]. Pour Malraux ce n’est pas lui qui a changé, mais les communistes. « Il est arrivé à André Gide et à moi-même d’être sollicités de porter à Hitler les pétitions de protestation contre la condamnation de Dimitrov… Lorsque, maintenant, Dimitrov au pouvoir fait pendre Petkov innocent, qui est-ce qui a changé ? Gide et moi, ou Dimitrov ? »[15] (Ibid.).
Malraux réécrit cependant un peu l’histoire. Son adhésion aux thèses de Trotski fut en effet plus forte après 1940 que pendant la guerre d’Espagne.
Comme dit plus haut, le soutien de Malraux au communisme entre 1933 et 1939 s’expliquait par l’adhésion au mythe de la Révolution et par le choix de l’efficacité contre le fascisme. La défaite de la République espagnole en mars 1939 puis la signature du pacte germano-soviétique en août 1939 sonnent alors le glas du mythe de la Révolution portée par l’Union soviétique. A compter de 1945 les partis communistes n’apparaissent plus que comme des outils au service de Staline.
Ce n’est donc pas vraiment le communisme que Malraux combat en 1947-1949, mais le stalinisme et la Russie qui menacent la liberté de la France.
Durant les années soixante, la fin de la guerre froide et l’ouverture du général de Gaulle vers Moscou ont changé la situation. Les propos anticommunistes ont disparu des discours de Malraux. Le ministre d’Etat aux affaires culturelles entretient de bonnes relations personnelles avec plusieurs députés communistes.
Repensant à son intervention au congrès du Mouvement de libération nationale (MLN), en 1945, qui fut déterminante pour repousser le projet communiste d’unifier les mouvements de Résistance sous la férule du PCF, Malraux s’abandonne à la nostalgie : « … la fusion était écartée par 250 voix contre 119. Le parti communiste ne disposerait pas de la Résistance contre le général de Gaulle. Mais pendant mon retour au front, à travers la Champagne couverte de neige, je pensais à mes camarades communistes d’Espagne, à l’épopée de la création soviétique, malgré le Guépéou, à l’armée rouge, aux fermiers communistes de Corrèze toujours prêts à nous accueillir malgré la milice… » (Antimémoires)[16].
Pour lui, le communisme reste un mouvement puissant et porteur. En témoigne la phrase qui lui a été prêtée : « entre les communistes et nous, il n’y a personne ». En fait il a écrit en 1949 : « Qu’est-ce qu’il y a en ce moment dans ce pays ? Il y a nous, les communistes, et rien »[17]. Cela signifie que seuls le gaullisme et le communisme méritaient que l’on s’engage pour eux, le libéralisme ou la social-démocratie ne représentant pas pour Malraux des courants d’idées puissants.
La révolution communiste chinoise l’a aussi toujours fasciné, en 1965, lorsqu’il rencontra Mao-Tsé-Toung à Pékin, comme il l’était en 1928, lorsqu’il publia les Conquérants.
De Mao il a écrit : « Aucun homme n’aura si puissamment secoué l’histoire depuis Lénine ». (Antimémoires)[18].
Lénine, Trotski et Mao firent partie du panthéon de Malraux jusqu’à sa mort. La fascination pour la Révolution française, russe ou chinoise, aussi. Pour lui c’est le stalinisme qui était condamnable, non le communisme en lui-même et encore moins les Révolutions, russe ou chinoise.
Son détachement d’avec le communisme ne l’a d’ailleurs jamais amené à dénoncer les fondements mêmes de cette idéologie. Il en a seulement condamné la déviation la plus voyante, le stalinisme, et encore seulement lorsque le stalinisme se sera transformé en idéologie de conquête, c’est à dire à partir de 1945. La dénonciation du Goulag n’a jamais effleuré Malraux. Pour lui l’URSS n’a jamais été un Etat totalitaire par essence. Mettre l’Union Soviétique et l’Allemagne nazie sur le même plan lui aurait paru injustifié et dangereux. La remise en cause des origines de la Révolution russe à travers une critique systématique de Marx et de Lénine, comme l’ont fait les nouveaux philosophes de la fin des années soixante-dix, était tout à fait étrangère à la pensée de Malraux.
« Le marxisme recomposait d’abord le monde selon la liberté. La liberté sentimentale de l’individu a joué un rôle immense dans la Russie de Lénine »[19], déclare-t-il en 1948 (postface des Conquérants). C’est Staline et la tradition russe qui ont perverti l’esprit de la révolution d’Octobre.
De même, il n’aurait sans doute pas accepté que l’on assimilât la révolution culturelle chinoise à une œuvre de répression massive, telle qu’elle est apparue à beaucoup après la mort du Grand Timonier.
Il n’était pas marxiste, il rejeta le stalinisme mais restait fasciné par le mythe de la Révolution, par l’énergie des peuples en révolte, par les héros révolutionnaires comme Lénine ou Mao.
Le gaullisme de Malraux (1945-1970)
D’août 1945, date de sa première rencontre avec le général, à décembre 1969, date de leur dernier entretien, André Malraux été un inconditionnel du général de Gaulle. Il a lié son destin politique à l’homme du 18 juin en lui témoignant une fidélité sans faille.
Comme Malraux est-il devenu gaulliste ?
De manière progressive. Il est passé du communisme militant au gaullisme militant après avoir traversé une période de quasi-indifférence aux événements politiques.
Comme dit plus haut, la défaite de la République espagnole puis la signature du pacte germano-soviétique l’avaient laissé orphelin. Il s’engagea alors comme volontaire dans l’armée française en tant que seconde classe. Il va s’ennuyer dans une caserne de Provins (devenu Chartres dans Les Noyers de l’Altenburg) et ce à partir du 14 avril 1940. Sa guerre va durer un mois. Il fut légèrement blessé et fut prisonnier le 16 juin, puis s’évada en octobre pour aller se réfugier dans le midi.
Cet emprisonnement et cette rencontre avec le peuple de France l’ont profondément marqué, comme en témoignent Les Noyers de l’Altenburg.
Démoralisé, Malraux va se consacrer à sa famille (Josette Clotis et leurs deux fils), à l’écriture et à la réflexion sur l’art.
Il a écrit pourtant au général de Gaulle en décembre 1940 pour offrir ses services à la France libre. N’ayant pas reçu de réponse, il pensa avoir été écarté à cause de son passé de communiste. En fait, le général n’a jamais reçu sa lettre.
Lorsqu’il prit contact avec les mouvements de la Résistance, probablement en mars 1944, soit tard, il se tourna très vite vers les réseaux gaullistes de l’Armée secrète. Il voulait se tenir à l’écart des communistes et choisit donc les gaullistes. Au cours de ses campagnes de la Libération il prit conscience, encore plus qu’en 1940, de l’importance du fait national et de la France. Ses camarades espagnols se battaient pour une idéologie, ses compagnons de la Résistance se battent pour la France.
La Brigade Alsace-Lorraine, qu’il dirigea durant la dure bataille des Vosges et de l’Alsace fin 1944, était composée de personnes simples, sans passé politique, et qui se battaient uniquement par patriotisme.
En janvier 1945, comme déjà indiqué, il prononça un discours décisif au congrès du MLN contre le projet, défendu par le parti communiste, d’unifier les mouvements de la Résistance. « Le gouvernement du général de Gaulle est non seulement le gouvernement de la France mais aussi le gouvernement de la Libération et de la Résistance »[20]. Avant d’avoir rencontré de Gaulle, Malraux était déjà gaulliste.
Impressionné par cette intervention, Gaston Pawleski organisa la rencontre du mois d’août. Malraux croira avoir été appelé par de Gaulle, le général pensera avoir été sollicité par le chef de la brigade Alsace-Lorraine. L’entretien, réécrit à la sauce Malraux, figure dans Antimémoires. « J’avais déjà rencontré cette présence intense, que les paroles n’expriment pas. Ni chez des militaires, ni chez des politiques, ni chez des artistes : chez des grands esprits religieux, dont les paroles affablement banales semblent sans relations avec leur vie intérieure… Le seul personnage que le général de Gaulle appelât alors dans ma mémoire, non par ressemblance, mais par opposition, à la façon dont Ingres appelle Delacroix, c’était Trotski. »[21].
L’effet de séduction sera immédiat. Malraux entra au cabinet du général. Le 21 novembre 1945 il entrait au gouvernement en charge de l’information. Il suivit le général dans sa démission en janvier 1946 et participa ensuite à la fondation du RPF dont il fut l’un des principaux animateurs.
André Malraux fut l’un des barons du gaullisme. Du printemps 1947 à l’été 1949 il sera le « délégué à la propagande » du Rassemblement du peuple français. Il voit dans le RPF un nouveau parti qui ne serait ni communiste ni social-démocrate. Une rencontre entre le travaillisme et la France. Il joue un rôle très important au sein du RPF aux côtés de Soustelle, Debré, Chaban-Delmas et Vallon. Du moins jusqu’à la fin 1949. Malraux se retira alors de l’animation régulière du Rassemblement. Il n’apparaîtra plus que par intermittence aux côtés du général jusqu’en 1953.
Il n’assuma plus ensuite aucune responsabilité politique au sein du parti gaulliste, qu’il s’agisse de l’UNR, de l’UNR-UDT ou de l’UDR. Il garda toujours ses distances vis-à-vis de l’appareil gaulliste, même s’il apparaissait toujours lors des congrès du mouvement en prononçant des discours galvaniseurs, qui détonnaient un peu en comparaison avec les interventions des autres orateurs gaullistes.
Malraux n’a donc pas été longtemps un réel militant gaulliste actif. Il est vrai que pour lui le gaullisme n’a jamais été une idéologie. Il déclarait en 1948 « N’oubliez pas que le gaullisme n’est pas une théorie comme le marxisme ou même le fascisme, c’est un mouvement de salut public… »[22].
Pour Malraux le gaullisme était la continuation de l’esprit de la Révolution française. « Le général ne voit pas, n’a jamais vu dans l’Etat, l’appareil du pouvoir d’une classe, mais l’agent de l’unité nationale toujours menacée ; la Convention l’a vu ainsi »[23] (La Corde et les Souris).
La nation, la France ont tenu une place importante dans la pensée de Malraux. « Le marxisme négocie désormais avec le mystérieux fait national que le général voit au cœur du siècle… La Nation ne tient jamais tout à fait le général de Gaulle pour ennemi. Mao-Tsé-Toung me l’a nommé avant de nommer la France… » (La Corde et les Souris)[24].
Le gaullisme de Malraux fut donc très personnel et original. Mais il précise : « je ne crois pas que mon cas soit exceptionnel. Je pense qu’il en est de même pour ceux qui se nomment gaullistes de gauche. Nous étions liés à une communauté nommée communauté du prolétariat puis nous nous sommes associés à une autre communauté appelée celle-là, France. Pour moi il ne s’agit là d’aucune différence, ni de rupture. Mais quand je dis rupture, je voudrais encore aller plus loin : surtout il n’y a pas de différence dans l’action. Le lien profond est le même. »[25]
En fait l’inflexion de la pensée politique de Malraux a eu lieu en 1940. Il découvre que le fait national est plus fort que le mythe de l’internationalisme. Il s’aperçoit aussi que la France est en danger, ce qu’il n’avait jamais envisagé, comme beaucoup de Français d’ailleurs. Il s’est mobilisé pour l’Indochine ou l’Espagne alors que sa patrie à lui, la France, était aussi à défendre.
Le mythe national remplace le mythe international. Les Noyers de l’Altenburg rendent compte de cette brutale révélation : « le Touran qui animait les nouvelles passions turques, qui avait peut-être sauvé Constantinople, le Touran n’existait pas. »[26]
A ceux qui prétendent incarner la gauche contre le général il lance : « Pour nous la gauche c’est la présence dans l’Histoire de la générosité par laquelle la France a été la France pour le monde ». (Postface des Conquérants)[27]. On le voit, de même que Malraux ne fut pas un communiste orthodoxe, il n’a pas non plus été un gaulliste ordinaire.
Son gaullisme se réduisit en fait rapidement à un attachement à la personne du général. Il est entré dans le gaullisme comme on entre en religion. Il a d’ailleurs souvent comparé le général à Saint-Bernard et les gaullistes aux croisés marchant vers Jérusalem.
Bien que les deux personnages soient très différents, la rencontre Malraux-de Gaulle peut finalement se comprendre relativement aisément. Tous deux sont des hommes d’action, tous deux sont des intellectuels, des écrivains. Tous deux sont des hommes publics, mais empreints d’une grande pudeur. Cette phrase « Il n’y a pas de Charles dans ses mémoires, mais pas davantage dans un dialogue avec lui »[28] (La Corde et les Souris) pourrait tout aussi bien s’appliquer à son auteur.
En 1940 ils se trouvent dans la même situation. Les valeurs de Malraux (l’Espagne, l’antifascisme) se sont effondrées comme celles de de Gaulle (la France, l’armée). Venant de deux univers différents, ils vont se rencontrer dans un même combat.
L’admiration de Malraux pour le général était émouvante. Ecrivain renommé, personnage respecté, couvert d’honneurs, ayant vécu des combats difficiles, conscient de ses qualités, Malraux faisait preuve d’une grande humilité devant Charles de Gaulle. Lorsqu’il rencontra pour la première fois le général, Malraux sortait d’une période de désarroi politique, mais aussi de désarroi familial et personnel. Le suicide de son père en 1930 avait beaucoup affecté Malraux. La guerre fit un véritable ravage autour de lui. Ses deux demi-frères, Claude et Roland, moururent en luttant contre les nazis. Plusieurs de ses vrais amis disparurent eux aussi (Du Perron, Maréchal, Drieu la Rochelle.) Surtout Josette Clotis, sa compagne, mourut frappée par un train en novembre 1944, alors qu’André était au front dans les Vosges.
D’une certaine manière, le général de Gaulle compensa peut-être un vide affectif chez André Malraux. Son attachement inconditionnel créa entre eux des liens quasi familiaux. Malraux fut d’une loyauté exemplaire à l’égard de de Gaulle et d’une solidarité admirable.
Plus d’une fois il se sentit cependant mal à l’aise, notamment durant les années 1958-60 face à la guerre d’Algérie.
Il n’exprima que deux fois son désaccord avec des initiatives du général, mais uniquement en privé, lorsque de Gaulle décréta un embargo sur les ventes d’armes à Israël en juin 1967 (André Malraux était un grand ami du peuple juif et d’Israël) et surtout lorsque le général se rendit en Espagne rencontrer Franco après avoir quitté le pouvoir. Cette rencontre chagrina fortement André Malraux puisqu’il affirma que, s’il avait été ministre à ce moment-là, il aurait démissionné. C’est peut-être pour cette raison que le général ne se rendit pas en Espagne lorsqu’il était au pouvoir.
Malraux aurait choisi la fidélité à l’Espagne plutôt que celle au général. Ce fut le seul moment où il ne se sentit pas heureux d’être gaulliste.
Mais Malraux était fier de pouvoir compter parmi ceux que le général respectait. La pratique de l’écriture les rapprochait. « Des heures par jour écrivant, raturant, il travaille à espérer. Il a mis dans son titre le mot « espoir » »[29].
Une évolution qui s’explique
Des deux engagements de Malraux on peut donc retenir des points communs :
- ce furent des engagements très forts qui le mobilisèrent complètement, mais cette mobilisation ne fut totale et sans nuances que sur de courtes périodes (1935-39 pour le communisme ; 1947-49 pour le gaullisme),
- il fut attiré par l’énergie et les mythes du communisme puis du gaullisme et non par une adhésion idéologique, ou intellectuelle, à l’un ou l’autre de ces courants politiques,
- il resta un intellectuel original en marge de l’appareil (communiste ou gaulliste).
Comme cela a été rappelé ci-dessus, le passage d’un engagement à l’autre ne fut pas brutal mais progressif s’étalant sur six ans (de 1939 à 1945) avec au milieu une période de repli sur soi où la politique disparut de sa vie (1940-43).
Cette évolution peut en fait apparaître assez logique : le mythe de la Révolution l’avait amené à l’antifascisme qui l’entraîna dans la Résistance (même s’il n’a pris contact que tardivement avec les mouvements de Résistance) et la Libération de la France puis le conduisit au gaullisme.
Le gaullisme originel, celui de la Résistance et de la Libération, regroupait des personnes de tous horizons, mais le gaullisme partisan fut un mouvement majoritairement ancré à droite. Pour autant, le gaullisme partisan compta aussi des hommes venus de la gauche (mais très rarement du communisme) ou qui se sentaient proches d’elle, et qu’on appelait gaullistes de gauche, comme René Capitant, Louis Vallon et Léo Hamon, qui fondèrent l’UDT en 1959 pour soutenir la politique algérienne du général et se démarquer de l’UNR, jugée trop à droite. Il y avait aussi des gaullistes que l’on peut qualifier de sociaux plutôt que de droite, comme Yvon Morandat, Jacques Chaban-Delmas (qui avait été ministre de Pierre Mendès-France et de Guy Mollet) ou Edmond Michelet. André Malraux était leur référence intellectuelle à tous.
L’originalité du parcours de Malraux réside dans le fait qu’il sut trouver un nouvel engagement politique après avoir rompu avec le parti communiste. Rares sont ceux qui sont sortis indemnes d’une rupture avec un engagement communiste. Ceux qui ont rompu, volontairement ou de force, ont en effet eu beaucoup de difficulté à s’en remettre. Ils ont souvent été atteints d’un sentiment de culpabilité ou se sont sentis orphelins, se retirant de l’engagement politique. Ce fut notamment le cas d’Albert Camus après la publication de son Homme révolté en 1951.
Malraux a su se ressourcer, puiser dans son énergie, dans sa force vitale, dans son goût de l’action, dans son orgueil, pour renouer avec l’action politique à travers une autre inspiration. Mais il resta marqué. A l’époque du RPF il s’abandonna dans l’anticommunisme, comme s’il avait besoin de se faire pardonner d’avoir été communiste. Les nouveaux convertis sont souvent les plus zélés. Mais, dans les années soixante, comme rappelé ci-dessus, il porta un regard beaucoup plus serein sur les communistes français, soviétiques ou chinois.
Si le passage du communisme au gaullisme fut donc progressif et peut trouver une certaine logique, s’est-il pour autant agi d’une rupture, ou peut-on parler de fidélité de Malraux, non seulement une fidélité au sens de son engagement, mais aussi à ses références politiques, sa thématique ?
On peut constater, à la lecture de ses écrits ou de ses discours ou interviews, qu’André Malraux est toujours resté fidèle à trois grands thèmes : le culte du héros, la fraternité et la nation.
Le culte du héros et des grands hommes
André Malraux a toujours été fasciné par les hommes d’exception. L’individu a joué un rôle très important dans la conception qu’il avait de la politique, de l’histoire ou du roman.
Les romans de la période révolutionnaire mettent en œuvre une dialectique permanente entre l’action collective et l’action individuelle. Certes seul le nombre donne des chances d’aboutir face à l’oppression, c’est la communion avec les autres, la fraternité qui permet à chacun de s’accomplir, mais, en définitive, c’est la qualité des dirigeants, des chefs qui est déterminante pour le succès final.
L’histoire avance grâce aux individus d’exception. Les héros peuplent l’univers de Malraux. La personnalité de Garine domine les Conquérants. La condition humaine a pour personnage principal Kyo ; deux autres caractères s’imposent aussi dans le roman, Gisors et Ferral.
Malraux est de ce point de vue beaucoup plus nietzschéen que marxiste.
L’Espoir accorde cependant une place plus importante au peuple, le peuple espagnol dont on a pu dire qu’il était le véritable héros du roman. Mais Manuel ou Magnin, dont le colonel Malraux a été le modèle, sont des personnages qui sortent du commun et imposent leur volonté aux autres combattants républicains. Magnin commande l’escadrille des Républicains et a conscience de la mission qui lui est impartie « … chaque nouvel effort enfonçait jusque dans sa poitrine l’idée fraternelle qu’il se faisait du chef »[30].
Les chefs ont donc un rôle fondamental à jouer. Ils doivent pour cela présenter des qualités exemplaires. C’est au sujet de Garine que Malraux a donné sa définition du héros : « Un type de héros en qui s’unissent l’aptitude à l’action, la culture et la lucidité » (Postface des Conquérants).[31] Cette définition André Malraux aurait pu l’appliquer à Lawrence d’Arabie, au général de Gaulle et aurait aimé qu’elle puisse aussi s’appliquer à lui-même.
Malraux a toujours éprouvé beaucoup d’admiration pour les individus qui ont marqué l’histoire, comme Alexandre le Grand, par exemple, à qui il voua un culte quasi religieux tout au long de sa vie. Il était fasciné par ce personnage qui le poursuivait (cf. les pages décrivant le rêve d’un médium devant une étoffe qui aurait été tachée par le sang d’Alexandre, dans La Corde et les Souris.)
Le premier modèle de Malraux fut indiscutablement Saint-Just, le tribun de la Révolution française, celui de la patrie en danger, celui des soldats de l’An II, celui du salut public.
Le deuxième fuit Léon Trotski. Le créateur de l’armée rouge incarnait pour lui le communiste conquérant, par opposition au communiste fonctionnaire représenté par Staline. Trotski était aussi un intellectuel qui aimait la littérature française ; il avait tout pour séduire le jeune Malraux, d’autant plus qu’en 1931 il publiait une critique littéraire et politique des Conquérants dans laquelle il engageait un débat politique avec son auteur, ne doutant pas un instant de la véracité des faits et des personnages décrits dans le roman. C’est lui qui donna à André Malraux ses titres de révolutionnaire. On ne pouvait mieux séduire le jeune romancier.
Trotski trouva dans les romans chinois de Malraux des témoignages des erreurs de Staline dans la gestion de la Révolution en Chine. Malraux dialogua avec lui par écrit
Leur première rencontre eut lieu en 1933, au moment où Malraux venait de rejoindre les rangs des compagnons de route du PCF qui considérait Trotski comme un renégat. Il protesta contre l’expulsion de France du vieux révolutionnaire par le gouvernement Doumergue et se prononça plusieurs fois en faveur de l’unité du mouvement révolutionnaire et de la réconciliation entre communistes et trotskistes.
A partir de 1935, Malraux s’éloigna cependant du trotskisme pour s’aligner de plus en plus sur les positions de l’Union soviétique et du parti communiste. En Espagne il combattit aux côtés du PCE, qui va bientôt traquer les dirigeants du POUM qui étaient proches des thèses de Trotski, tout en étant cependant conscient des dangers des moyens utilisés par le PCE.
Devenu stalinien par nécessité, Malraux se brouilla avec Trotski et le mouvement trotskiste à l’occasion de la guerre d’Espagne. Pourtant L’Espoir peut être lu comme un témoignage de sympathie pour les militants anarcho-trotskistes ; le comportement des communistes face à eux ébranla d’ailleurs les convictions communistes de Malraux. Après la seconde guerre mondiale, Malraux, qui était devenu antistalinien, continua (ou plutôt commença) à revendiquer l’héritage de Trotski.
Mais c’est un autre conquérant qui a le plus fasciné Malraux. Il s’agit de Laurence d’Arabie. T.E. Lawrence a été, comme André Malraux, un homme d’action et un romancier. Il a défendu la cause des Arabes dont il a pris la tête contre les Anglais. Malraux agira de même en Indochine ou en Espagne. En 1923, humilié et désespéré, Lawrence s’engagea dans la RAF comme simple soldat, comme le fera André Malraux en 1940 dans l’armée française comme seconde classe.
Indiscutablement Lawrence a été le véritable modèle du héros de Malraux entre 1925 et 1945. Le type même du héros qu’il voulait devenir, à la fois écrivain et chef d’un mouvement de libération national. Il a été attiré par « la légende Lawrence… légende éclatante d’une armée de reine de Saba, avec ses partisans arabes déployés sous les oriflammes au-dessus de toutes les gerboises du désert, et les combats imaginaires dans les rouges défilés de Pétra pleins de roses » (Antimémoires)[32].
Malraux a cherché à écrire pendant la guerre une biographie de Lawrence d’Arabie intitulée Le Démon de l’absolu qu’il n’arriva jamais à achever. Il en publia un extrait en 1946 appelé « N’était-ce donc que cela ? ». Malraux ne termina donc pas complètement la principale biographie qu’il écrivit (il a aussi écrit un livre sur Napoléon). Mais sa parution en 1996 a montré qu’il s’agit quand même d’une œuvre très avancée. C’est une biographie assez romancée et dans laquelle l’auteur semble s’identifier à son héros.
Il l’avait commencée à une époque où il écrivait Les Noyers de l’Altenburg. Dans ce roman Vincent Berger, le père du narrateur, remplit auprès des Turcs le rôle que tenait Lawrence auprès des Arabes. Il devient l’éminence grise d’Enver Pacha et fait sien un mythe turc, le Touran. Il s’agit de redonner vie à un monde turc qui va jusqu’en Afghanistan et au Turkestan. Vincent Berger va cependant découvrir que le Touran n’existe pas et va retourner dans son Alsace natale s’engager dans la première guerre mondiale.
Ce roman, lui-aussi inachevé, a été vu comme une réécriture de la vie de Malraux qui avait placé sa foi dans la Révolution (le Touran) et avait découvert que la Révolution n’existait pas et s’était alors engagé dans l’armée à la seconde guerre mondiale. La référence à l’Alsace est prémonitoire puisque Malraux libèrera, un peu moins de deux ans plus tard, l’Alsace en prenant le nom de son héros, Berger.
Mais Vincent Berger ressemble aussi très fortement à Lawrence d’Arabie, le mythe du Touran correspondant au mythe d’un monde arabe uni.
Signalons aussi que dans Le règne du malin le héros, Mayrena, vise lui-aussi à créer un nouveau royaume en unissant des populations vivant en Indochine. Probablement écrit en 1939, ce roman, lui-aussi inachevé, ne sera publié par Gallimard dans la Pléiade qu’en 1996, en même temps que Le Démon de l’absolu. Il s’agit probablement de la suite de La Voie royale, annoncée à la fin de ce roman.
Malraux a indiqué avoir rencontré Lawrence d’Arabie en 1934-35, mais sans que cette rencontre n’ait pu être identifiée avec certitude.
Comme Vincent Berger, qui renonce à devenir un héros national, André Malraux finira par comprendre qu’il ne sera jamais un nouveau Lawrence. Il ne sera pas un héros, ni un héros aventurier, comme Perken de La Voie royale ou Mayrena du Règne du malin, ni un héros révolutionnaire comme Garine des Conquérants ou Trotski, ni un héros national comme Vincent Berger des Noyers de l’Altenburg ouLawrence d’Arabie. Il va donc réaliser son rêve à travers un autre héros, sur lequel il va se projeter et devenir son compagnon et son chantre.
Cet autre héros c’est bien sûr le général de Gaulle. Enfin Malraux allait pouvoir se mettre au service d’un homme qui a le pouvoir d’infléchir le cours de l’histoire. Trois choses rapprochaient Malraux du général : la France (de Gaulle l’a toujours aimée, Malraux l’a découverte en 1940 et en 1944 dans la brigade Alsace-Lorraine), la décolonisation (Malraux a toujours été anticolonialiste, de Gaulle réalisa la décolonisation en 1960-62) et l’écriture.
De Gaulle ne joua cependant pas le même rôle que Lawrence et Trotski. Ces derniers ont été des modèles. Comme eux Malraux a voulu être un conquérant, un héros politique, il a voulu prendre la tête de mouvements libérateurs ou révolutionnaires. Il a essayé à quatre reprises de s’imposer comme un chef (lutte contre la colonisation en Indochine, rassemblement des intellectuels contre le fascisme, mise sur pied d’une escadrille pour défendre la République espagnole, organisation de la brigade Alsace-Lorraine).
Ces actions ont apporté à Malraux des satisfactions et des déceptions. Il n’est pas arrivé à s’imposer comme une des personnalités marquantes de la politique française. Il est resté avant tout un intellectuel, même si son engagement exceptionnel sur le terrain de la guerre en Espagne et avec la brigade Alsace-Lorraine le distinguait nettement de ses pairs.
Il abandonna alors sa tentation de devenir lui-même un héros pour se mettre au service d’un personnage historique, à qui il vouera une fidélité exemplaire. C’est par le général de Gaulle interposé qu’André Malraux réalisa son vieux rêve – devenir un héros de la politique et de l’Histoire.
La fraternité
Un personnage de L’Espoir déclare « et voilà ce que je voulais te dire, Manuel : le contraire de l’humiliation, c’est pas l’égalité. Ils ont compris quand même quelque chose, les Français, avec leur connerie d’inscription sur les mairies ; parce que le contraire d’être vexé, c’est la fraternité. »[33]
Pour Malraux la valeur d’un engagement politique c’est la dose de fraternité que l’on y trouve. Ce qui attira Malraux dans la Révolution ce ne fut certes pas l’adhésion à une idéologie, ni même principalement la revendication de l’égalité, mais l’élan fraternel qui rassemblait les révolutionnaires.
Les romans de sa jeunesse tournent tous en effet autour du thème de la fraternité révolutionnaire. La Révolution et le communisme permettent à l’homme de dépasser son isolement et de surmonter sa difficulté à communiquer avec les autres. « On ne connaît jamais un être mais on cesse parfois de sentir qu’on l’ignore » (La Condition humaine)[34].
L’Espoir constitue ainsi un hymne à la fraternité révolutionnaire, à la fraternité humaine. La descente des civières, portant les aviateurs blessés, vers Linares fait l’objet de très belles pages où la notion de fraternité prend tout son sens. Le peuple des paysans espagnols communie avec ses aviateurs, volontaires ou mercenaires, qui se sont battus pour eux et sont blessés ou morts… « Ce blessé-là était l’image même que, depuis des siècles, les paysans se faisaient de la guerre. Et nul ne l’avait contraint à combattre. Un moment, ils hésitèrent ne sachant que faire, résolus pourtant à faire quelque chose ; enfin, comme ceux de Voldelinares, ils levèrent le poing en silence »[35].
L’aventure gaulliste fut aussi pour l’auteur de L’Espoir l’occasion de renouer avec une communauté fraternelle. Ce n’est plus la Révolution, c’est la personne du général de Gaulle qui catalyse les volontés, mais le résultat est de même nature ; le mouvement gaulliste est vécu comme une nouvelle fraternité. Au RPF pour Malraux la fraternité ressemblait à une chevalerie. Autour du général de Gaulle se rassemblaient les compagnons ou les barons : Malraux, Soustelle, Debré, Chaban-Delmas, Foccart, Vallon, Lefranc, Pompidou, Guichard. Le général de Gaulle a, pour Malraux, le visage d’un chevalier médiéval et les frères gaullistes lui sont entièrement dévoués.
Sous la Vème République, le lyrisme de Malraux sera moins explicite, mais on y retrouvera cette volonté de communion fraternelle. La France est d’ailleurs perçue comme la nation de la fraternité entre les hommes. Aux dirigeants de la IVèmeRépublique il avait lancé : « La France n’a jamais été plus grande que lorsqu’elle parlait pour tous les hommes, et c’est pourquoi son silence s’entend de façon aussi poignante » (postface des Conquérants)[36].
Pour Malraux, l’engagement politique et la recherche de la fraternité sont donc liés. S’engager politiquement c’est adhérer à un ordre fraternel, communiste puis gaulliste. Malraux est entré en politique comme d’autres sont entrés dans les ordres.
Mais il est toutefois clair que c’est surtout au combat que Malraux a rencontré la fraternité. « La fraternité du combat est rigoureusement communion » (La Corde et les Souris)[37]. C’est au sein de l’escadrille España ou de la brigade Alsace-Lorraine qu’il a vécu les moments les plus exaltants et les plus marquants de sa vie, et qu’il a le plus dépassé sa simple condition d’homme.
La fraternité des combattants les unit par-delà même leurs oppositions. C’est ce que Malraux décrit en racontant la première attaque allemande par les gaz à Bolgako sur la Vistule en 1916 (le texte figure initialement dans Les Noyers de l’Altenburg puis est intégré dans La Corde et les Souris). Russes et Allemands fraternisent face aux gaz asphyxiants.
Deux exemples historiques de fraternité font aussi partie du panthéon mythologique de Malraux. Tout d’abord les soldats de l’an II qui, jeunes conscrits, partirent se battre pour la Révolution et la France, les deux valeurs pour lesquelles Malraux se battra lui aussi. Ensuite les premiers croisés qui, sous l’impulsion de Saint Bernard, sacrifièrent tout pour partir à la reconquête du tombeau du Christ. On sait que Malraux a souvent comparé le général de Gaulle au prêcheur de la première croisade.
Malraux s’est battu pour des engagements qui avaient une signification par eux-mêmes. Le raisonnement idéologique ou philosophique n’était pas absent, mais n’était pas primordial. L’engagement politique est vécu comme une aventure, une aventure romanesque voire romantique. Pour lui, faire de la politique ne consistait pas à s’engager dans des campagnes électorales (en 1967 il sera le seul membre du gouvernement à ne pas se présenter aux élections législatives) ni à siéger dans un Parlement. Il n’a jamais sollicité de mandat électif. Le parlementarisme ne l’attirait pas.
C’est pourquoi son attachement à la liberté n’a jamais fait de lui un adepte du libéralisme. Il s’est certes battu pour la liberté en Espagne et avec la brigade Alsace-Lorraine, mais pour autant il ne peut pas être qualifié de libéral. Les libéraux, outre qu’ils sont bien ennuyeux pour un romantique comme Malraux, sont des individualistes ; or ce qui intéresse Malraux, c’est « la part de l’homme qui cherche aujourd’hui son nom, qui n’est certes pas l’individu » (La Corde et les Souris)[38].
Sa liberté, l’homme la trouve à travers les autres. C’est la communion avec les autres, la fraternité, qui lui permet de vaincre le mal et de dépasser la mort : « Il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul » (La Condition humaine)[39]; « La communion est quelquefois aussi forte que la mort » (La Corde et les Souris)[40].
La vie et l’œuvre de Malraux, ses engagements politiques, ses ouvrages littéraires, ses recherches sur l’art tournent autour de l’absurdité de la mort, de la signification de la condition humaine, de la possibilité d’échapper au destin. C’est dans la fraternité que l’issue peut être trouvée.
Dans La Corde et les Souris il a résumé ainsi toute sa quête métaphysique : « Je cherche la région cruciale de l’âme où le Mal absolu s’oppose à la fraternité »[41].
La nation
André Malraux a souvent dit qu’il a rencontré l’idée de nation, lorsqu’il a rencontré la France, c’est-à-dire en 1940 lorsqu’il s’est engagé dans l’armée française et en 1944 quand il a rencontré la Résistance.
« Pour le meilleur, comme pour le pire, nous sommes liés à la patrie »[42] écrit-il en 1948 dans l’Appel aux intellectuels qui deviendra la Postface des Conquérants.
En effet la conversion d’André Malraux au gaullisme fut d’abord une conversion à la France et au patriotisme. La France est vue comme la nation par excellence, la patrie des droits de l’homme.
Il écrit dans La Corde et les Souris : « La Nation avec une majuscule, celle à laquelle la France convertit autrefois l’Europe est née de la patrie en danger »[43]
Pour lui, la Nation c’est la patrie en danger, c’est la France qu’il faut défendre contre les périls extérieurs (le fascisme, puis le stalinisme). C’est surtout la France phare de la liberté, terre des droits de l’homme, guide des peuples.
C’est la France glorifiée par Jules Michelet, Victor Hugo, Charles Péguy ou Charles de Gaulle. C’est la France qui, via le général de Gaulle, se dresse en juin 1940 contre le fascisme, ou qui dans les années 1965-1968 défend les pays du Tiers Monde (discours du général au Mexique et au Cambodge…) face au monde bipolaire organisé par les Etats-Unis et la Russie.
Le patriotisme, cet amour de la France, révèle chez André Malraux son attachement au droit des peuples à disposer d’eux- mêmes. Cet attachement à la France, pays de la liberté, est cohérent avec son soutien au mouvement indépendantiste annamite de 1925 ou aux Algériens en 1958.
En effet la référence au concept de nation chez Malraux ne date pas de 1940. Le concept de nation a toujours joué un rôle important pour lui. La Chine, le Japon, l’Inde, l’Espagne sont des réalités, comme l’est la France.
La nation fait partie de la culture des hommes, de l’Histoire qui est avant tout pour Malraux une confrontation entre les civilisations, comme elle l’était pour Spengler. De 1947 à 1953, année où le RPF disparait, André Malraux a accordé un rôle plus important à la France, mais après cette époque, comme avant, la nation a toujours été un élément important.
Déjà dans Les Conquérants la nation est présente. Il s’agit de l’avenir de la Révolution en Chine et donc de l’avenir de la Chine et du rôle que peut jouer la Russie pour elle. Garine symbolise l’assistance de la nation russe à la nation chinoise : « Il me semble que si une nation a servi de sujet d’expérience au monde entier, ce n’est pas la Chine mais la Russie »[44].
D’une certaine manière Les Conquérants mettent en scène la naissance d’une opposition nationale entre la Russie, mère de la Révolution, et la Chine qui prend conscience d’elle-même. Et Garine, le révolutionnaire russe qui vient éveiller les Chinois, ressemble à Lawrence d’Arabie qui veut éveiller la conscience nationale arabe.
En conclusion, après la guerre, la totalité des intellectuels de gauche considère que la conversion d’André Malraux au gaullisme a constitué une rupture fondamentale dans son engagement. Le passage du communisme au gaullisme n’est au mieux pas compris, au pire dénoncé comme une trahison, au point que certains d’entre eux, comme cela a été dit plus haut, ont considéré que Malraux serait même devenu un fasciste. Nous avons vu que cela s’explique en très grande partie par le climat politique très tendu de l’après-guerre, marqué par la guerre froide.
Ensuite les choses se sont progressivement apaisées. En tant que ministre des Affaires culturelles, Malraux a eu l’occasion de renouer avec de nombreux intellectuels de gauche et avec des membres du parti communiste. La fin de la guerre froide, qui a laissé la place à la détente, ainsi que la politique d’indépendance du général de Gaulle ont profondément changé l’environnement politique.
En 1970 Janine Mossuz-Lavau publie sa thèse de doctorat André Malraux et le gaullisme dans laquelle elle montre que l’adhésion de Malraux au gaullisme ne traduit pas un renoncement à ses engagements de jeunesse.
Une étude attentive de l’œuvre littéraire et de son action politique permet de conclure à la fidélité de Malraux plutôt qu’à la rupture dans son action politique depuis l’Indochine en 1924-25 jusqu’à son départ du gouvernement en 1969. De même, Jean Lacouture dans André Malraux, une vie dans le siècle paru en 1973, conclut lui-aussi à la fidélité.
Aujourd’hui, avec le recul dont nous disposons il est évident pour à peu près tout le monde que la fidélité l’emporte sur la rupture. Nous avons vu que le sens des deux engagements de Malraux fut le même : la recherche de la fraternité et le culte du héros. Il est clair que son engagement politique était bien différent de celui des femmes et des hommes politiques traditionnels : pour lui la politique s’inscrivait dans une démarche plus large, celle de vivre l’Histoire de son temps, d’être là où l’Histoire se faisait, et, au-delà, de lutter contre la mort, ce qui l’a obsédé toute sa vie.
Mais ci-dessus nous avons essayé d’aller plus loin, en montrant que, même si on reste sur le plan strictement politique, la fidélité s’impose aussi.
Malraux n’était certes pas un idéologue, mais il a en effet invoqué durant toute sa vie une même thématique politique, comme la fraternité et le culte du héros, mais aussi la Nation. C’est la rencontre d’un homme exceptionnel avec la nation dans la recherche de la fraternité qui l’a toujours mobilisé : Garine avec la nation chinoise, Lawrence d’Arabie avec la nation arabe, Nehru avec la nation indienne, de Gaulle avec la nation française.
Ne peut-on pas alors essayer de le rattacher à une famille politique, à qui il aurait été fidèle durant toute sa vie ?
Le jacobinisme
Si on veut rattacher André Malraux à un courant politique, c’est sans doute au jacobinisme qu’on peut le faire. Les thèmes politiques d’André Malraux identifiés ci-dessus, l’héroïsme, la fraternité, la nation peuvent permettre en effet de considérer qu’il est un jacobin, au sens que ce mot avait à l’époque de la Révolution française.
La référence à la Révolution, la notion de patrie en danger, le mythe des soldats de l’An II et le culte de Saint-Just ont en effet toujours fait partie de ses références.
La Révolution française de Malraux est celle de 1792, beaucoup plus que celle de 1789. Le mythe de la Révolution en danger, qui lutte contre les monarchies étrangères et apporte la Lumière au monde, est très présent dans son œuvre et dans ses discours.
Pour Malraux, comme pour nombre des représentants de la gauche française de sa génération, notamment les militants communistes, la Révolution française marque une avancée historique fondamentale qui annonce les révolutions suivantes, la russe bien sûr puis la chinoise. Certes la Révolution a connu des excès, comme la Terreur, et elle a été ensuite affadie puis transformée par Napoléon, mais, pour Malraux et pour la gauche française, ses acquis restent incontournables et incontestables.
La Révolution française fait partie des mythes de la gauche française, du moins de la gauche du début du XXème siècle, celle de Jaurès qui a cherché à faire la synthèse entre la Révolution française et le socialisme. C’est cette gauche qui a marqué le jeune Malraux, celui qui s’intéresse à l’action politique à partir de 1925. C’est une gauche lyrique et romantique, celle de Saint-Just, de Jules Michelet, de Victor Hugo et de Jean Jaurès.
Dans son ouvrage sur Les gauches françaises[45] Jacques Julliard identifie quatre gauches, dont la gauche jacobine, une gauche qui vient justement de la Révolution de 1792, qui est attachée à l’Etat, à la souveraineté nationale et à la laïcité. Elle a été représentée ces dernières années par notamment Jean-Pierre Chevènement.
Pour Malraux la Révolution c’est Saint-Just, à qui il a toujours voué une grande admiration. Saint-Just est l’archétype du héros révolutionnaire, avant Trotski, et plus que Lénine ou Mao.
En 1954 André Malraux préfaça d’ailleurs l’ouvrage d’Albert Olivier Saint-Just et la force des choses. Dans Les Conquérants, il nous précisait déjà que l’imagination de Garine était « tout occupée de Saint-Just »[46].
Dans La Corde et les Souris il fait à nouveau l’éloge de Saint-Just : « Saint-Just ne se souciait pas d’appliquer les Institutions ; sa véritable doctrine était le Salut Public »[47], et pour lui Charles de Gaulle procède de la même démarche : « Au 18 juin, le général de Gaulle a posé des principes de Salut Public »[48].
La liberté, l’héroïsme, la nation et la fraternité, ces thèmes de Malraux sont aussi ceux des jacobins de la grande Révolution. Ce sont ceux de la gauche française classique et ceux du général de Gaulle, du moins du général de Gaulle que nous présente André Malraux dans son œuvre.
[1] Interrogations à Malraux, Esprit octobre 1948
[2] André Malraux, Une vie dans le siècle page 339, Seuil 1973
[3] Cité dans par Jean Lacouture André Malraux, une vie dans le siècle, page 372
[4] Album Malraux, une vie dans le Siècle, La Pléiade, page 142
[5] Malraux, par Gaëtan Picon, écrivain de toujours, Seuil, 1979, page 94
[6] Malraux, par Gaëtan Picon, écrivain de toujours, Seuil, 1979, page 90
[7] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 900
[8] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 740
[9] André Malraux, une vie dans le siècle, page 165
[10] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 987
[11] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 740
[12] André Malraux, une vie dans le siècle, page 171
[13] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 737
[14] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 168
[15] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 737
[16] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 90
[17] Le Rassemblement 19 février 1949, n°96
[18] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 446
[19] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 168
[20] Malraux, être et dire, Néocritique, Plon 1976, page 95.
[21] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 446
[22] Carrefour, 31 mars 1948 n°185
[23] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 715
[24] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 718
[25] André Malraux, entretiens et précision, par Roger Stéphane, NRF, Gallimard, 1984, page 108
[26] Œuvres complète II, bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1996, page 650
[27] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 987
[28] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 620
[29] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 703
[30] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 962
[31] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 157
[32] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976
[33] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 742
[34] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 481
[35] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 971
[36] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 172
[37] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 837
[38] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 540
[39] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 540
[40] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 540
[41] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 838
[42] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 158
[43] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 728
[44] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 73
[45] Les gauches françaises, Flammarion, 2012
[46] Romans, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 37
[47] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 704
[48] Le Miroir des Limbes, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1976, page 704