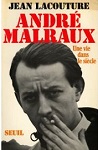Monsieur le Président, chers membres du jury,
Merci de la belle et bienveillante lecture que vous avez faite de mon livre sur Malraux et l’Afghanistan à l’image de la stimulante présentation de Christian Destremau.
Elle me touche infiniment comme elle ravit Paul Erik Mondron, fondateur des Éditions belges Nevicata, qui m’a fait confiance dans cette aventure. L’Afghanistan a inspiré nombre d’écrivains francophones et votre choix rejoint cette intimité, longue et énigmatique, dont témoigne la commémoration, cette année, du centenaire des relations franco-afghanes.
Vous avez vu dans mon livre une invitation au voyage,
- pas n’importe où, en Afghanistan, au « centre du monde habité » comme l’ont localisé l’empereur moghol Babour et l’écrivain voyageur Nicolas Bouvier,
- pas avec n’importe qui, avec André Malraux, le jeune homme, l’écrivain, le ministre qui restera toute sa vie comme aimanté par cet Orient de beauté et de violences, une haute Asie qui monte si haut qu’elle rejoint l’imaginaire dit le poète André Velter..
Ou plutôt cet « imaginaire de vérité » de Malraux dont l’Afghanistan est l’une des terres naturelles. Tous ses grands hommes -Alexandre, Tamerlan, Lawrence- ont respiré l’air enivrant des Pâmirs. Le romancier ira jusqu’à y situer une sorte de saga familiale : « À Kaboul rêvait mon père ». La phrase figure dans Les noyers de l’Altenburg et sera reprise dans les Antimémoires. Je l’ai choisie comme titre pour mon livre.
En janvier, j’avais prévu pour ces mots de remerciement de vous faire faire un beau voyage.
Nous serions partis tout naturellement d’ici, du 33 rue du Faubourg saint Honoré.
Le 1er décembre 1930, – un lundi déjà – Malraux de retour d’Afghanistan depuis quelques semaines, se voit en effet décerner, en ces lieux, un prix littéraire par un jury de journalistes pour son roman la Voie royale. Paris Soir décrit le romancier : grand, pâle, mince, la chevelure rebelle, il conte des anecdotes sur ses voyages, ses fouilles, ses découvertes. C’est donc de ces salons où nous sommes réunis que la carrière littéraire d’André Malraux a connu son premier élan.
Puis nous aurions fait un crochet par un lieu chargé d’imaginaire où l’enfant Malraux a rencontré l’Orient, le Musée Guimet. Le grand escalier jusqu’au premier étage, à gauche la bibliothèque en rotonde où Clémenceau a participé à des cérémonies bouddhiques et où Mata Hari s’est dévêtue sur des danses dites brahmaniques ; à droite, les salles afghanes dédiées à l’art gréco-bouddhique du Gandhara, « la beauté suprême par la sagesse suprême » pour Malraux. Au fond la splendide statue ramenée par André et Clara de leur voyage de 1930. Elle ne quittera pas le romancier jusqu’à son dernier souffle. Sa fille Florence a souhaité qu’elle rejoigne les collections permanentes du musée. Avec elle, c’est le regard complice et presqu’amoureux de Malraux qui accompagne l’œuvre, en ces lieux, désormais pour toujours. Mais Guimet, c’est aussi le fantôme du grand archéologue Joseph Hackin et de son épouse Ria, tous deux parmi les premiers Compagnons de la Libération à titre posthume. Entre André et Joseph, une histoire d’hommes dans le siècle avec ses grandeurs et ses défaillances.
Le musée accueillera cet automne une grande exposition sur cent ans d’archéologie française en Afghanistan sous le titre malrucien d’Ombres et Légendes.
Puis d’un saut d’avion nous aurions filé à Peshawar, escale mythique au pied de la passe de Khyber. C’est là que, comme tant d’autres, lecteurs de Kipling, humanitaires, journalistes – et même membres de ce jury littéraire- je suis tombé dans le chaudron. Mais si la potion est magique, exaltante et gratifiante, elle peut aussi avoir le goût amer d’un Orient perdu.
Enfin à bord de ces camions aux couleurs vives, nous aurions rallié Kaboul, dernière étape de ce voyage initiatique. Mais Malraux trouve la ville « moche ». Il est en fait désemparé. Même sur le toit du monde, le souffle de l’imaginaire et l’étroitesse du quotidien ne font pas toujours bon ménage.
J’avais prévu de vous faire faire un beau voyage.
Mais à la fin du mois de février, je suis parti à Istanbul, invité par notre ambassadeur en Turquie, pour présenter mes deux livres : À Kaboul rêvait mon père et Diplomate dans l’Orient en crise. La guerre venait de commencer en Ukraine. À Istanbul, sur les bords du Bosphore et de la Mer noire, on la sent proche, tout comme l’on ressent plus fortement les malheurs de l’Orient, des kurdes aux ouighours.
Dans l’avion, en route pour la Turquie, j’ai relu Les noyers de l’Altenburg. Avec une émotion renouvelée.
J’oserais dire : tout y est : page 135 du Folio : « Il y avait quarante ans que l’Europe n’avait pas connu la guerre ». Des noms de lieux à consonance ukrainienne, les Russes et le front de l’Est.
Dans les sapes où se terrent les combattants, ces propos échangés, inquiets, désabusés, révoltés : « Y a pas de grandes personnes, y a jamais de grandes personnes ». Et puis l’évocation des gaz, des atrocités, des viols.
Au passage, on rappellera que si le grand roman de Malraux La condition humaine se passe en Chine, un long paragraphe a trait à l’Afghanistan et concerne les violences faites aux femmes : « On ne se venge vite que sur les corps ».
L’Ukraine tout comme l’Afghanistan sont des routes de migration des oiseaux. « Très haut, la grande migration des oiseaux continuait » nous dit Malraux. « Et sous elle, l’espèce humaine plaquée sur ces prés livides dans l’attente du pilonnement russe avait l’unité complexe de ces nuits d’été, cette unité de cris lointains, de rêves, de présences, d’odeur profonde d’arbres et de blés coupés, de sommeils inquiets à la surface de la terre sous l’immense nuit immobile ».
Ce détour par l’Ukraine m’a aidé à mieux aborder les phrases très lourdes de Malraux sur l’Afghanistan. Et je cite : un pays qui n’existe pas, un pays fantomatique et absurde, une poussière nomade et sédentaire, dans une Asie centrale, menteuse et idiote.
Alors que, le 15 août dernier, la nuit tâleb est tombée sur Kaboul et que des contraintes révoltantes sont imposées au quotidien des femmes et des jeunes filles, ces formules improbables, ces outrances portent une douloureuse résonnance.
Je crois qu’il faut les entendre comme un appel, un cri.
Dans son essentielle anthologie des poétesses afghanes, intitulée Le cri des femmes afghanes, qu’elle vient de publier, Leili Anvar rappelle qu’en persan « afghân » signifie à la fois « relatif à l’Afghanistan » et « cri ».
Comme nombre d’entre nous, comme nos diplomaties, Malraux a buté en Afghanistan sur de multiples antinomies : beauté et cruauté, sagesse et violence, honneur et prévarication, richesse de l’imaginaire et rudesse du réel.
Mais Malraux veut croire en une permanence, en une force profonde – de la vie de la terre à l’engagement des hommes. Les noyers qui en Alsace s’élancent vers le ciel comme ces poèmes des femmes d’Afghanistan dans leur irréductible liberté, lucidité, sensualité.
Paradoxalement, Malraux sera un « passeur d’Afghanistan ». Jean d’Ormesson lui attribue sa découverte de cette région du monde. Les grands photographes Roland et Sabrina Michaud font, pour leur part, de la phrase des Noyers de l’Altenburg décrivant, descendant des Pâmirs, « les chameaux perdus qui appellent à travers les nuages » la boussole de toute leur œuvre.
Un très grand merci pour avoir distingué mon livre et, à travers lui, une invitation au voyage et un appel à la solidarité.
Il témoigne de mon admiration pour Malraux, l’homme et son parcours. Malraux l’aventurier de l’ Orient du Prêtre Jean dont, moi aussi, je cherche le royaume, de l’Abyssinie au Turkestan chinois, du Yemen à l’Afghanistan.
Ce travail marque, par ailleurs, mon attachement aux différentes formes de diplomatie culturelle. Au vent des conflits et des violences auxquels j’ai été confronté, elles ont constitué un précieux fil directeur. J’espère que la disparition, hélas annoncée, du corps diplomatique ne viendra pas affecter cette spécificité de notre diplomatie.
Ce prix que vous me faites l’immense honneur de m’attribuer sera pour les population afghanes vulnérables un geste de réconfort.
Permettez-moi de conclure par une phrase des Antimémoires que j’aime citer : « Ces terres légendaires appellent les farfelus ».
On sait que Malraux donne à ce mot une connotation positive. Il y voit un papillon porteur de fantaisie et de fêlure, qui offre une contradiction au tragique, permet une métamorphose et ouvre une libération.
Plus que jamais, soyons des farfelus.
Je vous remercie.